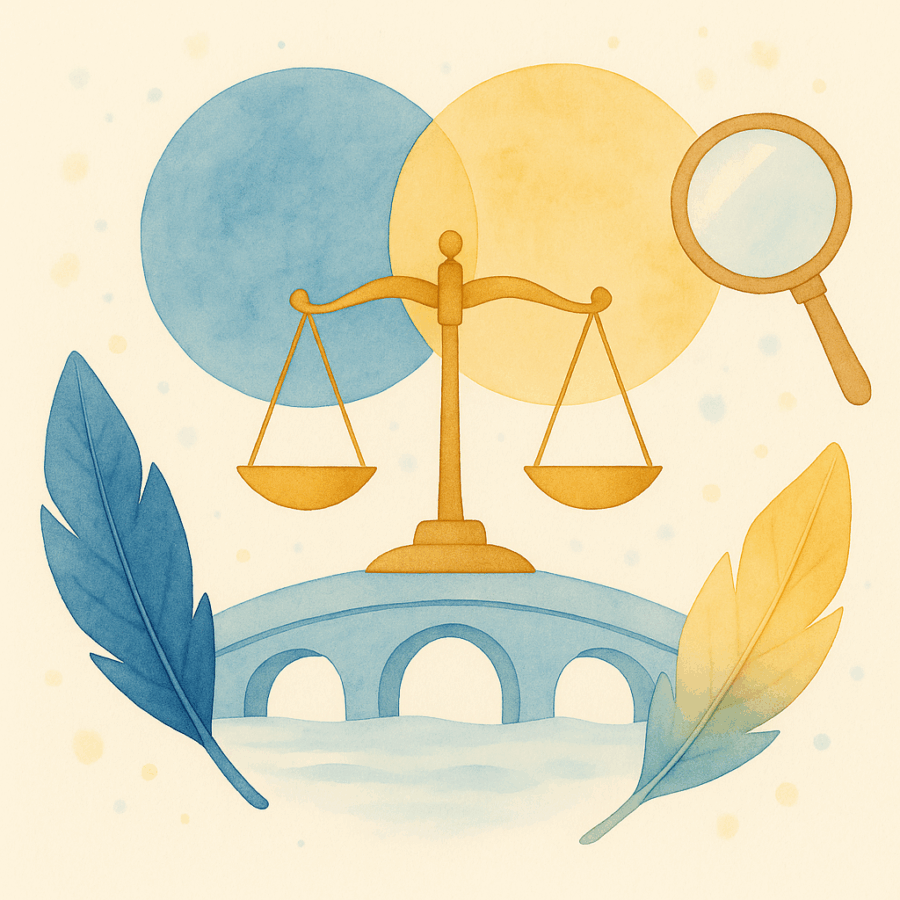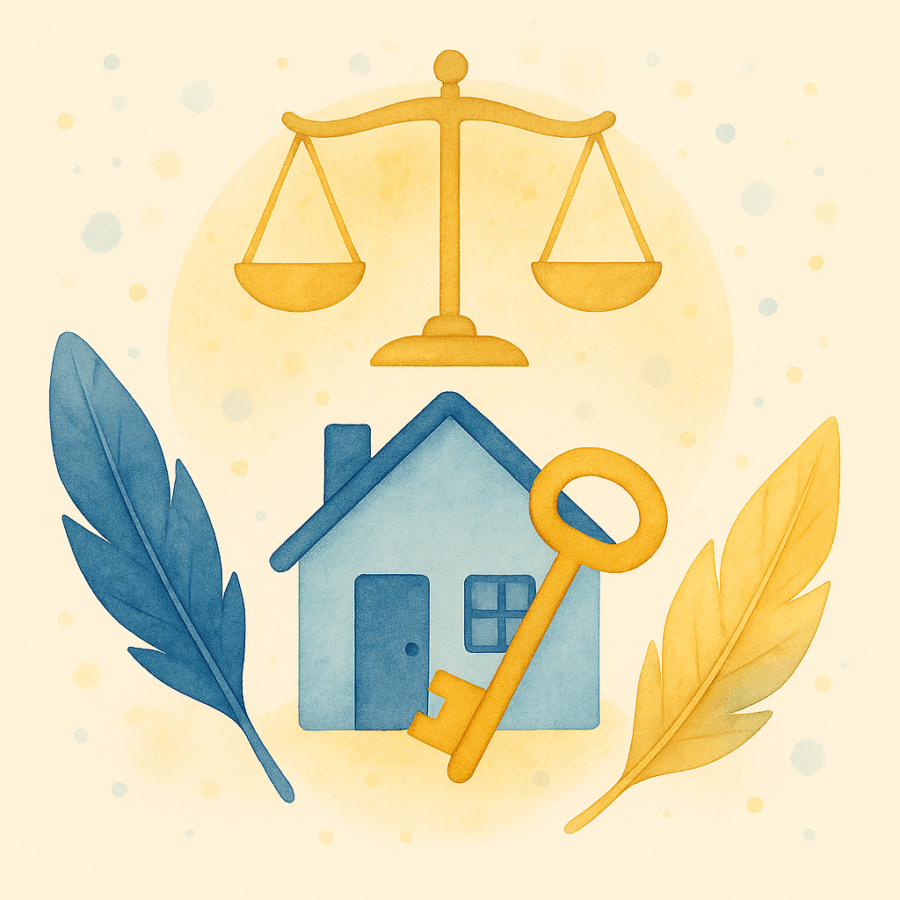De la justiciabilité interétatique des obligations positives de protection des droits de l’homme
Première décision rendue dans le cadre d’une procédure interétatique par une Cour qui, après 20 d’existence[1] institutionnelle, marque une étape importante de son évolution jurisprudentielle, l’arrêt RDC c. Rwanda est très « remarquable à plus d’un titre du fait de la nature et de l’ampleur inédite des violences commises(p.1) », mais également en raison de la qualité des parties et de la portée de la demande introduite par l’Etat requérant. Cette affaire revêt ainsi une dimension novatrice du fait qu’elle constitue la toute première à soulever la question de la justiciabilité interétatique des violations graves et manifeste des droits de l’homme devant la CADHP. Il est, à n’en point douter, « appelé à compter dans les annales judiciaires africaines[2] », tant en raison de sa portée normative que par son apport à la consolidation d’un véritable système procédural africain des droits de l’homme, ouvert aux requérants privés et contentieux entre Etats dans le contexte des violations massives des droits de l’homme. Et c’est précisément en cela que cette décision marque un tournant décisif dans l’architecture jurisprudentielle africaine.
« Il s’inscrit dans la continuité de l’ordonnance du 7 mars 2024. »[3] A l’origine, la CAfDHP s’est prononcée sur une requête introductive d’instance introduite le 21 août 2023 par la RDC dirigée contre le Rwanda. La RDC allègue la violation grave des droits de l’’homme du fait des opérations rwandaises dans son territoire. Elle soutenait également que ces incursions, accompagnées par des violations massives des droits de l’homme contenus dans des instruments ratifiés par lui et le Rwanda, constituaient des violations des obligations internationales du Rwanda et une atteinte à sa souveraineté et à l’intégrité de son territoire.
Le Rwanda, à son tour, a vigoureusement contesté la compétence de la CADHP et la recevabilité de la requête, estimant que « la cour doit se déclarer incompétente et, à titre subsidiaire, déclarer la requête irrecevable[4] » au motif que plusieurs conditions de recevabilité prévues à l’article 56 de la Charte, des articles 41(3)(c) et 50 (2)(d) du Règlement n’ont pas été respectées, invoquant par ailleurs le caractère abusif de la requête du fait des procédures engagées par la RDC devant d’autres juridictions, ainsi que son incompatibilité alléguées avec l’Acte constitutif .
Au regard des exceptions soulevées par l’Etat défendeur et des réponses qui lui sont apportées par l’Etat requérant, la Cour s’est prononcée sur sa compétence et sur la recevabilité de la requête introduite par la RDC.
Le présent billet vise à examiner, d’une part, la reconnaissance par la Cour africaine de sa compétence à connaitre la requête (I), et d’autre part, l’affirmation par la Cour de la recevabilité de la requête relative aux violations alléguées (II).
I – La reconnaissance par la Cour africaine de sa compétence à connaitre la requête relative aux violations alléguées
Après un examen préliminaire de sa compétence, conformément aux termes de la règle 49 (1) du Règlement, la Cour a, d’une part, rappelé « que sa compétence personnelle et temporelle ne sont pas contestées (p.172) » et, d’autre part, affirmé sa compétence matérielle et territoriale en rejetant l’exception soulevée par le Rwanda. Pour ce qui est de la compétence matérielle, au regard de sa jurisprudence elle rappelle que « l’article 3 (1) du Protocole lui donne compétence chaque fois qu’un requérant allègue des violations des droits de l’homme protégés par la Charte ou par d’autres instruments des droits de l’homme auxquels l’Etat concerné est partie. Cette considération demeure la même, que la partie soit une personne physique, la Commission ou un Etat (p.76). » Elle a ajouté que pour connaitre d’une affaire, la compétence de la Cour n’est assujettie à aucun formalisme relatif à la production de la preuve de l’existence préalable d’un différend avant le dépôt de la Requête. Ainsi, elle a confirmé que sa compétence matérielle trouve son fondement dans la Charte ainsi que dans les instruments internationaux ratifiés par le Rwanda et invoqués par la RDC dans sa requête. A ce niveau, à la question de savoir si les instruments juridiques en cause sont des instruments de protection de droit de l’homme, elle a rappelé sa jurisprudence dans l’affaire APDH c. République de Côte d’Ivoire.[5] Au-delà du simple fait que l’instrument visé doit être un traité, il faut d’abord que le texte énonce de façon explicite des droits subjectifs par la proclamation directe des droits dont les individus ou les groupes d’individus peuvent se prévaloir. Ensuite, il faut que le texte prescrive des obligations à la charge des Etats qui ont pour but de garantir la jouissance de ces droits individuels ou collectifs. Dans son avis consultatif Parlement Panafricain de 2021, la Cour a déjà rappelé que « la seule référence à l’expression ‘‘droit de l’homme’’ dans un traité n’est pas suffisante pour en faire un instrument de droit de l’homme (p.108) ».
Dans le cas d’espèce, la reconnaissance de la compétence extraterritoriale constitue un point central. La Cour a, d’une part, expressément admis en se référant à l’article 2 du PDICP et suivant sa jurisprudence constante qu’elle avait compétence que lorsque les violations alléguées sont survenues sur le territoire de l’Etat défendeur et, d’autre part, que « (…), la notion classique de compétence territoriale a connu quelque évolution. (…) l’obligation de protéger ou, du moins, celle de ne pas violer les droits de l’homme s’étend au-delà des limites traditionnelles des territoires des Etats (p.154) ». Ainsi, la responsabilité de l’Etat peut être engagée pour des actes commis en dehors de son territoire, notamment dans « les situations de conflit armé (p.130). » Cette affirmation est un véritable tournant jurisprudentiel pour la Cour. Elle s’est inscrite dans la lignée de décisions de la CEDH[6], telle Al-Skeini et autre c. Royaume-Uni[7], où la Cour affirme que l’article 1 de la CEDH s’applique lorsque l’Etat « exerce un contrôle effectif sur une zone située en dehors de son territoire[8] ». Et Al-Djedda c. Royaume-Uni, la Cour rappelait que : « aux termes de cette disposition (Article 1), l’engagement des Etats contractants se borne à reconnaitre (…) aux personnes relevant de leur juridiction les droits et les libertés énumérés.[9] »
Cependant, cette affirmation de compétence cache quelques points critiques. Tout au long de l’arrêt, la Cour ne développe pas d’examen approfondi des conditions exactes du contrôle effectif : une simple allégation des violations des droits de l’homme par le soutien à un groupe armé suffit à établir sa compétence, sans une définition rigoureuse des critères ni de seuil d’occupation. La Cour affirme que « l’implication des FDR, dans le conflit entre M23 et les FARDC est établie (p.169) » et que « quiconque se trouve sous le pouvoir ou contrôle effectif des forces d’un Etat partie opérant en dehors de son territoire bénéficie de la protection extraterritoriale[10] », sans pour autant préciser le degré d’implication ou le contrôle exercé. L’évaluation du contrôle effectif ne peut se faire sans la réunion des critères, tels que la coordination stratégiques, la présence militaire continue et la capacité d’imposer son autorité, l’exercice de fonctions administratives, la capacité concrète de contrôler la situation sur le terrain[11], l’influence déterminante sur l’administration locale subordonnée, et enfin la preuve factuelle sur la présence des troupes. La CIDH dans l’affaire Coard et autres c. Etats-Unis s’est fondée sur l’autorité physique et directe exercée par l’armée américaine à Grenade pour reconnaitre sa compétence extraterritoriale[12].
D’autre part, dans sa décision de 90 pages, la Cour ne s’est jamais attardée sur la question du lien entre l’acte extraterritorial et les violations alléguées[13], laissant le lien de causalité implicite[14]. Ce silence pourrait compromettre sa légitimité limiter la portée normative de sa position, rendant les Etats africains très hésitant à reconnaitre sa compétence dans des situations similaire.
Enfin, la Cour a admis sa compétence malgré le conflit armé internationalisé, sans pour définir les limites d’une telle compétence, ce qui fragilise la sécurité juridique pour les victimes, souvent incapables de rassembler des preuves ou d’accéder aux zones occupées. La compétence de la Cour apparaît en réalité plutôt formelle et effective[15].
Ainsi, après l’affirmation de sa compétence, la Cour s’est déclarée compétente pour connaitre de la présente requête en statuant sur sa recevabilité.
II – L’affirmation par la Cour de la recevabilité de la requête relative aux violations alléguées
Après l’affirmation de sa compétence, la Cour conformément à la règle 50(1) et à l’article 6(2) du Protocole a statué sur la recevabilité de la requête en application de l’article 56 de la Charte. Ainsi, elle a examiné les exceptions soulevées par le Rwanda, portant sur le non-respect des procédures préalables du Pacte des Grands Lacs, les procédures non judiciaires de l’Acte constitutif, l’abus de procédure, l’incompatibilité de la requête avec l’Acte constitutif et la Charte, le non-épuisement des recours internes (p.278) et la litispendance devant la CJAE. Cependant, elle a rejeté toutes les exceptions et a jugé que la requête a rempli les conditions prévues par l’article 56 de la Charte et la règle 50(2) du Règlement et elle est recevable.
Concernant le non-respect des procédures préalables prévues par le Pacte des Grands Lacs, la Cour a souligné que, pour « des questions de procédures, elle applique la Charte, le Protocole, son règlement qui en est l’émanation et, éventuellement les principes généraux de procédure généralement acceptés (p.190). » Ainsi, l’exigence de l’article 29 du Pacte a été rejeté, la « Cour africaine de justice » n’a pas été mise en place et étant distincte de la CAfDHP. De même, elle a rappelé que l’Acte constitutif ne peut être invoqué pour contester une procédure devant elle. Elle ajoute que pour des questions de procédure et surtout de recevabilité d’une requête, elle n’applique que la Charte, le Protocole, son règlement et les principes généraux de procédure généralement acceptés (p.203). S’agissant de l’abus de procédure, la Cour, suivant sa jurisprudence, XYZ c. République du Bénin 27 novembre 2020[16], a rappelé que « le simple fait que le requérant dépose plusieurs requetés contre le même Etat défendeur ne traduit pas nécessairement un manque de bonne foi de la part d’un requérant (p.236). » Seule l’intention du requérant permet de déterminer l’abus. Pour ce qui est à l’abus de procédure fondé sur des informations résultant des médias et de la presse, la Cour a affirmé que ces éléments ne sont spécifiques dès lors qu’ils sont accompagnés d’éléments crédibles (p.276), telles que les pièces émanant des sources de l’UA et des N-U. Ainsi, pour la Cour la ratio legis de l’article 54(6) de la Charte n’a pas pour objet d’interdire des informations dont l’exclusivité ne repose pas sur une diffusion par les moyens de communications de masses comme. Cette approche de la Cour permet de contourner l’effet paralysant de la preuve dans les zones de conflit. Quant à l’ l’incompatibilité de la requête avec l’Acte constitutif et la Charte, la Cour a affirmé que « le fait qu’une requête soit qualifié comme étant liée aux questions de paix et de sécurité n’exclut pas qu’elle puisse être relative à la protection des droits de l’homme (p.257). » Ainsi, elle a rappelé que la compatibilité de la requête avec l’Acte constitutif signifie qu’elle soit relative à l’un des objectifs de l’Acte. C’est ce qu’elle avait déjà rappelé dans l’affaire Glory Cyriaque Hossou c. République du Bénin[17]. Pour l’affaire RDC c. Rwanda, elle a rappelé que la requête est compatible avec l’article 3(h) de l’Acte. Relativement au non-épuisement des recours internes, elle a souligné que les violations alléguées sont de nature systématiques et massives, notamment au regard du nombre des victimes présumées. En pareille circonstance, elle estime, à l’instar de la Commission, qu’il n’est ni raisonnable ni pratique d’exiger un épuisement préalable des recours internes[18]. Cette position de la Cour constitue une avancée et une inflexion forte. Elle a adapté la logique d’accès à la Cour aux contextes d’atteintes massives et systémiques en donnant une interprétation élargie à l’article 56(5) de la Charte. Toutefois, en admettant que dans pareille circonstance l’épuisement peut être écarté, la Cour ne définit pas explicitement le seuil clair pour évaluer ce que constitue une « voix interne efficace » dans un contexte de conflit armé. Cette absence d’articulation normative pourrait laisser un flou procédural de nature à affaiblir la lisibilité et la portée de l’article 56(5) de la Charte et la règle 50(2)(e) du Règlement et pourrait conduire à une application quasi-mécanique de l’exception. Enfin, au sujet de la litispendance devant la CJAE, l’Etat défendeur invoque le non-respect des conditions de recevabilités prévues par l’article 56(7) de la Charte. La Cour a rappelé que, conformément à sa jurisprudence Jean Claude Roger Gombert c. République de Côte d’Ivoire[19], la notion de règlement implique trois conditions alternatives : la similitude des parties, similitude des demandes et existence d’une première décision au fond (p.362). Ici, seule la première condition est remplie (p.363). Quant aux objets : la requête devant la CADHP visait à constater des violations des droits de l’homme dans le conflit armé sur le territoire congolais[20], celle devant la CJAE portait sur des violations du traité instituant la CAE[21]. Cette conclusion de la Cour appelle à des réserves. En effet, les requêtes soumises à la Cour africaine et à la CJAE visaient toutes deux des violations graves et massives des droits de l’homme. Donc, à la lumière de la Charte africaine et en vertu de l’article 27(1) du Traité instituant la CAE, « la CJAE est compétente pour apprécier des telles violations[22] ». Enfin, aucune décision n’avait été rendue au moment du dépôt de la présente Requête (p.366), et la Cour a donc conclut que la Requête remplissait les conditions prévue par la Charte et le Règlement (p.367).
En définitive, L’arrêt RDC c. Rwanda marque un tournant décisif de l’évolution jurisprudentielle africaine. Il revêt une dimension novatrice du fait qu’il a soulevé la question de la justiciabilité interétatique des violations des droits de l’homme dans le contexte de conflit armé. Cependant, l’arrêt n’échappe pas à la critique, et le raisonnement de la Cour soulève, en plusieurs points, des interrogations qui méritent un examen approfondi. Néanmoins, il est, à n’en point douter, appelé à marquer la jurisprudence de la Cour, tant par sa portée normative que par son apport à la consolidation du système juridictionnel africain des droits de l’homme.
[1] Le protocole portant création d’une CAfDHP adopté le 9 juin 1998 à Ouagadougou,
[2] Ntwari G.-F., « Note sur le premier arrêt de la Cour africaines des droits de l’homme et des peuples », in African Journal of International and Comparative Law, n°18, Vol. 2, 2010, p.233.
[3] DONGAR B. C.-D. et AFOGO N. O., « Note sur l’arrêt de la Cour africaines des droits de l’homme et des peuples du 26 juin 2025 (compétence et recevabilité) dans l’affaire RDC c. Rwanda », Droite Politique en Afrique, billet du 22 septembre 2025, p. 1.
[4] Voir point 24 de l’arrêt de la CAfDHP, Affaire n°007/2023, RDC c. Rwanda, du 26 juin 2025
[5] CAfDHP, Affaire n°001/2014, APDH c. Côte d’Ivoire (fond) du 18 novembre 2016, 1 RJCA, point 57.
[6] Les décisions n°15318/89 du 23 mars 1995 Loizidou c. Turquie (exception préliminaires), n°47708/08 du 20 novembre 2014, Jaloud c. Pays-Bas de 2014, n°27021/08 du 07 juillet 2011.
[7] CEDH, décision n°55721/07 du 07 juillet 2011 Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, point 138.
[8] CEDH, affaire n°55721/07, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, du 7 juillet 2011, point 138.
[9] CEDH, affaire n°27021/08, Al-Djedda c. Royaume-Uni, du 7 juillet 2011, point 74.
[10] Comité des droits de l’homme, Observation générale n°31, 2004, para. 10.
[11] Voir CEDH, Affaire n°15318/89, Loizidou c. Turquie (Exceptions préliminaires), du 23 mars 1995, point 62.
[12] CIDH, Coard et autres c. Etats-Unis, Affaire n°10/951, rapport n°109/99, du 29 septembre 1999, point 37.
[13] Voir l’article 8 des Articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat de la CDI.
[14] Voir : Matringe J., « La responsabilité de l’Etat pour violation du droit international humanitaire et de la convention sur le génocide », p. 3,
[15] CEDH, Affaire n°39630/09, El-Masri c. ex-République Yougoslave de Macédoine, du 13 décembre 2012, points 198-241 et CIADH, Série C n°4, Velasquez Rodriguez c. Honduras, 29 juillet 1988, points 166-184.
[16] CAfDHP, requête n°010/2020, XYZ c. République du Bénin du 27 novembre 2020, point 42.
[17] Glory Cyriaque Hossou c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 012/2018, arrêt du 13 novembre 2024 (fond et réparations), point 37.
[18] CADHP, Communications 54/91-61/91-96/93-98/93-164/97-196/97-210/98, Malawi Africa Association, Amnesty International, Mme Sarr Diop, Union interafricaine des droits de l’Homme et RADDHO, Collectif des veuves et ayants Droit, Association mauritanienne des droits de l’Homme c. Mauritanie, du 11 mai 2000, point 85.
[19] CADHP, Affaire n°038/2016, Jean Claude Gombert c. République de Côte d’Ivoire (compétence et recevabilité) du 22 mars 2018, 2 RJCA 270, point 45.
[20] Voir dispositif de la Requête introductive d’instance.
[21] Voir pages 6 de la requête introduite devant la CJAE.
[22] DONGAR B. C.-D. et AFOGO N. O., précité, p. 13.
Par Outman ALI OUTMAN
Doctorant à l’Université Toulouse-1 Capitole