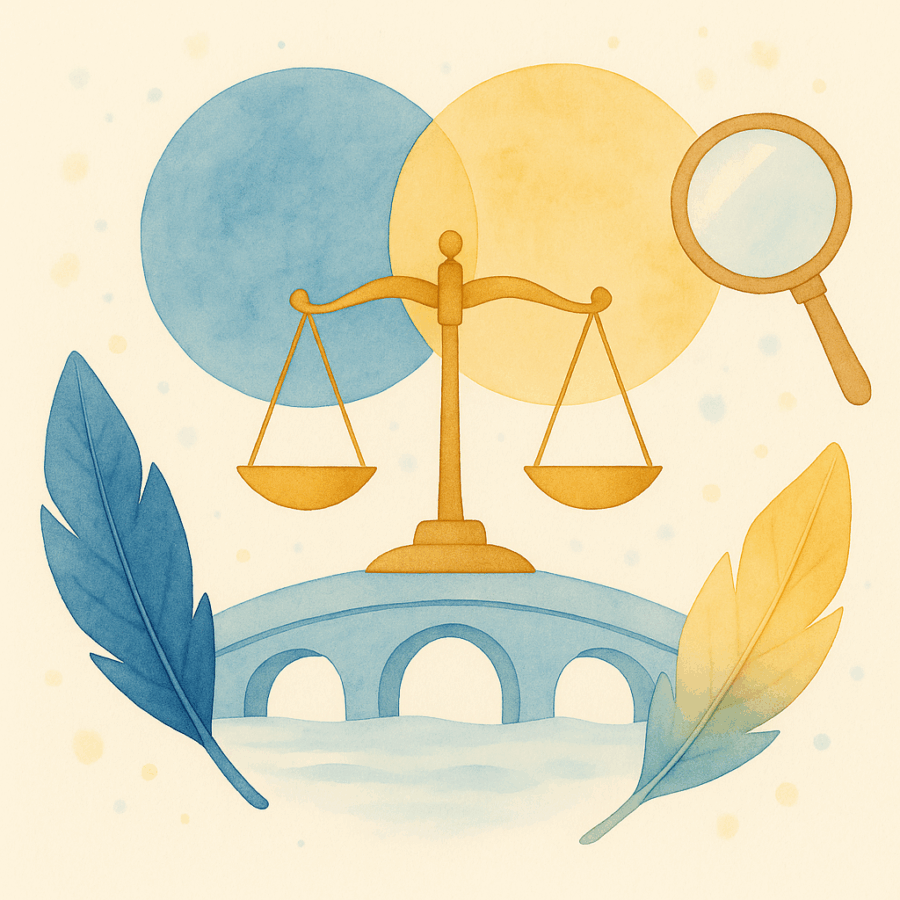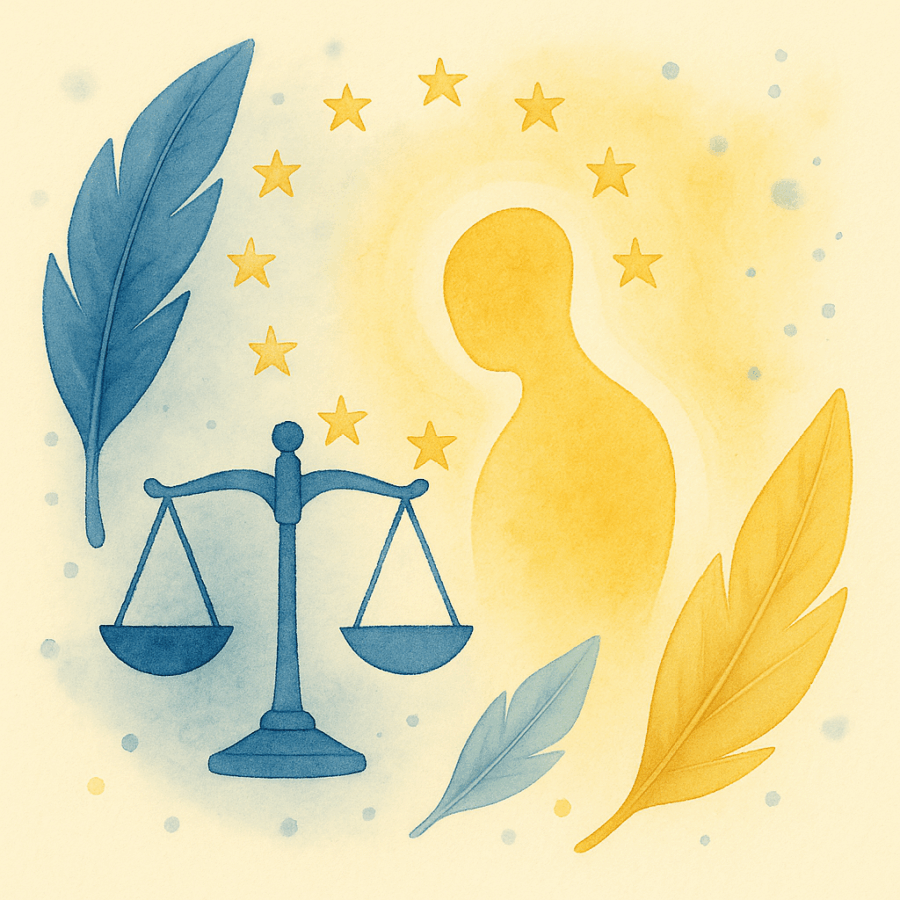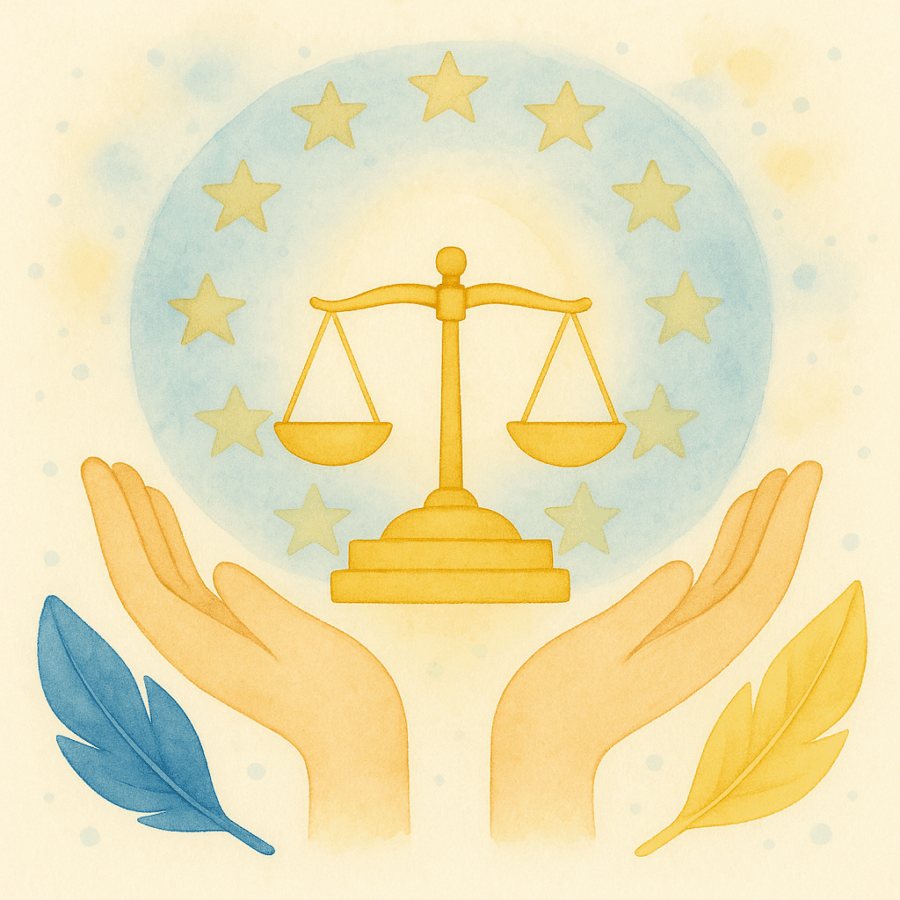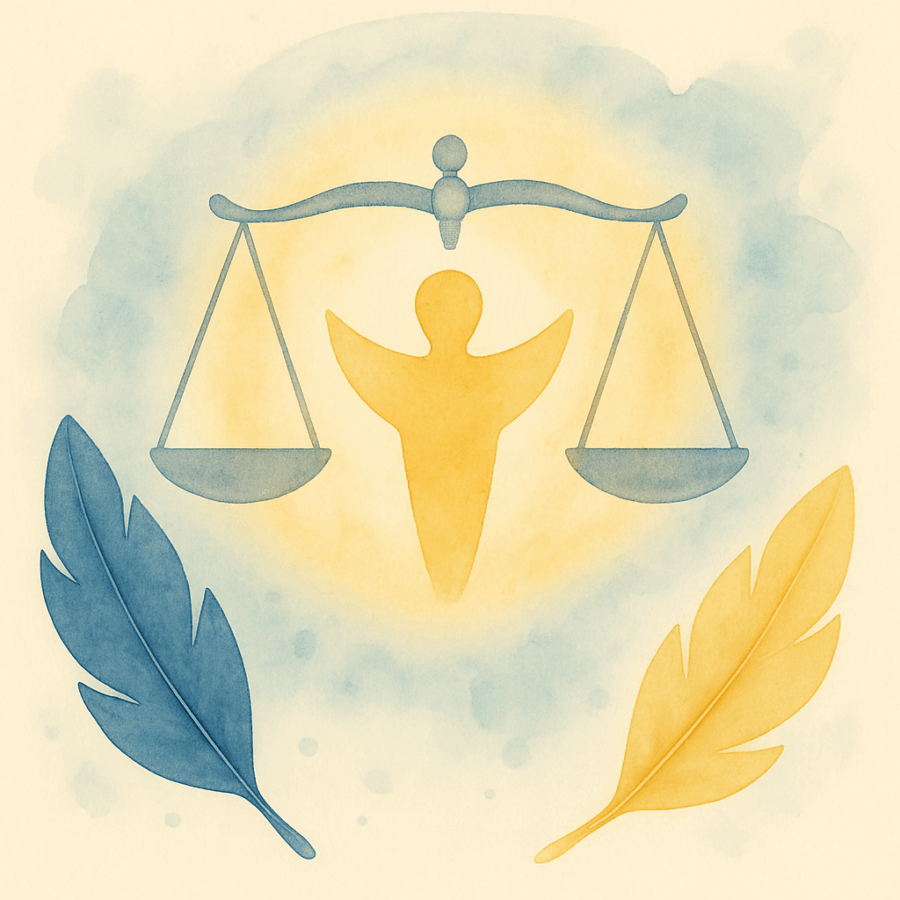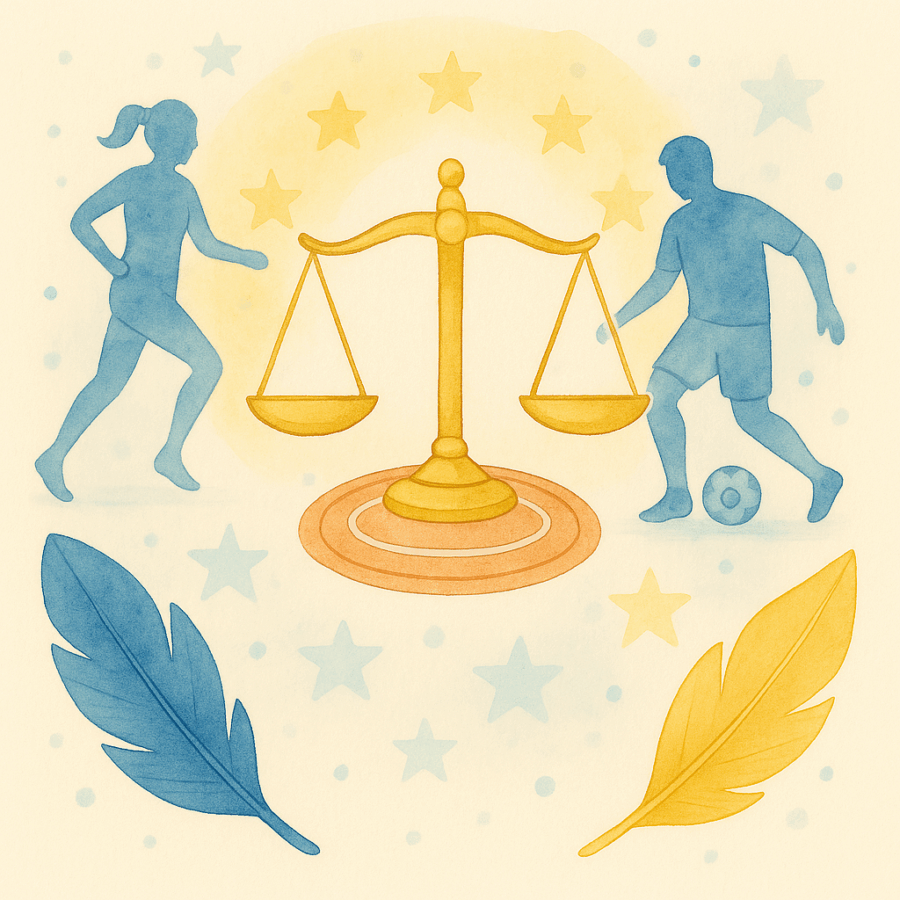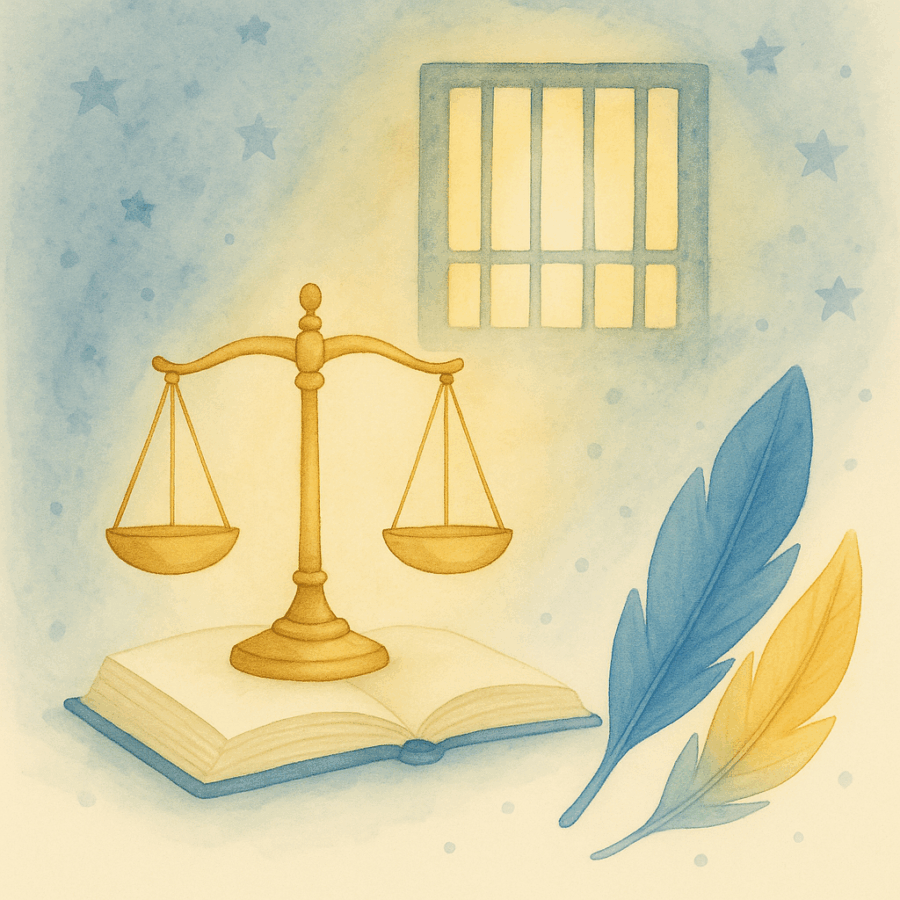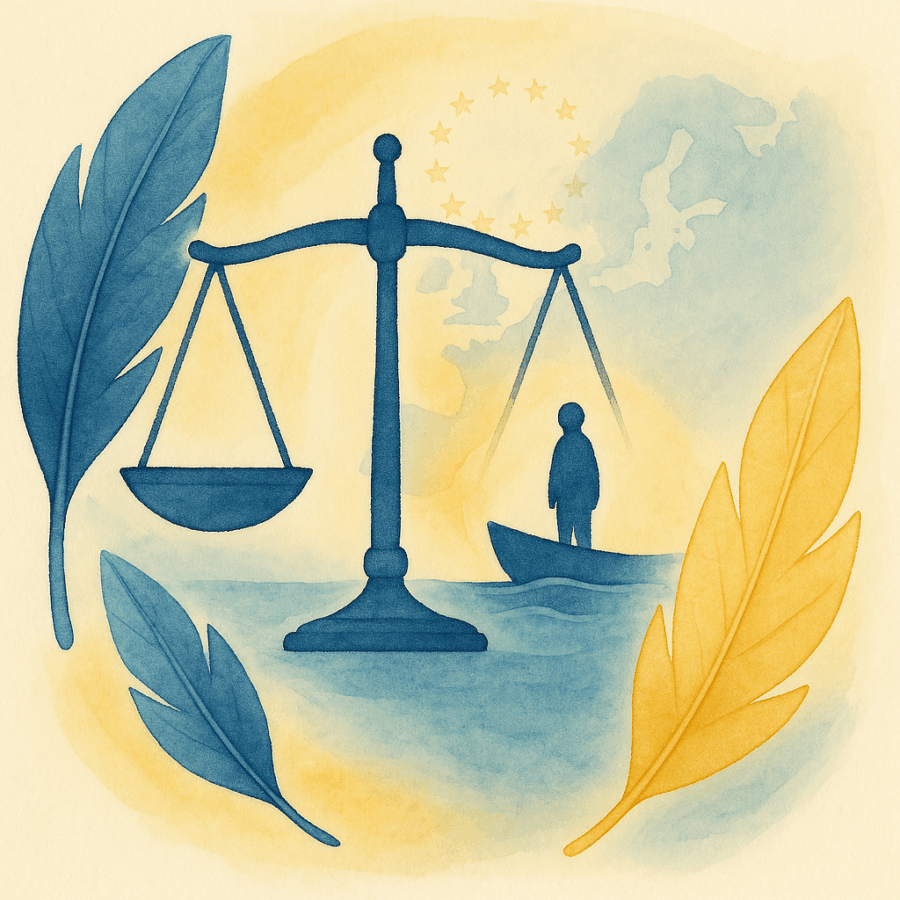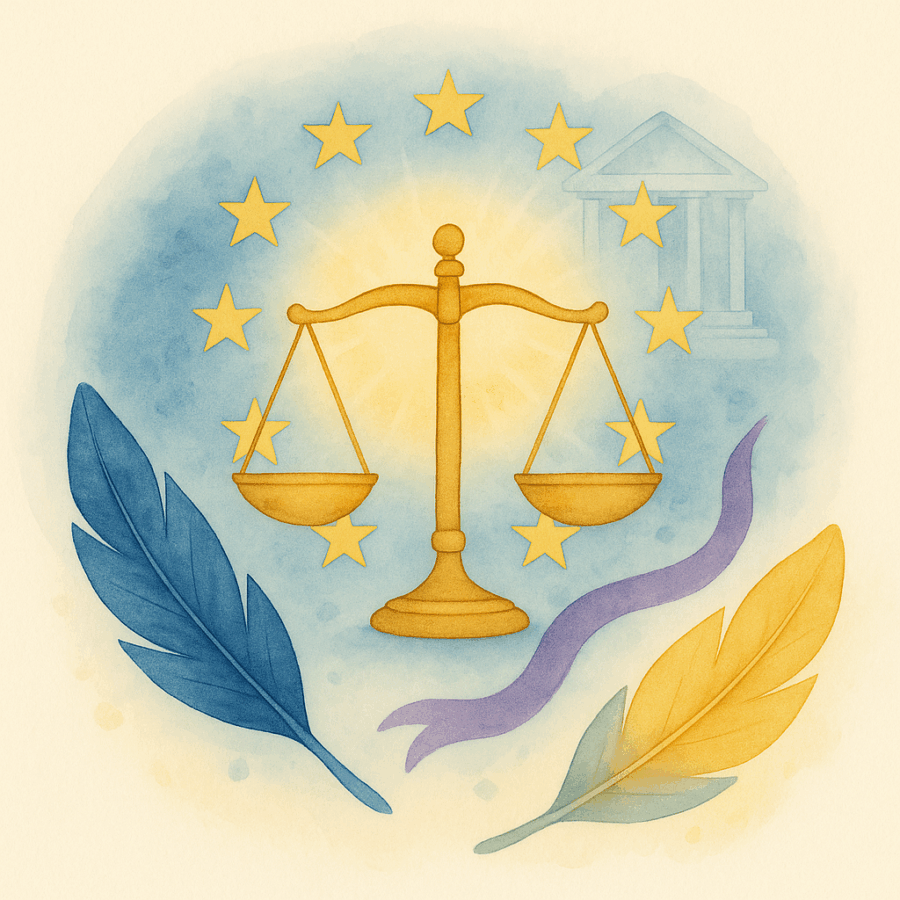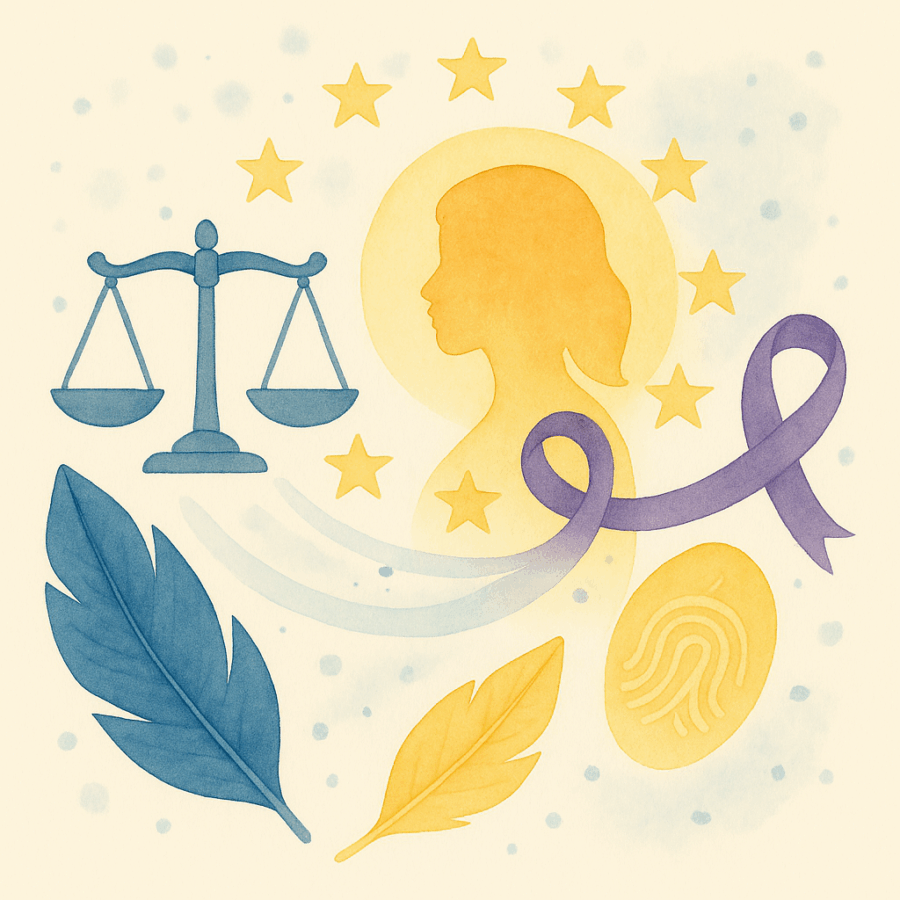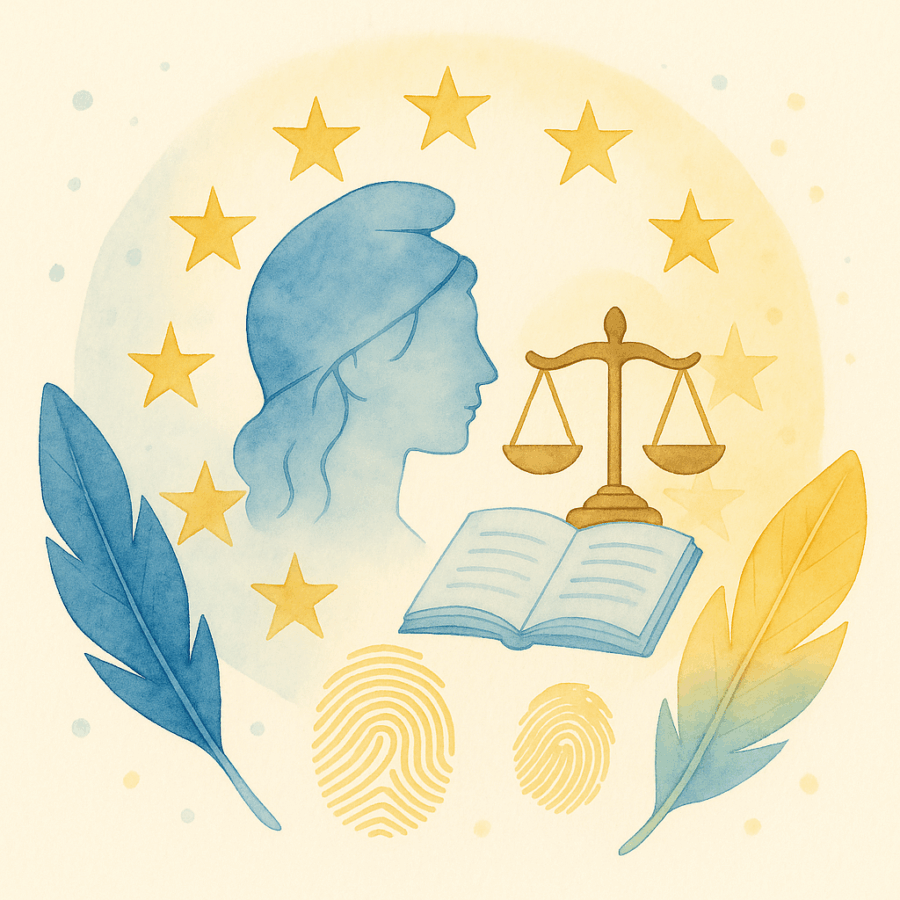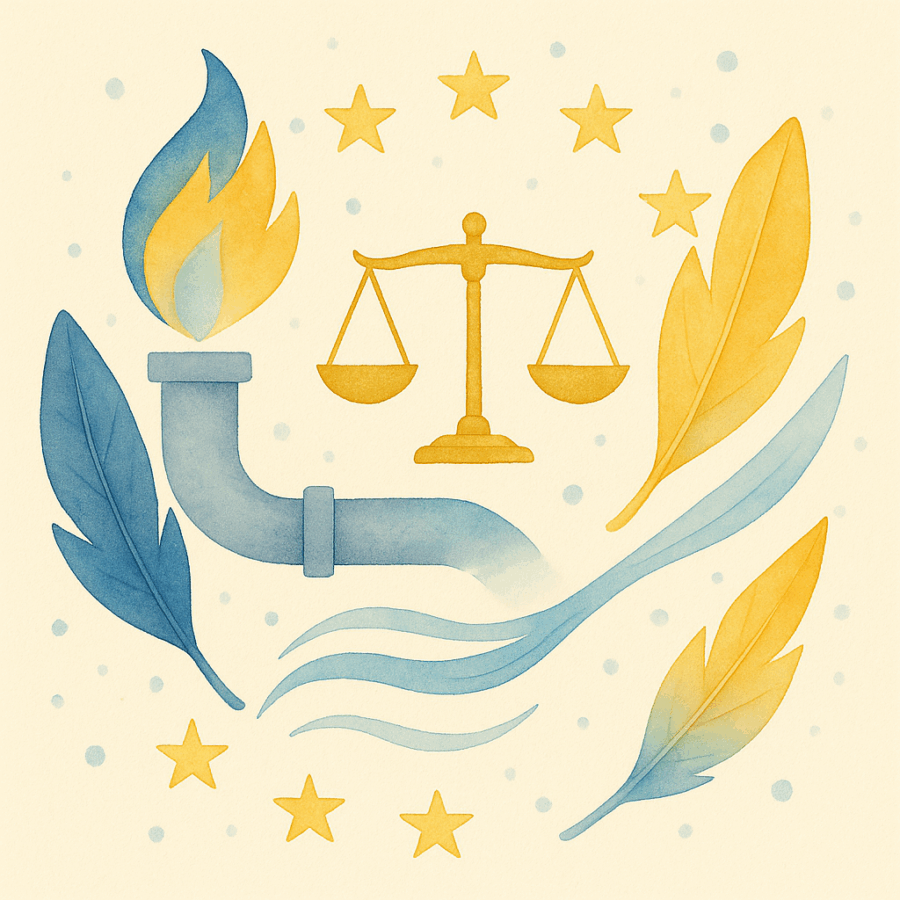Quelques jours à peine après un billet où l’on pouvait encore soutenir que la CJUE ne saurait être entièrement vilipendée lorsqu’elle se heurte à l’étroitesse des catégories juridiques disponibles[1], l’actualité nous oblige à reprendre la plume : cette fois, c’est plutôt l’inverse. L’arrêt Cupriak-Trojan n’est pas un exercice de retenue où la Cour de justice se draperait dans une prudence. Le 25 novembre dernier, la CJUE affirme, avec une limpidité inédite, qu’un mariage entre personnes homosexuelles légalement conclu dans un État membre doit être reconnu dans un autre lorsque des citoyens de l’Union exercent leur droit à la libre circulation. Est-ce inattendu ? Nullement. Est-ce insignifiant ? Pas davantage. Était-ce explosif ? Certainement, si l’on en juge par les crispations nationales qu’une telle affirmation ne manquera pas de raviver et par le bras de fer qui, jour après jour, oppose des États membres à l’Union. Le même jour, d’ailleurs, les eurodéputés accusaient Budapest d’avoir glissé vers un « régime hybride d’autocratie électorale » et réclamaient la mise à exécution de sanctions contre la Hongrie : un contexte politico-juridique qui rend l’arrêt Cupriak-Trojan un relief tout particulier[2]. Pourtant, à regarder de plus près, le vrai intérêt de cet arrêt ne tient ni à une audace soudaine ni à une flambée jurisprudentielle isolée : il s’inscrit dans un mouvement plus profond, plus ample, que la CJUE poursuit depuis plusieurs années. Celui d’un droit de l’UE qui travaille patiemment – presque obstinément – à donner consistance à la citoyenneté de l’UE, à faire circuler le statut personnel avec le citoyen et à refuser que les frontières internes reconstituent des zones d’ombre où l’on pourrait être dépossédé de la vie privée et de la vie familiale que l’on a construite à l’étranger[3].
C’est, du moins, le message que la CJUE semble adresser avec une intensité croissante depuis deux ans, comme en témoignent la saga jurisprudentielle sur la transidentité commentée sur ce blog (Mirin, Mousse et Deldits[4]) ou encore l’arrêt Commission c. Malte[5]. Autant d’affaires qui participent d’un même mouvement de fond : celui d’une citoyenneté de l’UE dont la montée en puissance laisse entrevoir, par touches successives, l’émergence d’une véritable clause et logique d’equal protection[6].
1°) La faille révélée : une affaire simple qui fissure l’unité nationale
Dans cette dynamique jurisprudentielle désormais bien installée, l’affaire Trojan surgit presque avec simplicité – tout du moins en apparence. Puisqu’elle vient buter sur une ligne de fracture politique devenue, surtout en Europe centrale, un marqueur d’affirmation identitaire. J. Cupriak-Trojan, citoyen polono-allemand, et M. Trojan, de nationalité polonaise, se sont mariés à Berlin avant de revenir s’installer en Pologne. Rien, à ce stade, ne laissait présager la moindre difficulté : conformément au droit allemand, M. Cupriak-Trojan avait ajouté le nom de son époux à son patronyme, et les autorités polonaises avaient, sans sourciller, mis à jour leurs registres. Le nom – principal marqueur de l’identité[7] – circulait librement d’un État à l’autre, comme si la trajectoire familiale du couple Cupriak-Trojan n’appelait aucune réserve. Mais la portabilité s’interrompt brusquement. Quand les deux hommes sollicitent la transcription de leur acte de mariage dans les registres polonais, la machine administrative se referme aussitôt. Le refus est catégorique, presque mécanique : le droit polonais ne reconnaît pas les mariages entre personnes de même sexe, affirme-t-on, et l’acte étranger heurterait les « principes fondamentaux » de l’ordre juridique polonais, au premier rang desquels figure l’exigence d’un mariage exclusivement hétérosexuel. Le registre accueille le nom, mais récuse le lien conjugal en conformité avec son cadre normatif et ses convictions profondes.
Le couple Cupriak-Trojan conteste. En vain. La juridiction saisie confirme le refus : ni le droit interne ni l’ordre public polonais n’admettent une union homosexuelle, et la situation – étrange contraction conceptuelle – serait « sans lien » avec la libre circulation. En d’autres mots, on replie la question sur le seul terrain national, comme si l’identité familiale d’un citoyen de l’Union pouvait être fragmentée au gré des frontières, découpée selon les latitudes juridiques. Ce raisonnement, dont l’artifice affleure sous la sobriété, conduit le couple à se pourvoir. Et une question préjudicielle finit par être soumise à la Cour : le droit de l’UE – notamment les articles 20 et 21 du TFUE et la Charte des droits – fait-il obstacle à ce qu’un État membre refuse de reconnaître et de transcrire un mariage entre personnes homosexuelles conclu dans un autre État membre, lorsqu’un tel refus empêche les intéressés de résider en Pologne comme un couple marié portant un même patronyme ? La question semble simple, mais elle ne l’est pas. Puisque derrière l’acte d’état civil, c’est tout le statut personnel et familial qui vacille. Derrière la technicité de la question, ce sont certains principes cardinaux de l’Union qui se trouvent convoqués : la libre circulation, la continuité des identités, la protection de la vie privée et la vie familiale. L’affaire révèle, en creux, une tension structurante celle qui oppose la grammaire nationale du droit de la famille à la promesse européenne d’un espace où les vies, les noms et les liens ne devraient pas se défaire au passage des frontières internes[8].
C’est très précisément dans cette « zone de friction » – là où les catégories nationales rencontrent les exigences de la citoyenneté de l’UE – que s’inscrivent les conclusions rendues en avril 2025 par l’avocat général de la Tour[9]. Celles-ci ne se tiennent pas en marge du conflit : elles en déplient les lignes de force, mais aussi les lignes de fuite. Car une question sous-tend toute l’affaire : que reste-t-il de la souveraineté des États dans le domaine du droit de la famille lorsqu’un citoyen de l’UE franchit une frontière ? Et comment concilier celle-ci avec la continuité des identités que protège la libre circulation ?
2°) La faille dépliée : l’avocat général et l’art discret de tracer les lignes de fuite
À ce stade, les conclusions rendues par l’avocat général J.-R. de la Tour interviennent comme une mise en perspective nécessaire : elles replacent l’affaire Cupriak-Trojan dans ce qu’elle met véritablement en jeu. Derrière l’affrontement entre un mariage célébré à Berlin et l’État polonais campé sur sa définition interne du couple, l’avocat général rappelle d’emblée une évidence souvent oubliée dans ce genre de contentieux : la libre circulation n’est pas un principe abstrait, mais un principe qui doit être concret et effectif[10]. Elle s’incarne dans des trajectoires familiales, dans des identités qui se construisent et se recomposent au fil des déplacements à l’intérieur de l’Union. Son propos s’organise alors autour d’un double impératif : respecter la répartition des compétences entre l’UE et les États membres[11], mais refuser que cette répartition devienne un prétexte permettant d’ignorer les effets concrets – quelquefois dévastateurs – de la mobilité intra-européenne[12]. J.-R. de la Tour pose ainsi une distinction subtile, mais décisive : le droit de l’UE n’impose pas absolument l’enregistrement d’un mariage étranger dans les registres nationaux (i) ; il impose simplement sa reconnaissance chaque fois que celle-ci est nécessaire à l’exercice effectif de la liberté de circulation (ii)[13]. Et c’est précisément cette articulation qui, dans une Pologne sans procédure alternative de reconnaissance juridique des couples homosexuels, rend la transcription indispensable. Sans elle, le couple demeure juridiquement « invisible » : incapable d’établir son statut, privé des droits attachés au mariage et assigné à une forme d’inexistence civile.
L’avocat général le dit sans ambages : le refus polonais porte atteinte directement à la consistance juridique dudit couple, entrave l’exercice de ses droits conjugaux, complique l’accès aux prestations attachées au statut marital et contrarie la vie familiale patiemment construite dans un autre État membre. D’où sa conclusion, formulée avec résolution : « la transcription de l’acte de mariage allemand dans les registres de l’état civil polonais s’impose en vertu des particularités nationales, ainsi que cela résulte des observations du gouvernement polonais »[14]. Pour appuyer cette position, J.-R. de la Tour inscrit son analyse dans une jurisprudence désormais solide. Des arrêts Coman [15], Pancharevo ou encore Mirin[16], il tire une ligne continue : les actes d’état civil établis dans un État membre doivent produire des effets dans un autre lorsque leur absence de reconnaissance entraverait les droits conférés par la citoyenneté de l’Union européenne[17]. Qu’il s’agisse d’un changement de nom, de genre ou d’un lien de filiation, la Cour a déjà jugé qu’un refus de reconnaissance peut infliger un préjudice grave – non seulement administratif, mais également « existentiel » – en réduisant la personne à une version amoindrie d’elle-même dès lors qu’elle franchit la frontière d’un autre État membre. L’avocat général étend, somme toute, ce raisonnement au mariage des couples homosexuels. En effet, il souligne que le statut familial des couples de même sexe n’est ni un luxe symbolique ni une simple mention administrative. C’est une composante essentielle de la « vie privée et familiale » protégée par l’article 7 de la Charte[18]. J.-R. de la Tour souligne d’ailleurs la cohérence de cette lecture avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme : l’article 8 de la Convention impose aux États de garantir une forme adéquate de reconnaissance des couples homosexuels, même sans ouverture du mariage – et la Pologne, déjà condamnée à plusieurs reprises par les magistrats strasbourgeois[19], persiste dans un vide juridique et une incertitude soigneusement entretenue concernant les couples de même sexe[20].
À la lumière de ces éléments, la solution avancée par l’avocat général se précise : reconnaître, aux fins de la libre circulation, que le mariage existe juridiquement et produise ses effets ; enregistrer le mariage étranger dans les registres nationaux, dès lors qu’aucune autre voie interne ne permet d’assurer cette reconnaissance juridique. Partant, le refus polonais devient, d’après J.-R. de la Tour, un obstacle disproportionné à la libre circulation – une entrave que ne saurait justifier l’« identité nationale »[21]. Mais l’avocat général conserve une forme de prudence : fidèle à la méthode qu’il développe depuis quelques années dans ses conclusions en sollicitant une « voie médiane »[22] , il suggère qu’un législateur déterminé pourrait aménager des mécanismes alternatifs pour éviter toute accusation. Encore faudrait-il que ce législateur[23] accomplisse consciencieusement son travail[24] – et donc ne se condamne à une espèce d’« incompétence négative »[25].
Enfin, sur un plan plus structurel, les conclusions de J.-R. de la Tour révèlent une fragmentation croissante du droit européen de l’état civil. Les questions d’identité – nom, genre, etc. – bénéficient à présent d’une reconnaissance quasi automatique dans l’État d’accueil. Les situations familiales – mariage, filiation, … – demeurent, elles, soumises à un régime, pour ainsi dire, semi-coordinateur, où les États conservent une marge d’appréciation substantielle. Cette dissociation, déjà mise en lumière par l’affaire Mirin, apparaît comme une source de tensions évidentes : du point de vue du citoyen mobile, refuser de reconnaître son nom ou son mariage produit la même conséquence – l’impossibilité de vivre normalement, d’exercer ses droits et de faire reconnaître son identité. Cependant, l’avocat veille à éviter un écueil majeur : il refuse de transformer la libre circulation en un droit illimité susceptible d’absorber l’intégralité du statut personnel. Une telle lecture détacherait les droits fondamentaux de leur ancrage dans les compétences de l’Union, en contradiction avec l’article 51 § 2 de la Charte. Sa solution vise au contraire un équilibre : garantir l’effectivité du droit de l’Union sans dissoudre la substance du droit familial national.
3°) La faille habitée : la CJUE et la construction progressive d’un statut familial européen
Les conclusions de l’avocat J.-R. de la Tour avaient entrouvert la brèche et esquissé sa trajectoire ; l’arrêt de Grande chambre Cupriak-Trojan s’y installe pleinement, comme si la Cour venait occuper l’espace qu’elles avaient révélé. Sans fracas, mais avec une clarté remarquable, la CJUE emboîte le pas de l’avocat général et confirme que l’affaire n’est pas une simple querelle administrative : elle touche au fondement même de ce que signifie être citoyen de l’UE dans un espace de libre circulation. La Cour commence par rappeler une évidence – pourtant niée par la législation et les juridictions polonaises – : les requérants, en tant que citoyens, jouissent non seulement du droit de circuler et de séjourner, mais aussi de celui de mener une vie familiale normale lorsqu’ils exercent cette liberté[26], que ce soit dans l’État d’accueil ou à leur retour dans leur État d’origine. Partant, lorsqu’un couple fonde une famille dans un autre État membre, notamment par le mariage, rien ne justifie qu’il soit ensuite contraint, une fois revenu dans son pays natal, de vivre comme deux étrangers l’un pour l’autre. La CJUE s’interroge ensuite sur la portée très concrète du refus polonais. Il ne s’agit pas d’un désaccord de principes mais d’un préjudice réel, profond, affectant toutes les sphères de la vie : administrative, professionnelle, sociale, voire intime. Refuser de reconnaître un mariage entre personnes de même sexe, tout comme l’avouait déjà l’avocat général, revient à assigner les conjoints à une forme d’inexistence civile[27] – à les placer, dans leur propre pays, dans la posture fictive de personnes « non mariées », comme si leur union n’avait jamais existé.
De cette analyse découle une conclusion sans ambiguïté : ce refus heurte les fondements mêmes du droit de l’UE. Il viole les articles 20 et 21 TFUE relatifs à la libre circulation et au droit de séjour ; il méconnaît l’article 7 de la Charte, qui protège la vie privée et familiale ; il contrevient, en outre, à l’article 21 de la Charte, qui prohibe toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Et la Cour d’ajouter[28], avec une force particulière, que « l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, consacrée par cette disposition, revêt un caractère impératif en tant que principe général de droit de l’Union »[29]. La Cour mobilise à cette fin la jurisprudence établie de la juridiction de Strasbourg avec une profondeur remarquable – ainsi qu’elle a pris l’habitude de l’accomplir dans des contentieux analogues[30]. En effet, les arrêts Przybyszewska de 2023, Formela de 2024 ou Andersen de 2025 avaient déjà condamné la Pologne pour avoir laissé les couples homosexuels dans un flottement juridique persistant, les laissant dans une zone d’incertitude incompatible avec les exigences de l’article 8 de la Convention[31]. En se plaçant dans ce sillage, la CJUE donne le sentiment d’une condamnation « à double détente » : tant au regard de la Convention que du droit de l’Union, via une application tout particulièrement généreuse[32] de la clause de correspondance de l’article 52 § 4 de la Charte[33].
Cependant, la Cour prend soin de nuancer sa position. Elle ne transforme pas l’UE en « législateur » du statut personnel : elle n’impose pas, comme l’avouait plus nettement l’avocat général J.-R. de la Tour, la consécration du mariage aux couples de même sexe dans les droits nationaux. Les États conservent une marge de manœuvre[34] quant aux procédures internes de reconnaissance[35]. Cependant, cette marge a certaines limites : elle ne peut conduire à rendre la reconnaissance impossible, ou encore excessivement difficile, ni à instaurer une discrimination directe ou indirecte. Pour ces raisons, en Pologne, où la transcription constitue l’unique voie permettant de reconnaître un mariage conclu dans un autre État, celle-ci doit être appliquée sans distinction aux couples de même sexe[36].
4°) Le « cheval de Troie » de l’égalité : citoyenneté de l’Union, non-discrimination et émergence d’un statut familial européen minimal
Somme toute, par cet arrêt la Cour de justice impose aux États membres une obligation jusque-là affleurante : reconnaître le mariage entre deux citoyens de l’UE de même sexe régulièrement conclu dans un autre État membre lorsque ces citoyens exercent leur liberté de circulation, même si le droit interne n’admet pas lui-même une telle union. Cette conclusion pouvait apparaître prévisible au regard de la jurisprudence la plus récente et des conclusions de l’avocat général. Pourtant, une lecture attentive dévoile un apport significatif : l’irruption de l’article 21 § 1 de la Charte dans le cœur du raisonnement. Pour la première fois dans un contentieux impliquant des citoyens européens LGBTIQ+ en situation de mobilité, la Grande chambre ne fonde pas seulement sa décision sur les dispositions du TFUE relatives à la libre circulation : elle mobilise, de façon expresse, le droit à la non-discrimination comme fondement autonome et coextensif de la sauvegarde. Le déplacement peut sembler anecdotique, mais il est probablement significatif. Il confirme un mouvement engagé depuis au moins 2024[37] : celui par lequel la CJUE explore d’autres voies juridiques, d’autres ancrages normatifs, pour élaborer une protection plus complexe – on pourrait dire même composite[38] – des droits fondamentaux des citoyens LGBTIQ+. À travers cette nouvelle affaire, la Cour dessine davantage encore les contours d’une compréhension plus inclusive du droit de l’Union, dans laquelle, avoue-t-elle, la libre circulation et l’égalité ne fonctionnent plus comme deux registres parallèles, mais comme deux leviers complémentaires, appelés à se renforcer, à se combiner, pour garantir l’effectivité et l’efficacité de ce « statut fondamental »[39] qu’est la citoyenneté de l’Union européenne.
Ce mouvement se saisit dès la question préjudicielle : les juges polonais avaient invité la CJUE à examiner la législation à la lumière des articles 20 et 21 du TFUE, lus conjointement avec les articles 7 et 21 de la Charte. La Cour choisit d’y entrer de plain-pied : elle confronte la loi polonaise à la fois au droit au respect de la vie privée et au droit à la non-discrimination, opérant une articulation nouvelle entre ces deux fondements. Mieux : alors que les arrêts Coman, Pancharevo ou Mirin n’avaient jamais intégré explicitement l’interdiction de la discrimination dans leur raisonnement – malgré une sollicitation insistante de la part des juges de renvoi –, la CJUE franchit ici une étape décisive. En effet, là où elle se fondait jusqu’alors exclusivement sur le droit au respect de la vie privée, l’approche embrassée dans l’arrêt Cupriak-Trojan au regard de l’article 21 § 1, de la Charte marque une véritable rupture. Celle-ci apparaît avec d’autant plus de limpidité que la CJUE articule désormais, d’une façon explicitement complémentaire, les droits au respect de la vie privée/familiale et à la non-discrimination, en assignant à chacun un rôle distinct dans la reconnaissance des mariages entre citoyens de même sexe dans le cadre de la libre circulation : tandis que l’article 7 de la Charte des droits exige que de tels mariages soient reconnus dans l’ensemble de l’Union au moyen de procédures adéquates[40], l’article 21 § 1, lui, garantit que ces mêmes procédures ne soient pas discriminatoires au regard de l’orientation sexuelle[41].
Mais l’audace la plus remarquable de cet arrêt réside peut-être ailleurs : dans l’affirmation, aussi explicite qu’inattendue, que l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle constitue, observait-on, un « principe général du droit de l’Union »[42]. La portée d’une telle qualification ne doit pas être sous-estimée. Jusqu’ici, depuis l’arrêt Mangold[43] ou Kücükdeveci[44], ce statut de principe général n’avait été reconnu que pour l’âge, puis pour la religion[45]. Étendre ce statut au principe de non-discrimination fondé sur l’orientation sexuelle constitue donc un saut qualitatif et normatif important. Certes, l’idée d’un tel principe avait déjà été effleurée – par la CJUE elle-même dans l’arrêt Römer[46] ou bien sous la plume de l’avocat général D. Ruiz-Jarabo Colomer dans ses conclusions sur l’affaire Tadao[47] –, mais sa reconnaissance explicite dans l’arrêt Cupriak-Trojan constitue une « première ». Elle l’est d’autant plus que le niveau de protection accordé à l’orientation sexuelle varie profondément d’un État membre à l’autre. Difficile donc, dans ces circonstances, de rattacher ce principe aux fameuses « traditions constitutionnelles communes »[48]. Cela n’avait pour autant pas empêché l’avocate générale T. Ćapeta, dans ses conclusions sur l’affaire Commission c. Hongrie[49], d’anticiper cela en disant que l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou le sexe est « fermement ancré[e] dans le cadre constitutionnel de l’Union. Il en est ainsi même si les questions liées aux LGBTI sont sensibles d’un point de vue sociétal »[50]. L’arrêt Cupriak-Trojan, en définitive, semble concrétiser cette intuition.
Ce geste cependant emporte des effets systémiques. En combinant les articles 20 et 21 TFUE avec l’article 21 § 1 de la Charte, la CJUE permet alors au droit à la non-discrimination de déployer son plein potentiel, bien au-delà du champ restreint de la directive 2000/78, limitée à l’emploi. Dès lors que le refus de reconnaître un mariage entre deux citoyens de l’UE entrave leur liberté de circulation, la Charte s’applique (au sens de son article 51 § 1) – et l’article 21 § 1 s’impose. Force est de reconnaître que la CJUE ouvre la voie à l’entrée de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans l’immense domaine du droit de la libre circulation, tant et si bien que les articles 20 et 21 du TFUE deviennent, comme le soufflait un auteur, un véritable « cheval de Troie »[51]. Du reste, cette stratégie permet, en sus, de cibler les conséquences proprement discriminatoires que les législations nationales infligent aux couples homosexuels mobiles, dans toutes les dimensions de leur existence. La démarche retenue par la Cour dans Cupriak-Trojan se dote, partant, d’une fonction hautement symbolique : elle dit quelque chose de ce que l’Europe entend protéger et des combats qu’elle entend continuer à mener dans les prochaines années.
Enfin, les conséquences normatives de cet arrêt Cupriak-Trojan sont, sans nul doute, importantes. Conformément à une jurisprudence bien établie, le principe général nouvellement reconnu de non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle – et, plus largement encore, l’article 21 § 1 de la Charte – se suffisent à eux-mêmes pour conférer des droits invocables aux particuliers, sans qu’il soit nécessaire de les préciser par d’autres normes nationales ou normes européennes. La Cour de justice l’énonce nettement : « tant les articles 20 et 21, paragraphe 1, TFUE que les articles 7 et 21, paragraphe 1, de la Charte se suffisent à eux-mêmes et ne doivent pas être précisés par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national pour conférer aux particuliers des droits invocables en tant que tels. Dès lors, si la juridiction de renvoi constatait qu’il n’est pas envisageable d’interpréter son droit national de manière conforme au droit de l’Union, elle serait tenue d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de ces dispositions et de garantir leur plein effet, en laissant au besoin inappliquées les dispositions nationales concernées »[52]. Autrement dit, la CJUE assume à présent ostensiblement qu’un principe général de non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, ou l’article 21 § 1 de la Charte, suffit à créer des droits subjectifs pleinement opposables[53], et cela sans relais législatif, y compris dans des litiges horizontaux entre particuliers[54]. Jusqu’alors, cette invocation horizontale n’avait été admise que dans le champ étroit de l’emploi, pour pallier l’absence d’effet direct horizontal de la directive 2000/78. L’arrêt Cupriak-Trojan, en un certain sens, étend ce régime dans un terrain autrement vaste : celui de la libre circulation. Et si l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle avait déjà irrigué certains litiges privés en matière d’emploi[55], son élévation au rang de principe général entrouvre désormais la voie à son application dans d’autres configurations et situations horizontales.
L’arrêt Cupriak-Trojan s’émancipe des limites de l’arrêt Coman[56]. Les États résistent : la Roumanie refuse toujours, sept ans après Coman, de modifier sa législation. La Cour sait pertinemment que les simples rappels de principe ne produisent plus d’effet. C’est pourquoi, nous semble-t-il, elle choisit de neutraliser expressément l’argument de l’identité nationale[57]. Et c’est pourquoi encore elle adopte une solution presque performative : maintenant, les autorités polonaises devront délivrer des actes de mariage mentionnant deux époux de même sexe, identiques en tous points à ceux délivrés aux couples hétérosexuels. Néanmoins, il faut le dire et le redire : la Cour ne crée pas un droit européen au mariage. Elle ne « fédère » – au sens le plus fédéraliste que peut recevoir ce mot – pas le droit de la famille. Elle impose seulement – et c’est déjà beaucoup[58] – qu’un État ne puisse ignorer un statut familial légalement acquis ailleurs lorsque ce refus porte atteinte à la vie privée et vie familiale, ainsi qu’au principe de non-discrimination. Et c’est dans cet interstice que se joue peut-être la transformation la plus profonde : l’esquisse d’un « statut familial européen minimal », encore fragile, mais désormais impossible à écarter sans édulcorer l’ambition même de l’UE : l’intégration, toujours, mais sans jamais oublier l’autonomie.
[1] T. Escach-Dubourg, « L’animal de compagnie devant la CJUE, ou la ruine de certaines catégories juridiques », Nuances du droit [En ligne], 2025.
[2] https://www.eunews.it/en/2025/11/25/eu-parliament-calls-for-sanctions-against-orban-hungary-has-turned-into-electoral-autocracy/
[3] H. Gaudin, « Le migrant et sa famille : Protection par un statut et/ou protection par les droits fondamentaux ? Remarques autour du citoyen de l’Union », in H. Fulchiron (dir.), La famille du migrant, LexisNexis, coll. “Perspective(s)”, Paris, 2020, pp. 155-166. Encore : H. Gaudin et L. Pailler, « Statut personnel du citoyen de l’Union : Une dernière fois sur son métier, la Cour de justice a-t-elle remis son ouvrage ? », D. 2025, p. 98.
[4] T. Escach-Dubourg, « Ce que la transidentité fait au droit de l’Union européenne », Nuances du droit [En ligne], 2025. Encore : T. Escach-Dubourg, « Trilogie jurisprudentielle sur la transidentité et reconfiguration du droit de l’Union », RTDEur. (à paraître).
[5] H. Gaudin, « Et si on parlait de l’abus de droit d’un État membre en matière de citoyenneté de l’Union ? (À propos de l’arrêt de la Cour de justice rendu en Grande Chambre, le 29 avril 2025, Commission c/Malte, dans l’affaire dite des Golden Passports) », L’Observateur de Bruxelles, n° 139, 2025, pp. 36-41.
[6] H. Gaudin, « Les droits fondamentaux constituent-ils un frein ou un moteur de l’intégration européenne ? – Propos conclusifs », in J. Andriantsimbazovian (dir.), Droits fondamentaux et intégration européenne : Bilan et perspectives de l’Union européenne, Mare & Martin, coll. “Horizons européens”, Paris, 2021, pp. 293-323, spéc. p. 319.
[7] CJUE [AP], 2 octobre 2003, Garcia Avello, aff. C-148/02 [pt. 42].
[8] Pour approfondir : H. Fulchiron (dir.), La famille du migrant, LexisNexis, coll. “Perspective(s)”, Paris, 2020.
[9] J.-R. de la Tour, « Conclusions présentées le 3 avril 2025 » [En ligne].
[10] Ce qui n’est pas sans rappeler la logique de certains arrêts : CJUE [GC], 8 mars 2011, Ruiz Zambrano, aff. C-34/09.
[11] J.-R. de la Tour, « Conclusions présentées le 3 avril 2025 », op. cit., [pt. 27 et pt. 42].
[12] Ibid. [pt. 30].
[13] Ibid. [pt. 32 et pts. 41-45].
[14] Ibid. [pt. 54].
[15] V. J.-Y. Carlier, « Vers un ordre public européen des droits fondamentaux – L’exemple de la reconnaissance des mariages de personnes de même sexe dans l’arrêt Coman », RTDH, n° 117, 2019, pp. 203-227.
[16] V. H. Gaudin et L. Pailler, « Statut personnel du citoyen de l’Union : Une dernière fois sur son métier, la Cour de justice a-t-elle remis son ouvrage ? », D. 2025, p. 98.
[17] J.-R. de la Tour, « Conclusions présentées le 3 avril 2025 », op. cit. [pt. 32].
[18] Ibid. [pt. 33].
[19] C’est là, d’ailleurs, un fait que rappelle généralement cet avocat général dans la plupart de ses conclusions. En atteste encore : Conclusions de J.-R. de la Tour rendues le 4 septembre 2025 à propos de l’affaire Shipov C-43/24 [pt. 90-99].
[20] J.-R. de la Tour, « Conclusions présentée le 3 avril 2025 », op. cit. [pt. 34 et pts. 48-53].
[21] V. T. Escach-Dubourg, « Au seuil du sens de l’identité constitutionnelle : Archéologie d’un concept et analyse de ses détournements récents », RUE (à paraître).
[22] Par exemple : Conclusions de J.-R. de la Tour présentées le 7 mai 2024, Mirin C-4/23 [pts. 87, 91 et 97]. Aussi : Conclusions de J.-R. de la Tour rendues le 4 septembre 2025 à propos de l’affaire Shipov [pts. 48-50].
[23] Ibid. [pt. 35].
[24] Ibid. [pt. 35].
[25] V. M. Glinel, « L’incompétence négative et la hiérarchisation des droits et libertés : L’apport de l’analyse quantitative », RDP, n° 2, 2024, pp. 64-73.
[26] CJUE [GC], 25 novembre 2025, Trojan, aff. C‑713/23 [pts. 39-45].
[27] Ibid. [pts. 51-54].
[28] Et l’on reviendra sur ce point dans quelques lignes.
[29] CJUE [GC], Trojan, op. cit. [pt. 70].
[30] CJUE [GC], 4 octobre 2024, Mirin, aff. C‑4/23 [pts. 63-67].
[31] CJUE [GC], Trojan, op. cit. [pt. 66].
[32] À tout le moins, si on la compare avec d’autres utilisations : CJUE [GC]17 décembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van Belgïë e. a. (CICB) e.a., aff. C-336/19 [pts. 56-57]
[33] R. Tinière, « La cohérence assurée par l’article 52 § 3 de la Charte des droits fondamentaux et l’Union. Le principe d’alignement sur le standard conventionnel pour les droits correspondants », in L. Coutron et C. Picheral (dir.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et Convention européenne des droits de l’Homme, Bruylant, coll. “Droit de la Convention européenne des droits de l’Homme”, Bruxelles, 2012, pp. 3-19, spéc. p. 3. Encore : H. Gaudin, Droit institutionnel de l’Union européenne, PUF, coll. “Droit fondamental – Manuels”, Paris, 2025, p. 157.
[34] À l’heure justement où cette question des « latitudes » est plus que jamais sous le feu des projecteurs et même que certains acteurs du droit de l’Union la convoquent avec une certaine énergie : T. Ćapeta, dans ses conclusions présentées le 30 octobre 2025, sous l’affaire non encore jugée João Filipe Ferreira da Silva e Brito e.a. c. État portugais (aff. C‑293/24), reconnaît que les juridictions nationales doivent disposer d’une liberté suffisante dans l’interprétation et l’application du droit de l’Union [pt. 93], mais aussi « que la crainte d’absence d’uniformité à laquelle des violations de l’obligation de renvoi préjudiciel pourraient donner lieu est exagérée » [pt. 95]. Elle conclue d’ailleurs ainsi : « si une juridiction statuant en dernier ressort fournit une explication raisonnable des raisons pour lesquelles elle a appliqué comme elle l’a fait le droit de l’Union, y compris la jurisprudence pertinente, et ce même si cette application est rétrospectivement considérée comme erronée, la décision de cette juridiction de ne pas saisir la Cour à titre préjudiciel peut être excusée et ne permet pas de conclure à l’existence d’une violation suffisamment caractérisée aux fins de la responsabilité de l’État » [pt. 107]. Encore : T. Ćapeta, rendues le 5 juin 2025, proposées à l’occasion de l’affaire Commission c. Hongrie (aff. C‑769/22) [pts. 203 et 208-209].
[35] CJUE [GC], Trojan, op. cit. [pt. 69].
[36] Ibid. [pt. 75].
[37] T. Escach-Dubourg, « Trilogie jurisprudentielle sur la transidentité et reconfiguration du droit de l’Union », RTDEur. (à paraître).
[38] Ibid.
[39] CJCE, 20 septembre 2001, Grzelczyk, aff. C-184/99 [pt. 31].
[40] CJUE [GC], Trojan, op. cit. [pts. 67-69].
[41] Ibid. [pt. 70].
[42] Ibid. [pt. 70].
[43] CJCE [GC], 22 novembre 2005, Mangold, aff. C-144/04.
[44] CJUE [GC], CJUE, 19 janvier 2010, Kücükdeveci, aff. C-555/07.
[45] CJUE [GC], 22 janvier 2019, Cresco Investigation, aff. C-193/17.
[46] CJUE [GC], 10 mai 2011, Jürgen Römer, aff. C-147/08 [pt. 60].
[47] Conclusions de M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 6 septembre 2007 (aff. C-267/06) [pt. 78].
[48] CJCE, 14 mai 1974, Nold, aff. 4-73.
[49] Conclusions de l’avocate générale T. Ćapeta, rendues le 5 juin 2025, proposées à l’occasion de l’affaire Commission c. Hongrie (aff. C‑769/22).
[50] Ibid. [pt. 263].
[51] K. Lamprinoudis, « The Trojan Horse of Free Movement Law: Unfolding Non-Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in “Trojan” », VerfBlog [En ligne], 2025.
[52] CJUE [GC], Trojan, op. cit. [pt. 76].
[53] Au sens de l’article 52 § 5 de la Charte. Pour approfondir : R. Tinière, « La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le juge national – Mode d’emploi », RDLF [En ligne], chron. n° 07, 2023.
[54] Pour une affaire assez emblématique : CJUE [GC], 15 janvier 2014, Association de médiation sociale, aff. C‑176/12.
[55] Par exemple : CJUE, 25 avril 2013, Asociaţia Accept, aff. C-81/12.
[56] CJUE [GC], 5 juin 2018, Coman, aff. C-673/16.
[57] CJUE [GC], Trojan, op. cit. [pt. 62].
[58] Dans une logique qui n’est pas sans rappeler, à certains égards, dans le sens et les effets de l’arrêt, celle qu’elle développait déjà dans l’affaire dite « Cassis de Dijon » : CJCE, 20 février 1979, Rewe-Zentral AG contre Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, aff. 120-78.