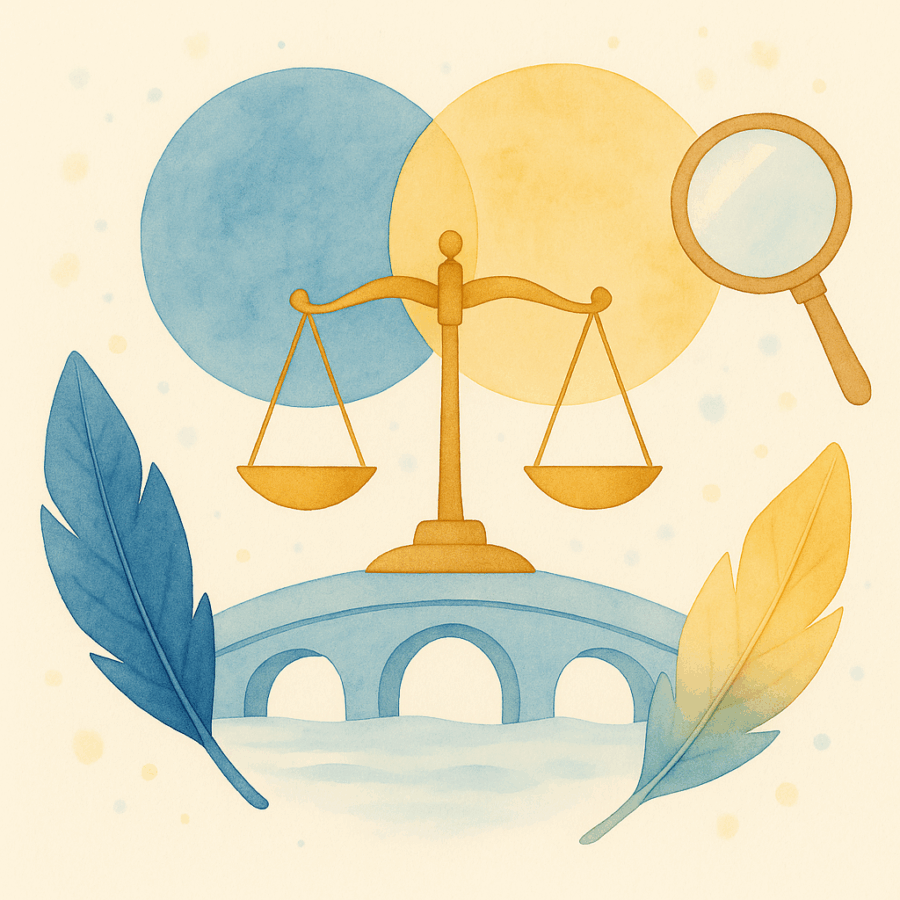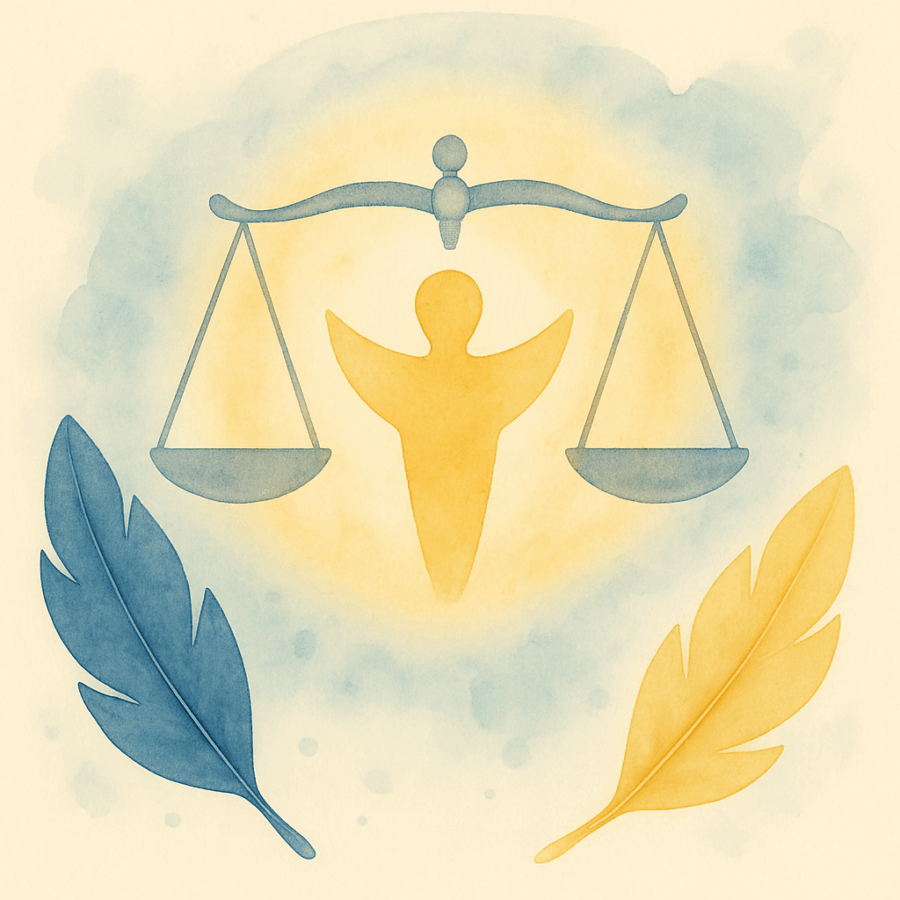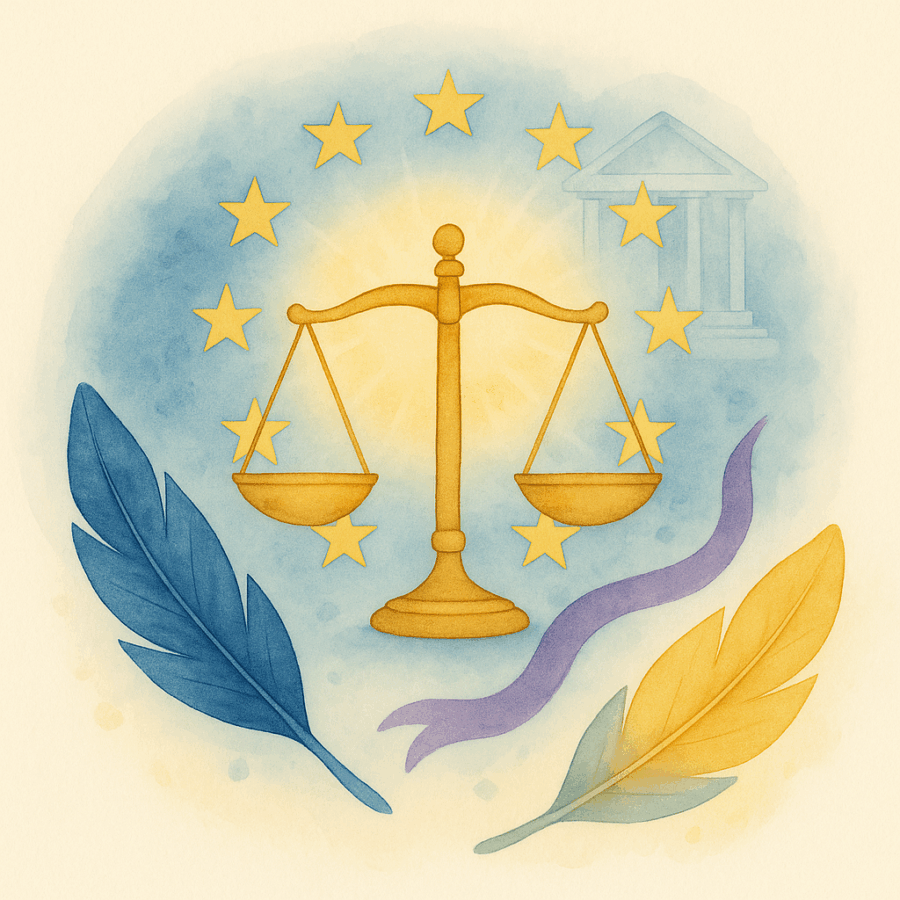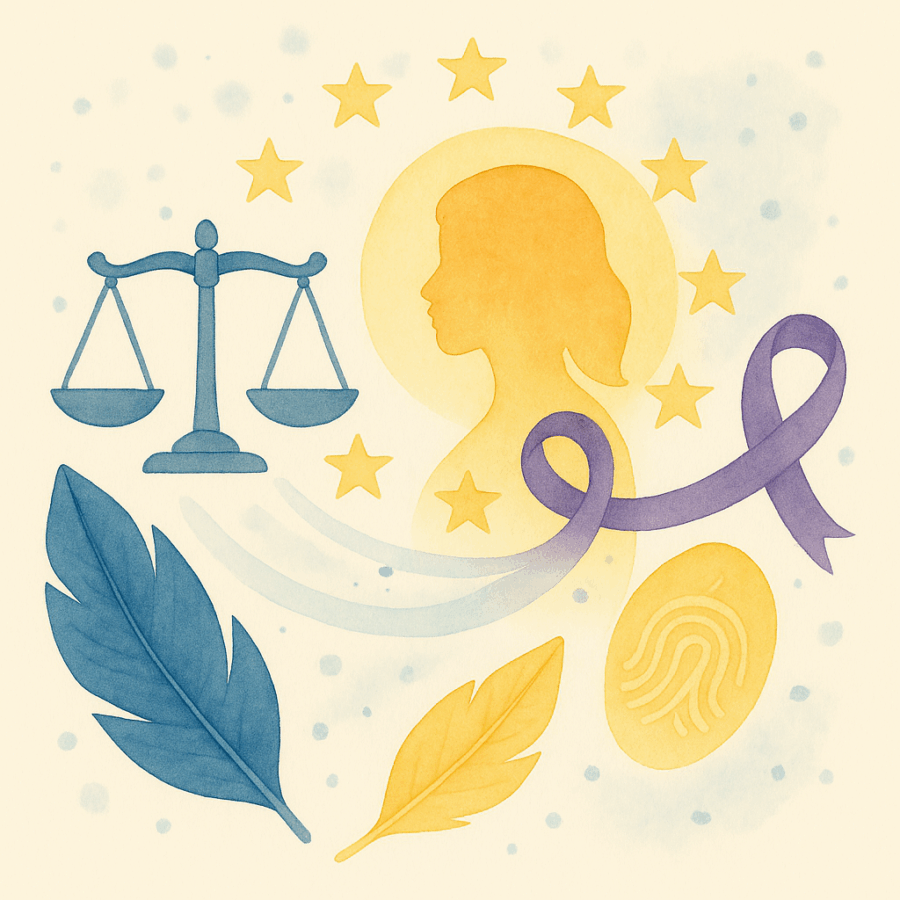L’accord UE-Mercosur suscite de nombreux débats au sein de la société française, si bien qu’il peut être avancé qu’une quasi-unanimité émerge au sein du spectre politique national contre cet accord. La principale critique concerne les éléments relevant de la politique commerciale commune. Ils viendraient créer une concurrence déloyale, en particulier pour les agriculteurs français.
Le mardi 18 novembre 2025, la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale a adopté, à l’unanimité, une résolution demandant au Président de la République de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)[1]. L’article 218§11 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) stipule : « un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les traités. En cas d’avis négatif de la Cour, l’accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités ». Par conséquent, le Président de la République française peut accéder à la demande des députés français et, au nom de la France, saisir la Cour de justice de l’accord UE-Mercosur pour avis.
Il existe plusieurs types d’accords internationaux. L’accord d’association (217 TFUE), pour lequel le Conseil a mandaté la Commission dans le cadre des discussions avec le Mercosur, en est une forme spécifique. Au moment de la ratification, si par principe le Conseil décide à la majorité qualifiée, il « statue à l’unanimité (…) pour les accords d’association » (218§8 TFUE), d’où l’importance cardinale de la qualification de l’accord UE-Mercosur.
De plus, les accords internationaux conclus par l’Union dépendent de la compétence à laquelle ils se rattachent. La jurisprudence AETR[2], par la suite confirmée par le traité[3] et par la Cour[4], a consacré le principe du parallélisme entre le volet interne et externe des compétences de l’Union. Un accord international intervenant dans un champ de compétence doit donc respecter la procédure applicable à ce champ, la typologie des compétences se répercutant sur la compétence externe de l’UE.
D’une part certains accords relèvent de la compétence exclusive de l’Union (article 3§2 TFUE), ci-après nommés « accords exclusifs ». Les institutions de l’Union ratifient alors l’accord selon la procédure afférente à l’article visé, sans déclencher de procédure de ratification dans les États membres. D’autre part, les accords mixtes concernent les accords pour lesquels l’UE n’exerce pas de compétence exclusive. Dans ce cas, l’Union ratifie les éléments qui relèvent de sa compétence et les États membres font de même dans leur champ d’intervention.
Qu’en est-il en ce qui concerne l’accord avec le Mercosur ? La Commission a eu recours à la pratique dite du splitting, à savoir la scission de l’accord en deux textes[5]. Le 3 septembre 2025, la Commission a donc transmis une proposition de décision du Conseil relative à la signature d’un accord intérimaire sur les éléments commerciaux (COM(2025) 338) et une relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de partenariat (COM(2025) 356). La Commission a, d’une part, requalifié l’accord d’association en accord de partenariat en y adjoignant des dispositions d’application provisoire et, d’autre part, proposé un texte distinct pour ce qu’elle considère comme relevant des compétences exclusives.
Dans un premier temps, il conviendra d’examiner les moyens qui pourraient être invoqués devant le juge de l’Union si la France le saisit pour avis, conformément à la résolution votée (I). Dans un second temps, les perspectives politiques d’échec de la ratification seront examinées (II).
I – Des griefs procéduraux nécessitant un avis de la Cour
Il ne sera question que des éléments institutionnels, le droit matériel étant laissé aux spécialistes des différents champs couverts par cet accord. Après avoir rapidement évoqué la subsidiarité (A) et la coopération loyale (B), il conviendra de développer particulièrement la question du choix de base légale (C).
A) Un moyen tiré du principe de subsidiarité inopérant en ce qui concerne la politique commerciale commune
Les pages 42 à 45 du rapport Ruffin[6] font état d’oppositions nationales à l’encontre de cet accord, en réalisant un détour par la question des parlements nationaux. Cela fait immédiatement penser au principe de subsidiarité. Sur le plan juridique, même si la Cour a longtemps été hésitante à contrôler les atteintes à la subsidiarité, une intensification de son contrôle a pu être observée[7]. Aussi, la résolution proposée par François Ruffin n’apparaît pas dénuée d’intérêt.
Cependant, l’examen de la Cour ne pourra pas concerner les éléments relevant de la compétence exclusive de l’Union (5.3 TUE). La politique commerciale commune étant une compétence exclusive (article 3.1 TFUE), les stipulations s’y rattachant seront exclues du contrôle. Du fait de la scission en deux textes distincts, il semble difficile de faire échec à la ratification des stipulations relevant de la politique commerciale commune par ce biais. En revanche, les moyens tirés du principe de coopération loyale semblent plus convaincants.
B) Des moyens tirés du principe de coopération loyale plus convaincants
Ce principe, d’abord jurisprudentiel[8] puis textuel (4.3 TUE), a une acception verticale entre l’UE et les États qui la composent. Une application provisoire (218§5 TFUE) permettant de court-circuiter le processus de ratification au sein d’États membres opposés à l’accord pourrait être considérée comme contraire à ce principe. Ce recours aux dispositions provisoires avait par exemple été contesté par la Wallonie au moment du CETA[9] dont la position avait été expliquée par son Ministre-Président[10]. L’application provisoire est censée avoir pour but d’attendre le processus de ratification dans les États membres et non le vider de son essence.
La coopération loyale s’applique également entre les institutions de l’UE de manière horizontale[11]. Le professeur de Sadeleer, cité par le rapport Ruffin, considère que le passage « tactique » d’un accord d’association à deux textes consiste en une violation du mandat donné par le Conseil à la Commission. En effet, le mandat concernait un accord d’association et non un accord de partenariat. A ce titre, le professeur considère que cela pose problème au regard de la coopération loyale, mais aussi de l’équilibre institutionnel. Examinons dès lors la question de la base légale, qui est, à bien des égards, liée au principe de l’équilibre institutionnel[12].
C) Des questionnements légitimes s’agissant des choix de bases légales
Rappelons la jurisprudence de la Cour en la matière. « Selon une jurisprudence constante, le choix de la base juridique d’un acte de l’Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel »[13]. En effet, « le contrôle de la base juridique d’un acte permet de vérifier la compétence de l’auteur de l’acte (…) et de vérifier si la procédure d’adoption de cet acte est entachée d’irrégularité (…) »[14]. Dès lors, tant en ce qui concerne le principe de l’équilibre institutionnel que le principe d’attribution, « le choix de la base juridique appropriée revêt en effet une importance de nature constitutionnelle »[15]. Par conséquent, le moyen tiré d’une erreur dans le choix de la base légal est recevable devant la Cour. Il convient d’examiner la qualification de l’accord puis la question du cumul de bases légales.
La proposition de la Commission COM(2025)356 évoque un vote à la majorité qualifiée (p.3). Or, il pourrait être relevé qu’il s’agirait d’un accord d’association déguisé et non un accord de partenariat, nécessitant donc un vote à l’unanimité. En-dehors des aspects matériels qui pourraient éclairer ce questionnement, le mandat confié par le Conseil à la Commission concernait un accord d’association et non un accord de partenariat. Si la Cour estime qu’il s’agit d’un accord d’association déguisé, alors la base légale choisie n’est pas la bonne. Un moyen tiré de l’erreur de qualification de l’accord pourrait être retenu, et donc déclencher une ratification à l’unanimité.
En sus, le choix du cumul de bases légales dans la proposition de la Commission COM(2025)338 relative à l’accord intérimaire est étonnant. Elle se fonde les articles 91, 100.2 (transports), 207.4 (politique commerciale commune), 209.2 et 212 du TFUE (coopération avec les pays tiers et aide humanitaire).
Le cumul est autorisé par la Cour de façon exceptionnelle. « Si l’examen d’un acte communautaire démontre qu’il poursuit une double finalité ou qu’il a une double composante et si l’une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, l’acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou composante principale ou prépondérante (…). À titre exceptionnel, s’il est établi que l’acte poursuit à la fois plusieurs objectifs, qui sont liés d’une façon indissociable, sans que l’un soit second et indirect par rapport à l’autre, un tel acte devra être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes (…). Toutefois, le cumul de deux bases juridiques est exclu lorsque les procédures prévues pour l’une et l’autre base juridique sont incompatibles (…) »[16].
Les procédures ne semblent pas incompatibles puisque les cinq bases légales font référence à la procédure législative ordinaire. Il est quelques différences facilement dépassables. Par exemple, les articles relatifs aux transports évoquent une consultation des comités économique et social et des régions, contrairement aux autres articles. Cela étant, ces comités, au rôle uniquement consultatif (article 13.4 TUE), ne sont pas considérés comme des institutions par la Cour[17]. Dans la mesure où les consultations ne sont que facultatives dans les cas où elles ne sont pas prévues par le traité[18], une telle consultation pour les articles n’en faisant pas mention ne saurait être interprétée comme un détournement de procédure.
En revanche, ce cumul pose question au regard de la volonté d’isoler les éléments relevant de la politique commerciale commune. Les transports relèvent en principe des compétences partagées (4.2 TFUE) de même que la coopération au développement et l’aide humanitaire (4.4 TFUE). Fonder le texte sur des bases légales se rapportant aux compétences partagées semble paradoxal avec le splitting. Maintenir le cumul de bases légales rattachées aux compétences exclusives et partagées pourrait engendrer une requalification de l’accord intérimaire en accord mixte, et donc nécessiter une ratification dans les Etats membres, ce qui serait incohérent avec le splitting réalisé par la Commission. Il est donc étonnant que la Commission n’ait pas tenté de démontrer que la politique commerciale commune était prépondérante, de façon à pouvoir se fonder sur le seul article 207.
La Commission explique, dans sa proposition que « conformément aux traités et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier son avis 2/15 sur l’accord de libre-échange UE-Singapour du 16 mai 2017, tous les domaines couverts par l’AIC relèveraient de la compétence externe exclusive de l’Union européenne ». Si la Cour a autorisé le rattachement des transports aux compétences exclusives dans l’avis 2/15, cela était lié au fait que l’accord portait sur « les marchés publics de service dans le domaine des transports »[19]. Il peut donc être considéré que la situation est différente, laissant la possibilité au juge de requalifier l’accord UE-Mercosur en accord mixte. Sans aller jusqu’à avancer que la Cour trancherait en ce sens, la question mérite d’être étudiée.
Plusieurs éléments incitent donc à penser que la demande d’avis formulée par la résolution parlementaire est tout sauf infondée. Il apparaît évident que le but des députés français est surtout de faire échec à l’accord UE-Mercosur. Le terrain politique peut également permettre d’arriver à cet objectif, avec une chance de succès au moins équivalente.
II – Des perspectives d’échec de ratification sur le terrain politique
La procédure liée à la subsidiarité ne semble pas la plus pertinente ici. La procédure dite des cartons est peu fonctionnelle. Elle est très difficile à engager et il est plus facile pour le Conseil de rejeter le texte au moment du vote final qu’après avoir été saisi par le biais de la procédure dite du « carton orange ». En effet, cette procédure aboutit à un vote du Conseil lui permettant de rejeter un texte à la majorité qualifiée… alors qu’une simple minorité de blocage suffit pour faire échec au même texte lors du vote final.
Concentrons-nous donc sur le vote final et la perspective d’une minorité de blocage. La majorité qualifiée est de 55% des États représentant 65% de l’UE quand la proposition émane de la Commission[20]. La minorité de blocage est donc de 45,01% des États membres ou d’un minimum de 4 États[21] représentant 35,01% de la population. Une abstention compte comme un vote contre[22]. La France est parmi les pays les plus peuplés (15,18 % de la population de l’UE si tous les États participent au vote). Dans l’hypothèse où la France ne voterait pas en faveur de ces textes, il ne resterait “que” 20% de la population à réunir au sein de trois États minimum.
D’autres États pourraient être tentés par une absence de soutien aux textes. Rappelons que la France n’est pas le seul État disposant d’une agriculture puissante. En 2023, le secteur agricole français a produit 95,78 milliards d’euros[23], mais les chiffres ne sont pas si éloignés en Allemagne (76,15), en Italie (72,96) et en Espagne (65,61). D’autres pays ayant un PIB nettement inférieur aux PIB français, allemand ou italien ont également un secteur agricole produisant plus de dix milliards par an[24]. Les chambres d’agriculture de République Tchèque, de Hongrie, de Slovaquie et de Pologne ont d’ailleurs rejeté cet accord.
Si la France parvient à convaincre n’importe lequel des quatre autres États les plus peuplés ainsi que quelques autres pays moins peuplés parmi ceux cités de ne pas voter en faveur de la ratification de l’accord, la minorité de blocage sera atteinte. Dans le cas d’un vote négatif ou d’une abstention de la France et de la Pologne, il manquera un nombre minimal de deux États représentant 11,63 % de l’UE. Ce chiffre est réduit à 9,11 % en cas de coalition France-Espagne, à 6,71 % en cas de coalition France-Italie et à seulement 1,02 % en cas de coalition France-Allemagne. Il convient également de noter que ces calculs sont réalisés dans le cas où tous les États participent au vote. Si un État ne participe pas au vote, le « cut » à atteindre est plus bas puisque le pourcentage de population par Etat est mécaniquement plus élevé. Une minorité de blocage peut tout à fait être réunie si la France ne vote pas en faveur du texte. Ainsi la bataille politique contre cet accord a-t-elle de réelles chances de succès au sein du Conseil si la France ne vote pas en sa faveur.
En conclusion, il peut être avancé que la bataille contre l’accord UE-Mercosur, jusqu’ici essentiellement concentrée sur le terrain politique, pourrait s’étendre au terrain juridictionnel. Pour reprendre une expression populaire, les opposants au Mercosur ajoutent ainsi une corde à leur arc.
[1]Dossier législatif : URL : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/empecher_ratification_accord_UE_Mercosur_saisine_CJUE_incompatibilite_accord_traites_europeens.
[2]CJCE, 31 mars 1971, AETR (22-70).
[3]TFUE, article 3.2 ; TFUE, articles 216 et suivants.
[4]CJUE, 24 juin 2014, Parlement / Conseil (C-658/11), pt.56 ; CJUE, 26 juillet 2017, Avis 1/15, Accord PNR.
[5]EU-Mercosur : Text of the agreement, site internet de la Commission européenne, Url : https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/mercosur/eu-mercosur-agreement/text-agreement_en?prefLang=fr.
[6]Rapport n°2116, 17e législature, URL : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/due/l17b2116_rapport-fond.
[7]BERTRAND B., Un principe politique saisi par le droit. La justiciabilité du principe de subsidiarité en droit de l’Union européenne, Revue trimestrielle de droit européen, 2012.
[8]CJCE, 1983, Luxembourg c. Parlement, C-230/81.
[9]BEAUD O., Le veto wallon contre le traité CETA : une leçon à méditer, JP Blog, 26 octobre 2016, URL : https://blog.juspoliticum.com/2016/10/26/le-veto-wallon-contre-le-traite-ceta-une-lecon-a-mediter/.
[10]Discours de Paul Magnette, ministre-Président de la Wallonie, 14 octobre 2016, URL : https://www.astrid-online.it/static/upload/magn/magnette_discorso_ceta_14_10_16.pdf.
[11]CJCE 1988 Grèce c. Conseil, aff 204/86 ; article 13.2 TUE.
[12]CJUE, 6 mai 2008, Parlement / Conseil (C-133/06), pt.57
[13]CJUE, 18 décembre 2014, Royaume-Uni / Conseil (C-81/13), pt. 36
[14]CJUE, 5 mars 2015, Ezz e.a. / Conseil (C-220/14 P) (pt. 42)
[15]Tribunal de l’UE, 9 décembre 2014, SP / Commission (T-472/09 et T-55/10), pt. 117.
[16]CJUE, 29 avril 2004, Commission / Conseil (C-338/01), pts. 54-58
[17]C.f. par exemple, CJUE, 4 octobre 2024, Lituanie / Parlement et Conseil (C-541/20 et C-555/20), pts. 901-905, 909.
[18]Tribunal de l’UE, 24 mars 1994, Air France / Commission (T-3/93), pt. 119.
[19]CJUE, 16 mai 2017, Avis 2/15 – Accord de libre-échange avec Singapour, pt. 224.
[20]TUE, article 16.4 et TFUE, article 238.2.
[21]TUE, article 16.4 et TFUE, article 238.3.
[22]Majorité qualifiée, site internet du Conseil, URL : https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/voting-system/qualified-majority/.
[23]https://www.touteleurope.eu/agriculture-et-peche/l-agriculture-europeenne-en-10-chiffres-cles/.
[24]Pays-Bas (41,46), Pologne (36,81), Roumanie (22,22), Grèce (14,25), Danemark (12,81), Portugal (12,23), Belgique (11,77), Hongrie (11,55), Irlande (11,3), Autriche (10,2).