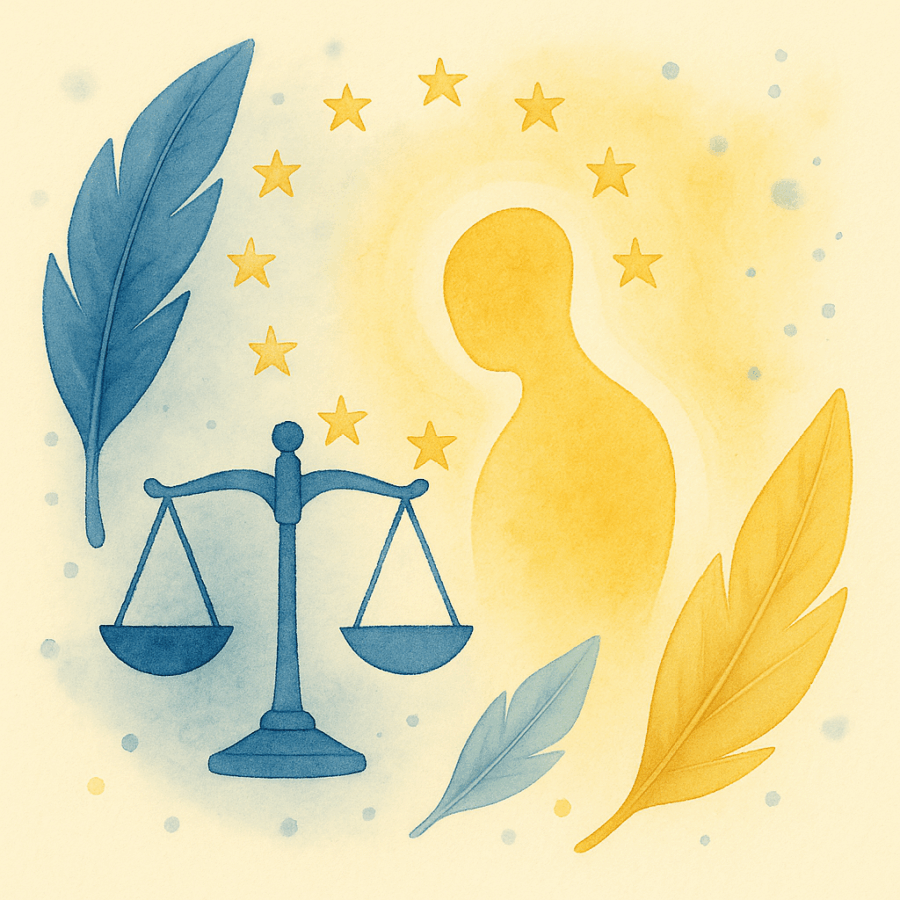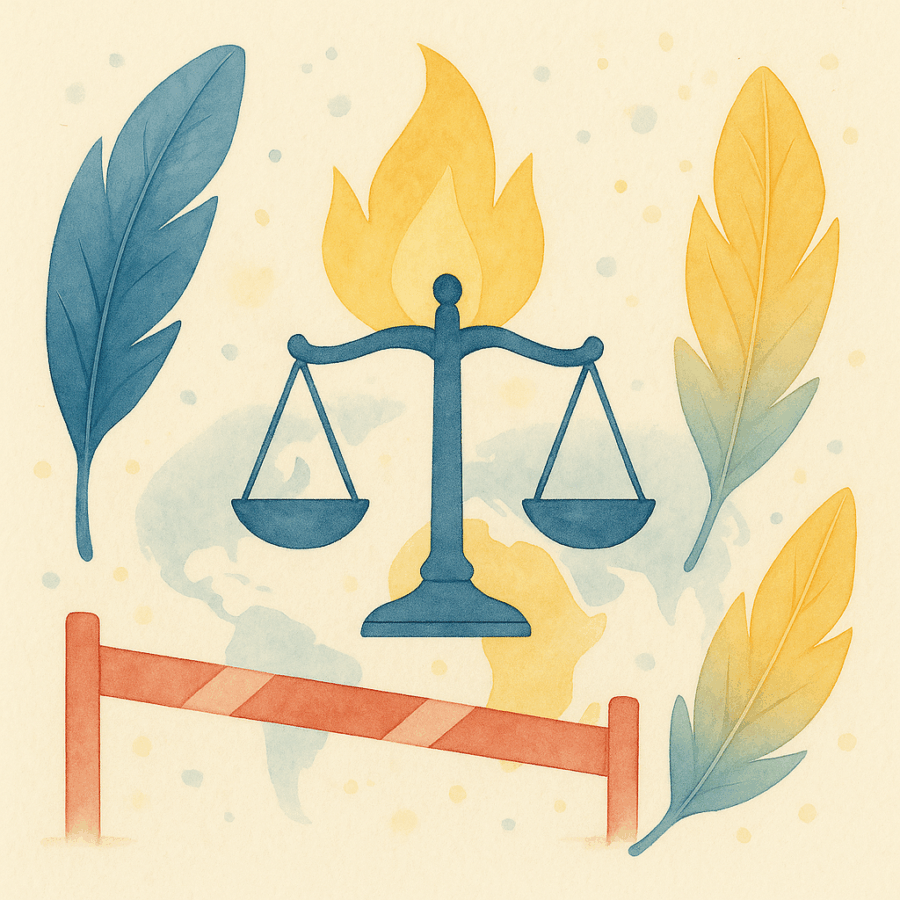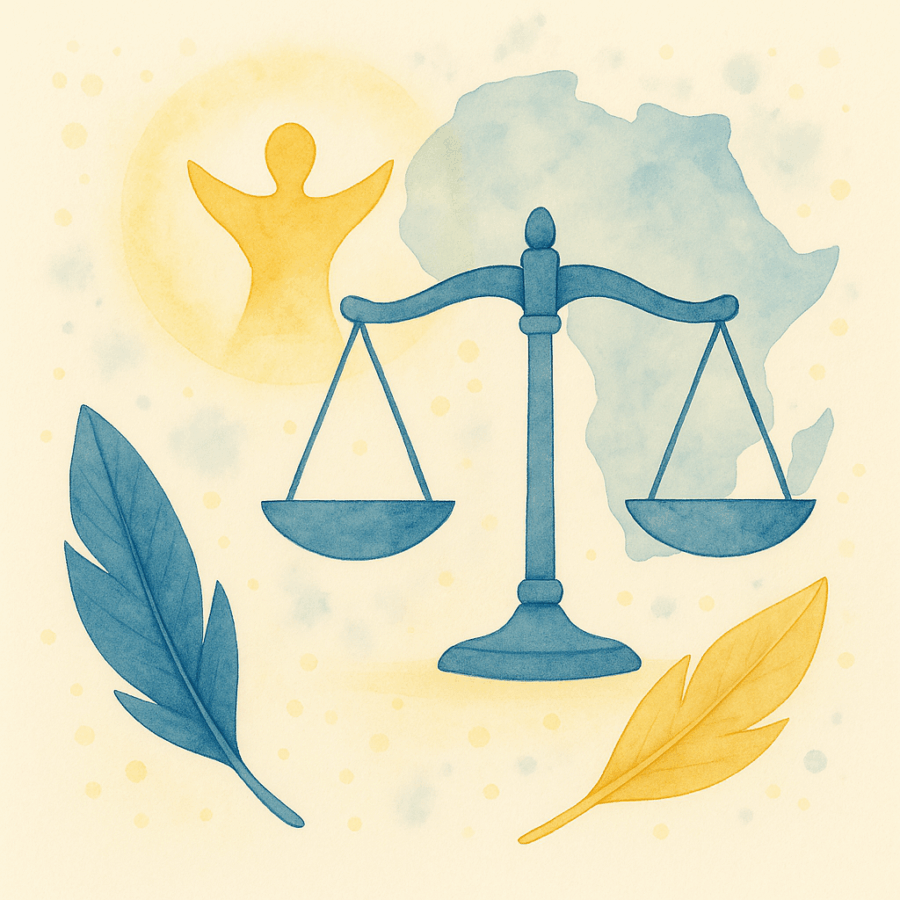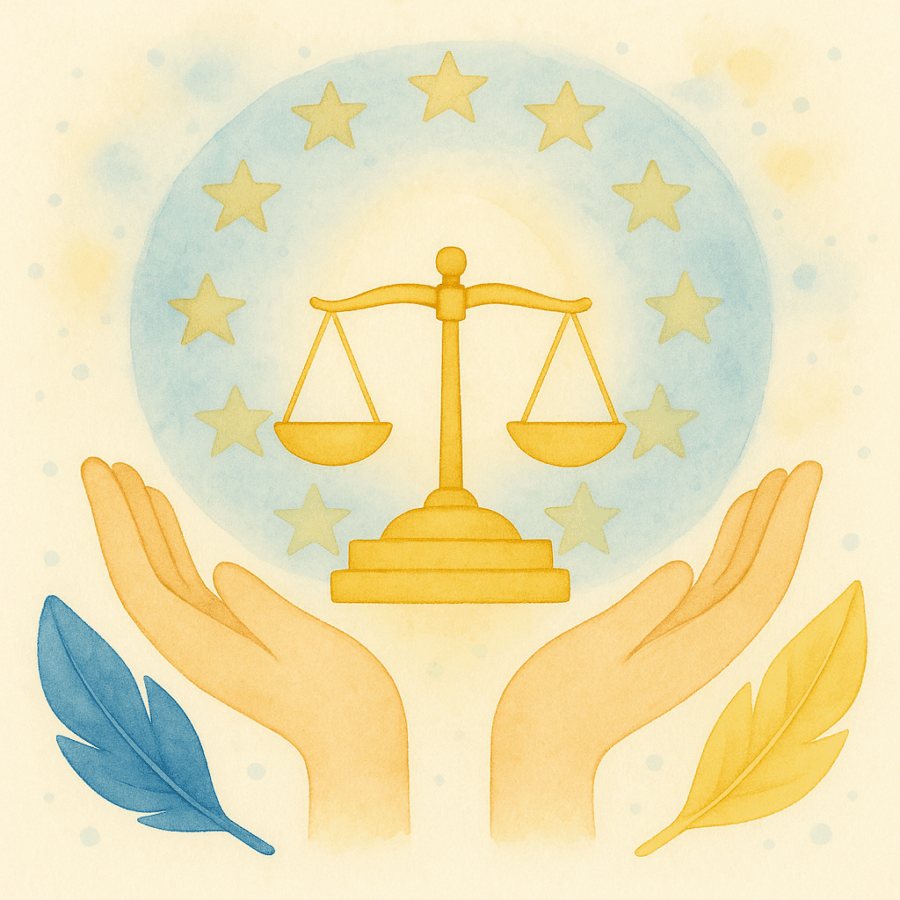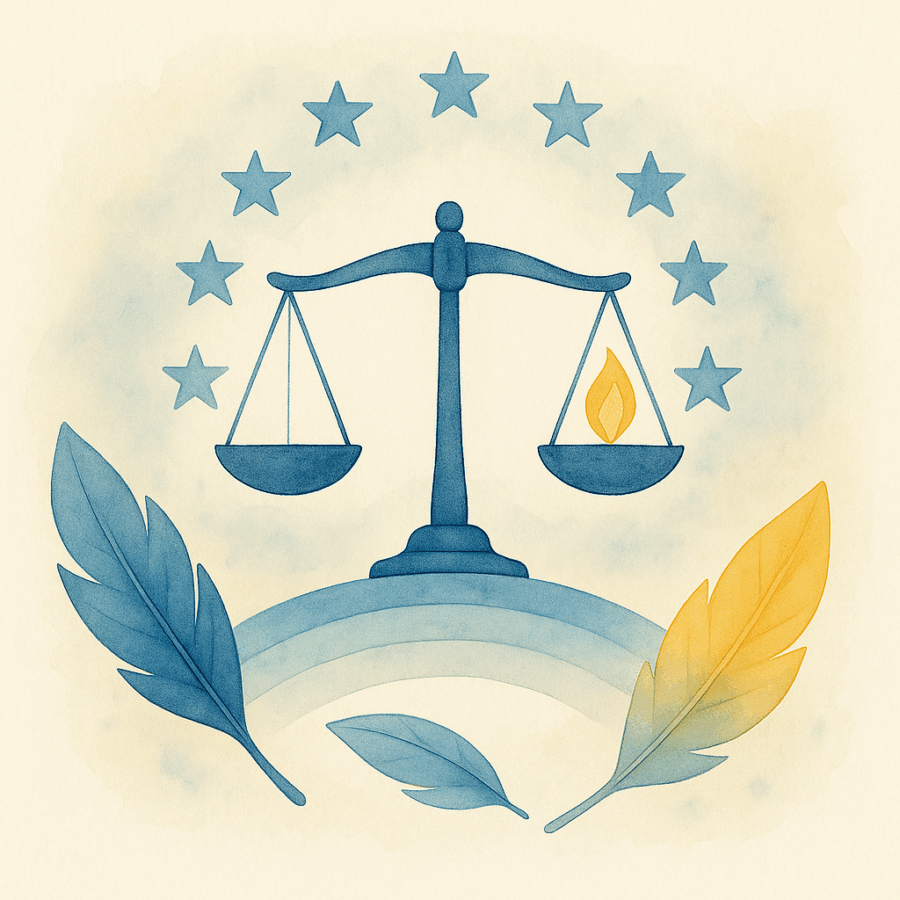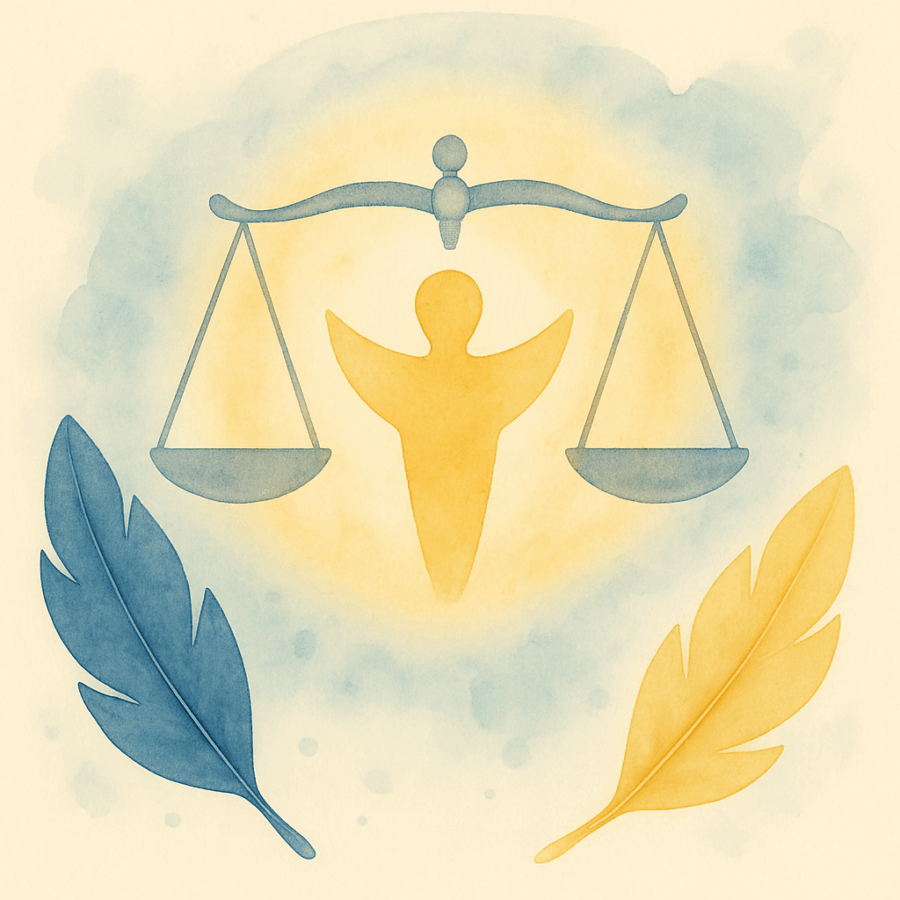Vers une protection intégrale des victimes de violences sexuelles par l’interprétation évolutive du principe de légalité : Trajectoire inauguré par l’arrêt S.W contre Royaume-Uni
Dans les sociétés démocratiques modernes, combattre les violences sexuelles devrait s’imposer comme une évidence juridique, éthique et politique. En effet, la complexité de ces infractions et leurs incidences profondes sur les victimes imposent au droit pénal une approche dynamique, consistant en son adaptation afin d’assurer une prise en charge plus juste et protectrice. C’est dans cette logique que s’inscrit l’interprétation évolutive par la CEDH du principe de légalité des délits et des peines consacré par l’article 7 de la Convention[1]. En respectant les exigences de sécurité juridique, notamment, de prévisibilité et de clarté du droit, cette conception souple favorise une évolution du droit pénal en adéquation avec les contextes sociaux et les attentes des victimes, respectivement dans les situations de violences sexuelles ou stéréotypes, inaction des autorités nationales et vides juridiques pouvant amplifier le préjudice subi[2]. En conséquence, contrairement à Papillon Salomé, pour qui « le retrait du droit pénal de la sphère de l’intime n’aura pas pour conséquence une explosion des comportements déviants », il convient de s’interroger sur la capacité de l’interprétation autonome de la CEDH à garantir une protection intégrale des victimes de violences sexuelles, sans porter atteinte à leurs droits fondamentaux ni à l’efficacité des systèmes pénaux nationaux[3]. Clairement, cette interprétation cherche à renforcer la protection des victimes, en allant d’une logique entre particuliers amorcée par l’arrêt S.W c/ Royaume-Uni (R.-U.) du 22 novembre 1995 (I) vers une prise en compte plus large et progressive des responsabilités institutionnelles (II).
§I – De la logique interindividuelle à la reconnaissance du viol conjugal : l’apport de l’arrêt S.W c/ Royaume-Uni
L’affermissement de la protection des individus en matière de violences sexuelles trouve son origine, il convient de le rappeler, dans la reconnaissance du viol conjugal par la CEDH, à travers l’affaire S.W., rendue à la suite d’une interprétation évolutive du principe de légalité (A). Cette dynamique s’est poursuivie par une extension définitionnelle du viol et des violences sexuelles, incluant également leur dimension psychologique (B).
A) La reconnaissance du viol conjugal par l’interprétation évolutive du principe de légalité
« Les meilleurs crimes sont domestiques », disait Alfred Hitchcock. En effet, dans le cadre conjugal, identifier la violence demeure particulièrement complexe, car cela implique une intrusion dans la sphère intime des individus, à rebours de l’approche traditionnelle dite « libérale » qui conçoit les droits de l’homme comme insusceptibles de toute ingérence étatique[4]. Toutefois, l’affaire S.W. marque un tournant majeur dans le droit européen des droits de l’homme, en consacrant la reconnaissance de nouvelles avancées jurisprudentielles internes en matière de protection contre le viol conjugal. Le requérant S.W., condamné pour viol conjugal au R.-U., a contesté cette décision devant la CEDH en invoquant une violation du principe de légalité des délits et des peines selon l’article 7 précité. À cette époque, la jurisprudence britannique connaissait une évolution majeure en abolissant l’immunité conjugale traditionnellement reconnue au sein du mariage, laquelle empêchait un conjoint de poursuivre l’autre pour viol. Le débat portait sur la question de savoir si cette mutation jurisprudentielle pouvait être considérée comme raisonnablement prévisible pour un justiciable. La CEDH a jugé que ce changement était raisonnablement prévisible et traduisait une véritable évolution sociojuridique. Elle a trouvé que la condamnation du requérant n’était pas incompatible avec l’article 7, dès lors qu’il pouvait anticiper le caractère pénalement répréhensible de son acte. La CEDH a ainsi consacré une interprétation évolutive du principe de légalité, adaptée aux exigences contemporaines de protection des droits fondamentaux. Véritablement, elle a reconnu la notion du viol conjugal en soulignant le caractère intrinsèquement avilissant du viol au regard d’une conception civilisée du mariage[5]. Ainsi, la dignité et l’intégrité physique des personnes ont été érigées en fondement de cette interprétation dynamique. Par cette décision, la CEDH consacre définitivement la levée de l’immunité conjugale et affirme que le mariage ne saurait constituer un espace d’exonération de responsabilité pénale pour les violences sexuelles[6].
B) L’élargissement jurisprudentiel du viol et des violences sexuelles à leur dimension psychologique
D’une part, dans le prolongement de l’arrêt S.W., l’affaire Aydin c/ Turquie, G.C., du 25 septembre 1997 a élargi la conception du viol et des violences sexuelles, y compris dans les contextes de guerre et de détention. La requérante, Mme Aysel Aydin, âgée de 17 ans, fut arrêtée en 1993 par les forces de sécurité turques lors d’une opération contre le PKK[7]. Elle affirma avoir été torturée, battue, violée et humiliée durant sa garde à vue, sans qu’aucune enquête effective ne soit menée par les juridictions nationales. Face à cette carence des recours internes, elle saisit la CEDH en invoquant la violation des articles 3, 13 et de l’ancien article 25 de la Convention. La CEDH constata la violation de toutes ces dispositions, reconnaissant notamment que la requérante avait été soumise à des actes de torture. Par conséquent, elle considéra que l’ensemble des actes de violence physique et psychologique subis par la requérante, ainsi que le viol, en raison de leur caractère cruel, relevaient de l’interdiction posée par l’article 3. La CEDH reprocha à l’État défendeur de n’avoir pas respecté son obligation positive de mener une enquête effective sur les allégations de torture. Par ailleurs, elle ne constata pas de violation du droit de recours individuel s’agissant des allégations de tentatives d’intimidation visant à obtenir le retrait de la plainte. L’arrêt Aydin marque un tournant jurisprudentiel en consacrant le viol comme une forme de torture prohibée par la Convention et en consolidant l’obligation des États de protéger les détenus, d’enquêter sur les violences sexuelles et d’assurer un accès effectif à la justice.
D’une autre part, dans la continuité de l’affaire S.W., l’arrêt M.C. c/ Bulgarie du 4 décembre 2003, consacre la reconnaissance du viol même en l’absence de résistance physique et impose aux États une obligation positive d’enquêter sur les violences sexuelles. La requérante, une jeune bulgare de 14 ans, affirma avoir été violée par deux hommes, mais son affaire fut classée sans suite faute de preuves de résistance physique. Devant la CEDH, elle invoqua la violation de l’interdiction des traitements inhumains et de son droit au respect de la vie privée, protégés par les articles 3 et 8 de la Convention. La CEDH jugea que l’État bulgare avait manqué à son obligation positive de protéger les droits de la requérante en menant une enquête insuffisante. Elle souligna que le raisonnement fondé sur des stéréotypes n’était pas en cause. Par ailleurs, elle affirma que le consentement est l’élément central dans l’examen du viol, indépendamment de toute résistance physique. Cet arrêt marque une avancée majeure en matière de lutte contre les violences sexuelles, en exigeant des enquêtes sérieuses et sensibles au vécu psychologique des victimes, tout en contribuant au démantèlement des préjugés sexistes dans l’analyse judiciaire du viol.
Cette évolution jurisprudentielle, de la protection contre les violences sexuelles entre particuliers, s’étend à la responsabilité institutionnelle en élargissant progressivement les obligations positives pour protéger les victimes.
§II – Vers une responsabilité institutionnelle accrue : l’élargissement progressif des obligations positives de protection des victimes
Sur ce plan, la CEDH consolide la protection en qualifiant de discrimination fondée sur le genre l’inaction des autorités nationales face aux violences conjugales (A). Cette approche s’élargit à la sanction de la victimisation secondaire des victimes de ces violences pouvant résulter des décisions judicaires ou des défaillances normatives (B).
A) La qualification de l’inaction face aux violences conjugales comme une discrimination fondée sur le genre
L’affaire Opuz c/ Turquie du 9 juin 2009 se distingue par l’intégration explicite de la lutte contre les stéréotypes sexistes dans l’analyse des violences sexuelles par la CEDH. De manière inédite, la CEDH « a condamné l’Etat pour défaut de protection à l’un de ses citoyens »[8]. La requérante, Nahilde Opuz, ainsi que sa mère, furent victimes de violences répétées de la part de son époux, sans bénéficier de mesures de protection adéquates malgré de nombreuses plaintes. Ce n’est qu’après le meurtre de sa mère en 2002 que l’auteur des violences fut condamné, révélant l’inaction prolongée des autorités nationales. La requérante saisit la CEDH en invoquant la violation des articles 2, 3 et 14 de la Convention, relatifs respectivement au droit à la vie, à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, ainsi qu’à l’interdiction de la discrimination. La CEDH constata que l’État turc avait manqué à son obligation de protéger la vie de la mère de la requérante, en dépit des signes avant-coureurs des violences. Elle qualifia cette inaction de traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention. Considérant que les violences domestiques affectent de manière disproportionnée les femmes, la CEDH établit qu’elles traduisent une discrimination systémique fondée sur le genre. L’arrêt Opuz marque ainsi une étape décisive en consacrant la dimension discriminatoire des violences domestiques et sexuelles. Ne s’appliquant pas qu’à la Turquie, cet arrêt impose aux États une obligation positive de prévenir, protéger et poursuivre les auteurs de violences domestiques[9]. Cette jurisprudence consolide la protection des victimes en érigeant la lutte contre les stéréotypes sexistes et l’inaction des autorités en violations des droits fondamentaux garantis par la Convention. Concrètement, il s’agissait d’éradiquer « les formes les plus graves d’atteinte à la vie » de victimes de violences domestiques par « l’obligation positive de pénaliser »[10].
B) La prise en compte juridique de la victimisation secondaire et des défaillances normatives en matière de violences sexuelles
Par l’arrêt J.L. c/ Italie du 27 mai 2021, la CEDH a condamné un État membre pour avoir contribué à la revictimisation d’une requérante en recourant à de stéréotypes sexistes dans les décisions judiciaires. La requérante, étudiante italienne, affirmait avoir été victime de violences sexuelles en réunion. Les juridictions italiennes ont toutefois acquitté les accusés en se fondant sur des considérations orales et des préjugés sexistes relatifs au comportement de la victime. Estimant avoir subi une victimisation secondaire en raison de formulations culpabilisantes et stigmatisantes, la requérante saisit la CEDH en invoquant une atteinte à son droit au respect de la vie privée et à son intégrité personnelle selon l’article 8 de la Convention. La CEDH accueillit ces prétentions et constata la violation de l’article 8, en reconnaissant l’existence de stéréotypes sexistes dans les jugements internes. La CEDH releva que cette approche révélait une insuffisance dans la protection des victimes contre la revictimisation judiciaire et rappela que les autorités nationales doivent leur assurer un traitement respectueux, exempt de stigmatisation et de jugements moralisateurs. Cet arrêt consolide la jurisprudence protectrice des victimes en sanctionnant l’usage de préjugés sexistes dans les procédures judiciaires. Il rappelle que le langage judiciaire peut avoir une incidence directe sur la vie privée et la dignité des victimes, et impose aux États une obligation de neutralité et de respect dans l’examen des contentieux liés aux violences sexuelles.
Dans la même dynamique, l’arrêt E.A. et Association européenne contre les violences faites au travail du 4 septembre 2025 condamne la France pour violations des articles 3 et 8 de la Convention, en raison de manquements à ses obligations tant substantielles que procédurales[11]. Pour la CEDH, le droit français privilégie la preuve de l’absence de consentement plutôt que son principe, alors que tout acte sexuel non consenti doit être sanctionné ; le consentement doit être libre, actuel, circonstancié et toujours révocable, aucun engagement passé, même écrit, ne pouvant le suppléer. Par ailleurs, les autorités françaises n’ont pas adopté ni appliqué de manière effective les dispositions nécessaires pour réprimer les actes sexuels non consentis, et n’ont donc pas satisfait à l’obligation d’enquête effective. En outre, la CEDH critique l’appréciation du consentement de la requérante par les juridictions françaises, jugeant inopérante son implication dans la rédaction du document et estimant que la cour d’appel de Nancy l’a exposée à une victimisation secondaire, de nature à dissuader les victimes de violences sexuelles de saisir la justice, concluant que les autorités nationales ont manqué à protéger sa dignité.
En définitive, l’arrêt S.W. inaugure une trajectoire jurisprudentielle vers une protection intégrale des victimes de violences sexuelles, en consacrant la reconnaissance du viol et en affirmant une responsabilité institutionnelle par l’élargissement progressif des obligations positives. Cette dynamique, renforcée par des décisions ultérieures telles qu’Aydin, M.C., Opuz, J.L. et E.A. et Association européenne contre les violences faites au travail, illustre la capacité de la CEDH à ériger le principe de légalité en instrument évolutif de protection. Elle ouvre désormais la voie à une réflexion sur des enjeux contemporains essentiels, tels que la lutte contre les violences sexuelles dans l’espace numérique, l’influence des mouvements sociaux comme #MeToo[12] ainsi que l’impératif d’une coopération internationale pour protéger efficacement les victimes.
[1] Par ailleurs, « (…) cette règle fondamentale du droit pénal qu’est le principe de légalité doit aujourd’hui également être lue à la lumière de la Convention européenne des droits de l’homme qui énonce dans son article 7 et dont l’impact en droit interne est le plus fort, grâce à la jurisprudence de la CEDH de Strasbourg ». C. AMBROISE-CASTÉROT, in J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, H. GAUDIN et al., Dictionnaire des droits de l’homme, PUF, coll. “Quadrige” Paris, 2008, p. 603.
[2] (…) « toute entreprise juridique, qu’elle soit législative, administrative ou juridictionnelle, est d’introduire une dose aussi forte que possible de sécurité, dispensant les sujets du droit d’appuyer leurs revendications sur le seul usage de la force et les garantissant du sort incertain de leurs armes ». J.P PUISSOCHET et H. LEGAL « Le principe de sécurité juridique dans la jurisprudence de la CEDH de justice des Communautés européennes », CCC, n° 11, 2001.
[3] S. PAPILLON, « La dignité, nouveau masque de la moralité en droit pénal », Cahiers Jean-Moulin, 4/2018. Consultable en ligne.
[4] V. MUTELET, « Le droit des violences conjugales : du bruit au retentissement », in Penser les violences conjugales comme un problème de société. F. VASSEUR-LAMBRY, (Ed.), Artois Presses Université, 2018, p.19, pp.19-65.
[5] S. HADDAD, « Le viol entre époux : évolution législative et jurisprudentielle », Lega Vox, 10 novembre 2010. Consultable en ligne.
[6] V. L. ROBERT, « Les femmes de barbe-bleue à Strasbourg-les violences à l’égard des femmes devant la Cour EDH », RDLF, Chron. n° 79, 2024. Consultable en ligne. Aussi, Fiches thématiques : Violence à l’égard des femmes et Violence domestique.
[7] Parti des travailleurs du Kurdistan.
[8] G. PERRIER, « Violence domestique : la Turquie condamnée à Strasbourg », Le Monde, 12 juin 2009. Consultable en ligne.
[9] Op.cit.
[10] J.-P. MARGUÉNAUD, D. ROETS, « Droits de l’homme : jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », RSCDPC, n° 1, 2010, pp. 219-243, spéc. p.220.
[11] V. M. DESPAUX, https://nuancesdudroit.fr/?p=1219 et A. DARSONVILLE, « Violences sexuelles : la CEDH condamne de nouveau la France », Le club des juristes, 12 septembre 2025. Consultable en ligne.
[12] C’est un mouvement social visant à favoriser la libération de la parole des femmes, afin de mettre en évidence la fréquence des viols et des agressions sexuelles, souvent sous-estimée, et d’offrir aux victimes un espace d’expression. Ce terme avait été utilisé dès 2007 par l’activiste Tarana Burke pour sensibiliser aux violences sexuelles dans les communautés marginalisées. Par ailleurs, c’est l’actrice Alyssa Milano qui l’a redynamisé. V. S. LE BARS, « Malgré des revers, la déferlante #Metoo a profondément changé l’Amérique », Le Monde, 5 octobre 2022. Consultable en ligne.
Par Grégoire BAKANDEJA MUKENGE
Docteur en Droit public à l’Université Toulouse Capitole