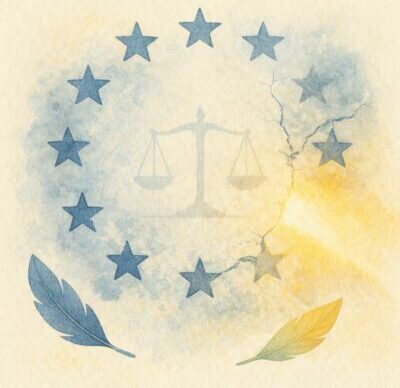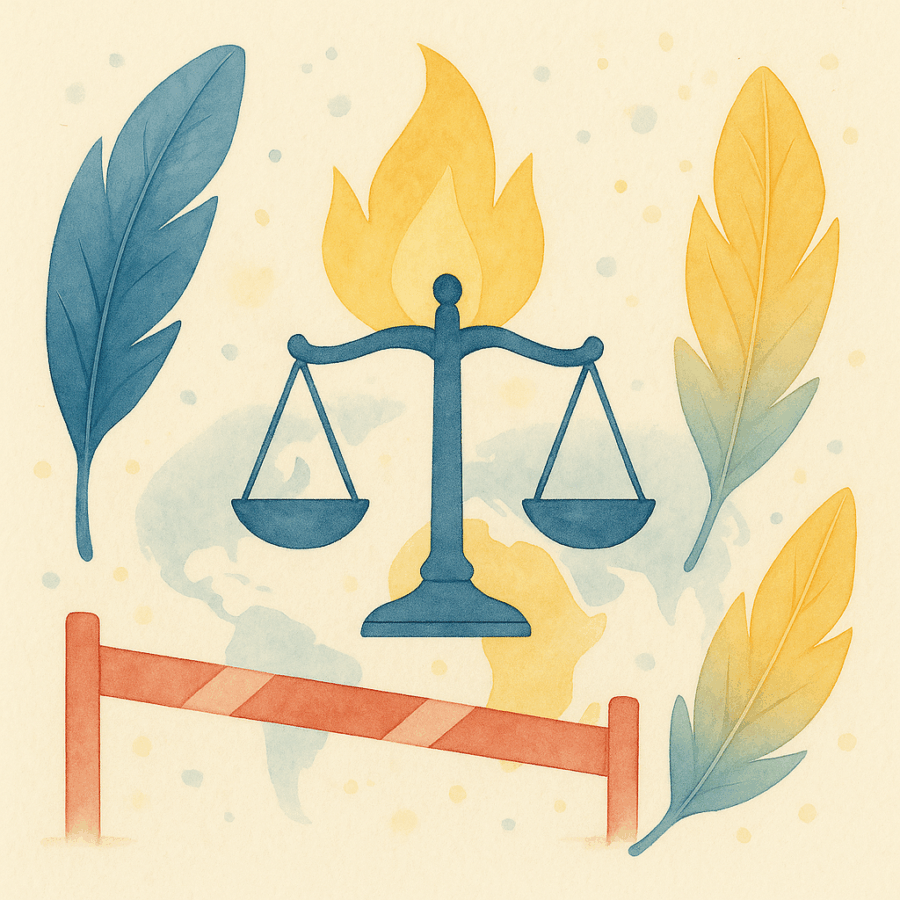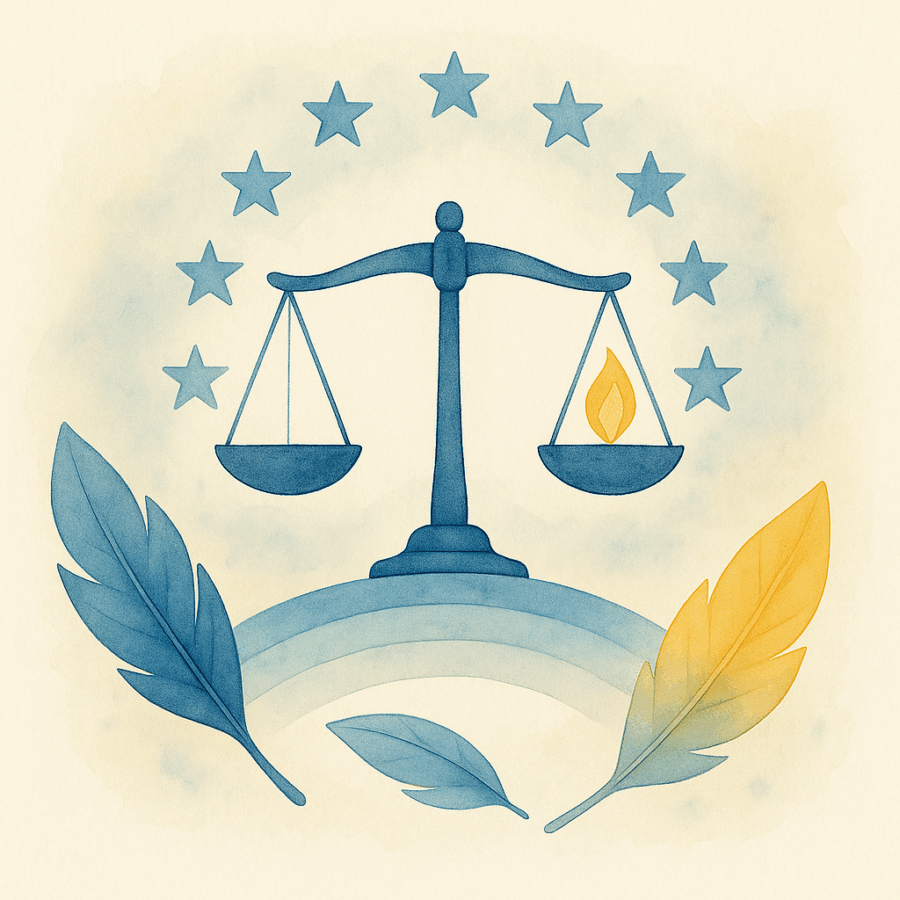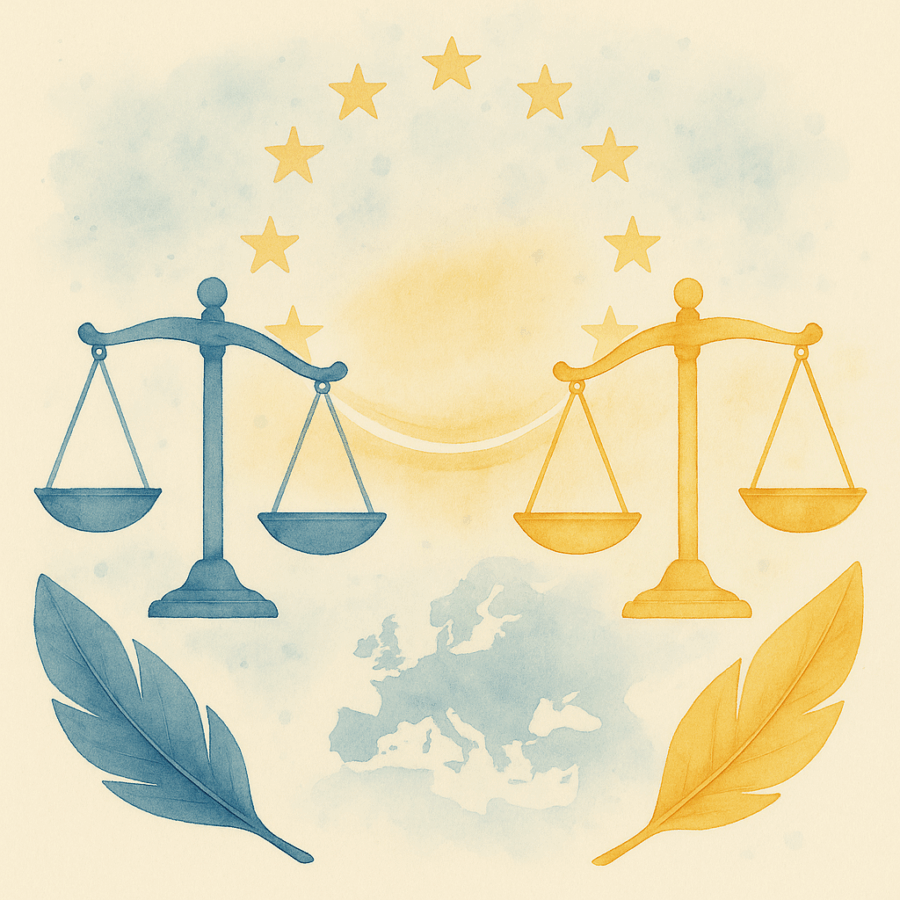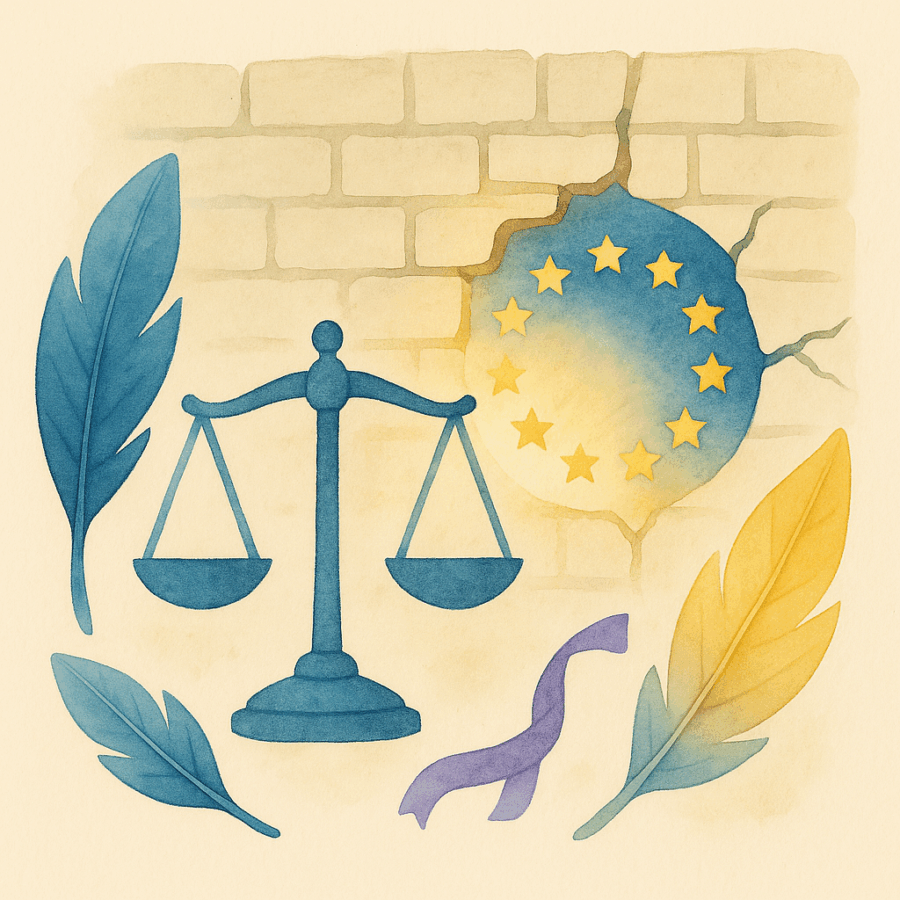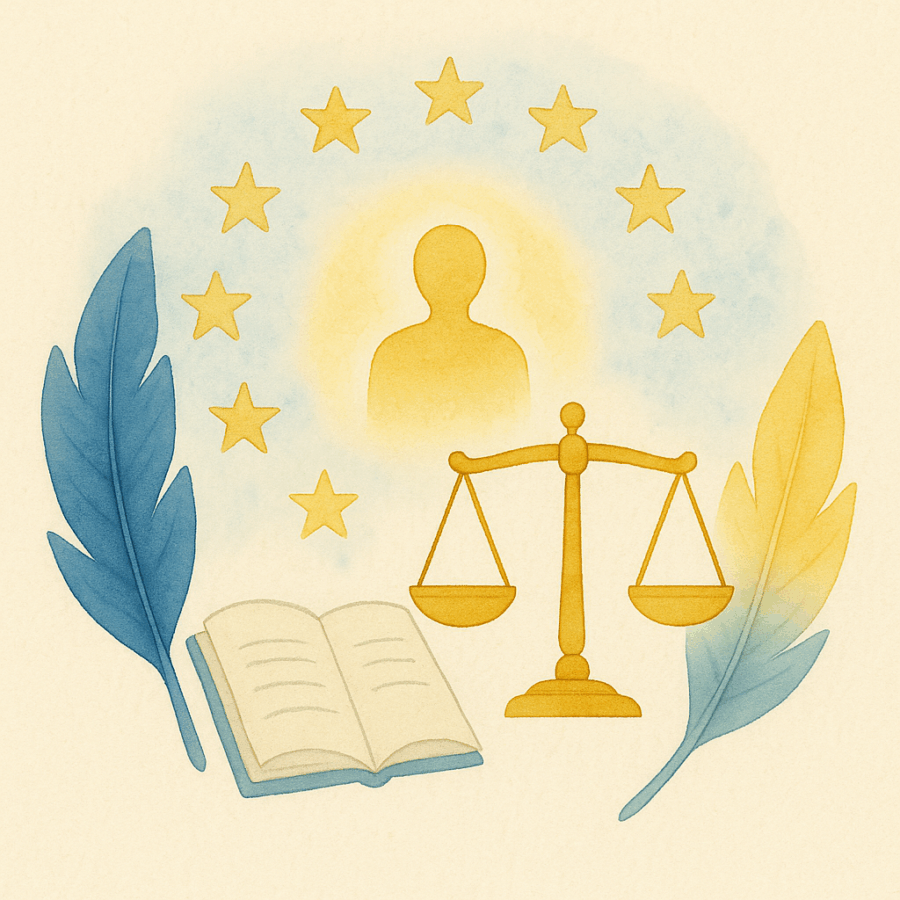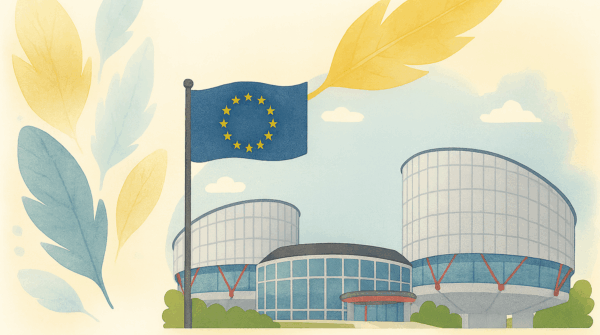Unité du droit de l’Union, autonomie de l’ordre juridique européen et responsabilité du juge national
§I – Textes normatifs de référence
Sources primaires du droit de l’Union
- Article 19 TUE
- Article 267 TFUE
§II – Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne
Avis
- CJUE [AP], 8 mars 2011, Avis 1/09.
- CJUE [AP], 18 décembre 2014, Avis 2/13.
Arrêts
- CJCE, 6 avril 1962, Bosch, Aff. 13/61.
- CJCE, 27 mars 1963, Da Costa, Aff. 28 à 30/62.
- CJCE, 1er déc. 1965, Firma G. Schwarze, Aff. 16/65.
- CJCE, 9 déc. 1965, Hessische Knappschaft, Aff. 44/65.
- CJCE, 16 janv. 1974, Rheinmülhen-Düsseldorf, Aff. 166/73.
- CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, Aff. 106/77.
- CJCE, 29 nov. 1978, Pigs Marketing Board, Aff. 83/78.
- CJCE, 13 mai 1981, International Chemical Corporation, Aff. 66/80.
- CJCE, 16 déc. 1981, Foglia c/Novello, Aff. 244/80.
- CJCE, 6 oct. 1982, Srl CILFIT et Lanificio di Gavardo SpA c/ Ministère de la Santé, Aff. 283/81.
- CJCE, 22 oct. 1987, Foto-Frost, Aff. 314/85.
- CJCE, 30 sept. 2003, Köbler, Aff. C-224/01.
- CJCE [GC], 6 déc. 2005, Gaston Schul Douane-Expediteur BV c/ Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Aff. C-461/03.
- CJUE [GC], 22 juin 2010, Aziz Melki et Sélim Abdeli, Aff. C-188 et 189/10.
- CJUE, 9 sept. 2015, Ferreira da Silva e Brito e.a., Aff. C-160/14.
- CJUE, 28 juill. 2016, Association France Nature Environnement, Aff. C-379/15.
- CJUE, GC, 27 fév. 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, aff. C‑64/16.
- CJUE [GC], 6 mars 2018, Achmea, aff. C-284/16.
- CJUE, 4 oct. 2018, Commission c/ France, Aff. C-416/17.
- CJUE [GC], 24 juin 2019, Commission c. Pologne, aff. C-619/18.
- CJUE [GC], 6 oct. 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, aff. C-561/19.
- CJUE [GC], 15 oct. 2024, KUBERA, aff. C-144/23.
- CJUE [GC], 18 déc. 2025, Commission européenne c. République de Pologne, aff. C-448/23.
§III – Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme
- CEDH, 17 janv. 1970, Delcourt c. Belgique, req. n° 2689/65.
- CEDH [déc.], 8 juin 1999, Predil Anstalt S.A. c. Italie, req. n° 31993/96.
- CEDH [déc.], 7 sept. 1999, Dotta c. Italie, req. n° 38399/97.
- CEDH, 22 juin 2000, Coëme et autres c. Belgique, req. n°s 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96.
- CEDH [déc.], 8 déc. 2009, Herma c. Allemagne, req. n° 54193/07.
- CEDH, 20 sept. 2011, Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique, req. n° 3989/07 et 38353/07.
- CEDH, 8 avril 2014, Dhahbi c. Italie, req. n° 17120/09.
- CEDH [GC], 23 mai 2016, Avotiņš c. Lettonie, req. n° 17502/07.
- CEDH, 13 fév. 2020, Sanofi Pasteur c. France, req. n° 25137/16.
- CEDH, 15 déc. 2022, Rutar et Rutar Marketing D.O.O. c. Slovénie, req. n° 21164/20.
- CEDH, 14 mars 2023, Géorgiou c. Grèce, req. n° 57378/18.
- CEDH, 16 déc. 2025, Gondert c. Allemagne, req. n° 34701/21.
Pour approfondir :
- Sur la fonction du juge national: Gaudin (dir.), M. Blanquet, J. Andriantsimbazovina, F. Fines, Les grands arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, Dalloz, ; D. Simon, Le système juridique de l’Union européenne, PUF, 2001, 780 p. ; O. Dubos, Les juridictions nationales, juge communautaire, Dalloz, coll. “Nouvelle bibliothèque des thèses”, Paris, 2001 ; J. Teyssedre, Le Conseil d’État, juge de droit commun du droit de l’Union européenne, LGDJ, coll. “Bibliothèque de droit international et de l’Union européenne”, Paris, 2022.
- Sur le renvoi préjudiciel: Coutron (dir.), L’obligation de renvoi préjudiciel à la Cour de justice : Une obligation sanctionnée ?, Bruylant, coll. “Droit de l’Union européenne”, Bruxelles, 2014 ; C. Vocanson, Le Conseil d’État français et le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne, Dalloz, coll. “Nouvelle Bibliothèque des Thèses”, Paris, 2014 ; M. Blanquet, Droit général de l’Union européenne, Sirey, Paris, 2018, pp. 827 et s. ; J. Wildemeersch, Contentieux de la légalité des actes de l’Union européenne : Le mythe du droit à un recours effectif, Bruylant, coll. “Droit de l’Union européenne”, Bruxelles, 2019 ; P de Lapasse et I. Guyon-Renard, « Le renvoi préjudiciel : Comment concrètement favoriser “le dialogue de juge à juge” ? », Revue justice actualités, n° 22, 2019, pp. 39-45 ; J. Pertek, Le renvoi préjudiciel : Droit, liberté ou obligation de coopération des juridictions nationales avec la CJUE, Bruylant, coll. “Droit de l’Union européenne”, Bruxelles, 2021 ; J. Teyssedre, « L’évolution des relations de la Cour justice et des juges nationaux à l’aune de la crise de l’État de droit », RDLF [En ligne], chron. n° 15, 2023 ; H. Gaudin, Droit institutionnel de l’Union européenne, PUF, coll. “Droit fondamental – Manuels”, Paris, 2025, pp. 287-288.
- Sur les arrêts présentés : Coutron, « L’arrêt Schul: Une occasion manquée de revisiter la jurisprudence Foto-Frost ? », RTDEu. 2007, pp. 491-511 ; F. Donnat, « La Cour de justice et la QPC : Chronique d’un arrêt prévisible et imprévu », D. 2010, pp. 1640-1647 ; D. Simon, « Responsabilité des États membres du fait des décisions de justice », Europe, nº 11, 2015, pp. 12-13 ; O. E. Torres, « Manquement à l’obligation de renvoi préjudiciel et l’interprétation incorrecte du droit de l’Union », blogdroiteuropeen.com. ; F.-V. Guiot, « La responsabilité des juridictions suprêmes dans le renvoi préjudiciel : With great(er) power, (at last) comes great responsibility ? », C.D.E., n° 2, 2016, pp. 575-630.
- Sur le rôle et les enjeux du renvoi préjudiciel : N. Lepoutre, « Le renvoi préjudiciel et l’instauration d’un dialogue des juges : Le cas de la Cour de justice de l’Union européenne et du juge administratif français », Jurisdoctoria n° 6, 2011 ; H. Gaudin, « Le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne, clé d’un ordre juridique en réseau ? » Revue générale du droit, 2019 ; H. Gaudin, « Quelle stratégie contentieuse de protection des droits fondamentaux devant le juge national en période de crise : Réflexe constitutionnel et réflexe européen ? », Revue générale du droit, 2020 ; H. Gaudin, « Poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne », Europe, 2020, p. 45 ; H. Gaudin, « Reconnaître un droit au renvoi préjudiciel dans l’ordre juridique de l’Union ? », Europe, n° 6, 2019, pp. 1-6 ; H. Gaudin, « Au-delà de l’unité vers le pluralisme », in H. Gaudin (dir.), Réseau de normes, réseau de juridictions : Le nouveau paradigme des droits fondamentaux en Europe, entre primauté et clause la plus protectrice, Mare & Martin, coll. “Horizons européens”, Paris, 2021, pp. 15-25 ; H. Gaudin, « Le renvoi préjudiciel ne serait donc pas un droit pour le justiciable ? À propos de l’arrêt du CE, 1er avril 2022, Kermadec», L’Observateur de Bruxelles, n° 129, 2022, pp. 40-44 ; H. Gaudin, « Procédure préjudicielle et droits des justiciables », in H. Gaudin (dir.), Justiciables et renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, Dalloz, coll. “Thèmes & commentaires”, Paris, 2025, pp. 3-9.
Le renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 du TFUE est souvent appréhendé comme un mécanisme de coopération juridictionnelle permettant à la Cour de garantir l’interprétation uniforme du droit de l’Union. Cette présentation, largement répandue dans les manuels et les commentaires, est exacte dans son principe, mais insuffisante dans ses implications. Elle tend à enfermer le mécanisme du renvoi préjudiciel dans une lecture purement fonctionnelle, comme s’il s’agissait d’un simple instrument technique destiné à résoudre ponctuellement des difficultés d’interprétation.
Or, le renvoi préjudiciel ne se contente pas d’assurer une fonction d’harmonisation. Il constitue l’un des dispositifs structurants de l’ordre juridique de l’Union, au sens le plus fort du terme. Il est le mécanisme par lequel un ordre juridique profondément décentralisé parvient à se maintenir comme ordre unitaire, autonome et cohérent, sans disposer d’une hiérarchie juridictionnelle complète comparable à celle d’un État. C’est précisément cette fonction structurante que la Cour de justice a consacrée lorsqu’elle a qualifié le renvoi préjudiciel de « clef de voûte du système juridictionnel de l’Union », notamment dans le célèbre avis 2/13. Cette qualification traduit l’idée que, sans le renvoi préjudiciel, l’édifice juridictionnel de l’UE perdrait son principe d’équilibre. L’unité du droit de l’Union serait menacée non par une contestation frontale, plutôt par une multiplication silencieuse d’interprétations nationales divergentes, chacune juridiquement défendable dans son contexte propre, mais incompatibles entre elles à l’échelle européenne. Le renvoi préjudiciel apparaît ainsi comme un instrument juridique pour atteindre l’unité dans la diversité. Il ne repose ni sur la centralisation du contentieux, ni sur une subordination hiérarchique des juridictions nationales, mais sur une méthode : le dialogue juridictionnel encadré par le droit. Cette méthode impose au juge national, lorsqu’il applique le droit de l’Union, non seulement de respecter des normes substantielles, mais aussi d’adopter une certaine attitude juridictionnelle face au doute, à l’incertitude et au désaccord.
C’est cette dimension, à la fois objective et subjective, que ce dossier se propose d’explorer. Objectivement, le renvoi préjudiciel garantit l’unité, la cohérence et l’autonomie du droit de l’Union. Subjectivement, il transforme l’office du juge national, en faisant de lui un acteur responsable du lien inter-juridictionnel européen, tenu soit de dialoguer avec la Cour, soit d’assumer pleinement, par une motivation rigoureuse, la décision de ne pas le faire.
§I – Les juridictions nationales comme juges de droit commun du droit de l’Union : le renvoi comme charnière structurelle
Le renvoi préjudiciel ne peut être compris qu’à partir d’une donnée fondamentale : le droit de l’Union est appliqué, pour l’essentiel, par les juridictions nationales. Cette caractéristique n’est pas accidentelle ; elle est constitutive de l’ordre juridique de l’Union. Contrairement à un État fédéral, l’Union européenne ne dispose pas d’un appareil juridictionnel complet et hiérarchisé chargé d’assurer, à tous les niveaux, l’application de son droit. Les juridictions de l’Union ont une compétence d’attribution ; le contentieux ordinaire du droit de l’Union se déploie donc devant les juges nationaux. Cette réalité explique la cardinalité de la formule, désormais classique, selon laquelle les juridictions nationales sont les juges de droit commun du droit de l’Union. Dès l’arrêt Van Gend en Loos, la Cour de justice affirme que le droit de l’UE constitue un nouvel ordre juridique dont les sujets sont non seulement les États membres, mais aussi les particuliers, et que ces derniers peuvent invoquer directement certaines normes devant les juridictions nationales. Cette affirmation implique corrélativement que ces juridictions sont investies d’une mission européenne : elles ne se contentent pas d’appliquer un droit “extérieur”, elles participent à la mise en œuvre d’un ordre juridique autonome.
Cette transformation de l’office du juge national est pleinement assumée dans l’arrêt Simmenthal. En imposant au juge national de laisser inappliquée toute norme nationale contraire au droit de l’Union, sans attendre son élimination par les voies internes, la Cour confère au juge national un rôle décisif dans la garantie de la primauté et de l’effectivité du droit de l’Union. Le juge national devient ainsi le point de contact immédiat entre l’ordre juridique européen et les situations juridiques internes. Mais cette décentralisation de l’application du droit de l’Union comporte un risque structurel évident : celui de la fragmentation interprétative. Si chaque juridiction nationale était libre de déterminer seule le sens et la portée du droit de l’Union, l’unité de cet ordre juridique serait rapidement compromise. Le droit de l’UE se dissoudrait dans une pluralité et une diversité d’interprétations nationales, chacune cohérente dans son propre système, mais incompatibles entre elles. C’est précisément pour conjurer ce risque que le renvoi préjudiciel intervient. Il ne remet pas en cause la compétence du juge national pour trancher le litige ; il ne constitue ni une voie de recours ni un mécanisme de dessaisissement. Il organise, tout au contraire, une répartition fonctionnelle des rôles : à la Cour revient l’interprétation authentique du droit de l’Union et le contrôle de la validité des actes ; au juge national revient l’application concrète de ce droit et la résolution du litige.
Le renvoi apparaît alors comme une « charnière »[1] : il permet à un ordre juridique sans hiérarchie de fonctionner malgré tout comme un ordre commun. Cette fonction explique que la Cour ait pu inlassablement qualifier le renvoi de « clef de voûte » du système juridictionnel de l’Union. Toucher au renvoi, c’est toucher à la capacité même de l’Union à se maintenir comme ordre juridique autonome.
§II – Les deux objets du renvoi préjudiciel : l’interprétation et la validité
L’article 267 TFUE distingue deux types de questions pouvant être soumises à la Cour de justice : les questions d’interprétation du droit de l’Union et les questions d’appréciation de la validité des actes de droit dérivé. Cette distinction, souvent présentée comme purement technique, révèle une distribution différenciée de l’autorité juridictionnelle au sein de l’ordre juridique de l’Union.
A) L’interprétation du droit de l’Union : unité sans hiérarchie, autorité sans rigidité
En matière d’interprétation, la logique du renvoi est celle de l’unité. La Cour de justice a constamment affirmé que la réponse donnée à titre préjudiciel s’impose au juge qui l’a sollicitée. Dans l’ordonnance Wünsche, elle précise que l’interprétation fournie lie la juridiction nationale avec une autorité comparable à celle de la chose jugée. Appliquer le droit de l’Union, pour le juge national, signifie donc l’appliquer tel qu’interprété par la Cour, comme elle l’a rappelé dans l’arrêt Kühne et Heitz.
Cette autorité est indispensable à l’unité du droit de l’Union. Sans elle, le renvoi préjudiciel serait privé d’« effet utile ». Mais cette unité ne se confond pas avec une rigidité interprétative. Dès l’arrêt Da Costa, la Cour admet que le juge national demeure libre de la saisir à nouveau d’une question déjà tranchée, notamment lorsque le contexte normatif ou jurisprudentiel a évolué. L’interprétation du droit de l’Union est ainsi conçue comme un processus continu, fondé sur la circulation des questions et des réponses. Le renvoi en interprétation réalise ainsi une unité dynamique, compatible avec l’évolution du droit de l’UE. Il ne crée pas un système de précédent rigide, mais un cadre commun dans lequel les interprétations peuvent se stabiliser, se préciser ou se corriger au fil du temps.
B) La validité du droit dérivé : objectivité de l’illégalité et centralisation du pouvoir de contrôle
En matière de validité, la logique du renvoi préjudiciel est sensiblement différente. L’illégalité d’un acte de l’Union présente un caractère objectif : elle ne saurait varier selon les États membres sans compromettre l’unité même de l’ordre juridique. C’est pourquoi la Cour a très tôt affirmé que la constatation de l’invalidité devait produire des effets dépassant le seul litige principal. En effet, dans l’arrêt International Chemical Corporation, la Cour précise que la constatation de l’invalidité n’entraîne pas l’annulation formelle de l’acte, mais impose à toutes les juridictions nationales de refuser son application et oblige les institutions de l’Union à en tirer les conséquences. Cette solution traduit une exigence de sécurité juridique et de cohérence systémique.
Cette logique est portée à son point culminant dans l’arrêt Foto-Frost. En interdisant aux juridictions nationales de constater elles-mêmes l’invalidité d’un acte de l’Union, la Cour se reconnaît un monopole sur le contrôle de validité. Cette solution est parfois critiquée pour son asymétrie théorique, dans la mesure où le juge national peut tenir un acte pour valide, mais non pour invalide. Mais cette asymétrie est, à la vérité, profondément logique : dire qu’un acte est invalide, c’est produire un effet potentiellement général, susceptible de déstabiliser l’ensemble de l’ordre juridique. Le contrôle de validité est donc centralisé par nécessité systémique.
§III – Recevabilité et pertinence du renvoi : dialogue inter-juridictionnel et coopération loyale
Le renvoi préjudiciel n’est pas une procédure automatique ni un instrument de consultation abstraite. Encore faut-il que la question posée soit recevable et pertinente. La Cour de justice l’a affirmé très tôt dans l’arrêt Pasquale Foglia c. Mariella Novello, dans lequel elle refuse de répondre à des questions construites artificiellement par les parties, en l’absence d’un authentique litige. Par cet arrêt, la Cour ne cherche pas à restreindre le dialogue juridictionnel, mais à en préserver la nature. Le renvoi préjudiciel est un instrument de coopération directe – comme la Cour le déclare dans l’avis 1/09 – destiné à résoudre des litiges réels, non un moyen de solliciter quelques avis consultatifs ou de contourner les voies de droit internes. Le contrôle de la pertinence vise ainsi à garantir la sincérité du dialogue inter-juridictionnel. Ce contrôle joue un rôle fondamental dans l’économie de l’article 267 TFUE. Il rappelle que le dialogue inter-juridictionnel suppose une responsabilité partagée : le juge national doit poser des questions utiles et ancrées dans le litige ; la Cour, de son côté, accepte de répondre dès lors que la question est nécessaire à la solution du différend. Le renvoi préjudiciel apparaît ainsi comme une coopération exigeante, fondée sur la loyauté et la rigueur, et non comme un simple mécanisme d’assistance.
§IV – L’obligation de renvoi, l’« acte clair » et la transformation du doute en responsabilité
La distinction opérée par l’énoncé de l’article 267 du TFUE entre les juridictions dont les décisions sont susceptibles de recours et celles qui statuent en dernier ressort confère une place centrale à la notion de doute. Si les juridictions inférieures disposent d’une faculté de renvoi, les juridictions suprêmes sont, en principe, obligées de saisir la Cour de justice dès lors qu’une question de droit de l’Union est nécessaire à la résolution d’un litige. Cette obligation n’est toutefois ni mécanique ni aveugle : elle est encadrée par une jurisprudence, qui a progressivement transformé l’obligation de renvoi en épreuve de responsabilité inter-juridictionnelle.
L’arrêt Cilfit constitue à cet égard le point de départ incontournable. En admettant que la juridiction suprême puisse s’abstenir de renvoyer lorsqu’il n’existe aucun doute raisonnable sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour de justice n’a pas ouvert un espace de liberté discrétionnaire ; elle a, au contraire, imposé une charge argumentative lourde. L’« acte clair » n’est pas une évidence subjective ni une intuition juridictionnelle : il doit résulter d’un raisonnement prenant en compte la dimension pluraliste du droit de l’Union, son insertion dans un système normatif autonome et son évolution constante. Cette exigence a longtemps été perçue comme théorique, voire irréaliste. Mais la jurisprudence ultérieure montre que la Cour n’a jamais renoncé à cette rigueur. Au contraire, elle l’a progressivement densifiée. Par exemple, dans l’arrêt Consorzio Italian Management, la Cour rappelle avec force que l’acte clair ne peut être invoqué de manière abstraite ou autoréférentielle. Le juge national ne peut se contenter d’affirmer qu’il n’éprouve aucun doute ; il doit être en mesure de prouver que l’absence de doute serait aussi partagée par les juridictions des autres États membres et par la Cour elle-même. L’arrêt Ferreira da Silva e Brito est également important. La Cour y introduit un critère particulièrement exigeant : l’existence de divergences jurisprudentielles ou de difficultés interprétatives persistantes rend, par elle-même, suspecte l’invocation de l’« acte clair ». Autrement dit, le doute n’est plus seulement subjectif ; il devient objectivable. Lorsqu’un domaine du droit de l’Union donne lieu à des interprétations divergentes ou à une incertitude manifeste, la juridiction suprême ne peut raisonnablement prétendre que la solution s’impose avec évidence.
À travers cette évolution, la Cour opère un déplacement subtil, mais décisif. Le cœur du contrôle ne porte plus exclusivement sur le respect formel de l’obligation de renvoi, mais sur la qualité du raisonnement juridictionnel. Le non-renvoi n’est plus un simple choix procédural : il devient une décision juridiquement – et symboliquement, comme en atteste l’arrêt Commission c. France – engageante, exposée à l’examen critique, tant au niveau européen qu’au niveau interne.
§V – Primauté « procéduralisée », autonomie de l’ordre juridique de l’Union et refus de contournement
Le mécanisme préjudiciel ne protège pas seulement l’unité interprétative et l’uniformité d’application du droit de l’Union ; il garantit aussi sa primauté et, plus largement, l’autonomie de l’ordre juridique européen. Cette dimension est essentielle, car elle révèle que l’article 267 TFUE ne se contente pas d’organiser une coopération ponctuelle entre juges, mais qu’il impose des exigences structurelles aux procédures nationales elles-mêmes. L’arrêt Melki et Abdeli constitue, à cet égard, un jalon fondamental. En reconnaissant qu’une procédure nationale de contrôle de constitutionnalité n’est compatible avec l’article 267 du TFUE que si elle ne fait pas obstacle à la faculté de saisir la Cour à tout moment, la Cour de justice affirme que le renvoi préjudiciel bénéficie d’une priorité fonctionnelle. Le juge national ne peut être enfermé dans des mécanismes procéduraux internes qui neutraliseraient, même temporairement, la possibilité du dialogue avec la Cour.
La portée de cette jurisprudence dépasse largement le cadre de la QPC. Elle consacre un principe général : le droit de l’Union ne se contente pas d’imposer des solutions matérielles ; il impose aussi des exigences procédurales minimales, destinées à garantir l’effectivité du renvoi préjudiciel. La primauté du droit de l’Union est, en un certain sens, indissociablement matérielle et procédurale. Cette exigence procédurale s’inscrit dans une logique plus large de protection de l’autonomie et de l’intégration de l’ordre juridique de l’Union. C’est la raison pour laquelle l’avis 2/13 insiste sur le rôle central du renvoi préjudiciel dans la préservation de cette autonomie. En permettant à la Cour de conserver le dernier mot sur l’interprétation du droit de l’Union, l’article 267 du TFUE empêche que ce droit soit interprété de manière définitive par des instances extérieures à l’ordre juridique de l’Union.
L’affaire Achmea prolonge cette logique dans un contexte original, celui de l’arbitrage d’investissement. En invalidant les mécanismes susceptibles de soustraire des litiges relevant du droit de l’Union au contrôle de la Cour, celle-ci affirme que le renvoi préjudiciel n’est pas une option parmi d’autres, mais un principe structurant auquel aucune justice parallèle ne peut se substituer. Le refus du renvoi préjudiciel ou son contournement apparaissent dès lors comme des atteintes directes à l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union.
§VI – La dimension subjective du renvoi préjudiciel : protection juridictionnelle effective, motivation et responsabilité
Si le renvoi préjudiciel répond à des exigences objectives d’unité, de cohérence et d’autonomie, il comporte également une dimension subjective de plus en plus affirmée. Cette dimension tient à la place des justiciables, au droit à un procès équitable et à la protection juridictionnelle effective. Longtemps, la Cour a rappelé que le renvoi préjudiciel ne constitue pas un droit subjectif des parties. Cette affirmation demeure exacte. Mais elle ne signifie pas que le refus de renvoi serait juridiquement indifférent. Au contraire, la jurisprudence récente tend à encadrer de plus en plus strictement les conditions dans lesquelles une juridiction suprême peut refuser de saisir la Cour. L’arrêt Kubera illustre tout spécialement cette évolution. En rattachant l’exigence de motivation du non-renvoi à l’article 47 de la Charte, la Cour impose à toutes les juridictions nationales un devoir minimal de justification. Lorsqu’une partie soulève sérieusement une difficulté d’interprétation du droit de l’UE, le juge ne peut se contenter d’un rejet implicite ou d’une motivation stéréotypée. Il doit expliquer, de manière intelligible, pourquoi les conditions du renvoi ne sont pas réunies.
Cette exigence ne transforme nullement le renvoi en droit subjectif, mais elle modifie profondément son régime. Même lorsqu’il n’est pas réalisé, dès lors qu’il a été soulevé par les justiciables, il doit être discuté et justifié. Le silence d’une juridiction nationale devient suspect ; la motivation devient une condition de légitimité. En arrière-plan de cette évolution se profile la question de la responsabilité. L’arrêt Köbler a consacré la possibilité d’engager la responsabilité de l’État du fait d’une violation du droit de l’UE imputable à une juridiction suprême. Sans réduire cette responsabilité au seul manquement à l’obligation de renvoi préjudiciel, il est évident que le refus injustifié de saisir la Cour de justice peut contribuer à caractériser une violation suffisamment caractérisée du droit de l’UE. La responsabilité ne joue donc pas seulement comme une sanction exceptionnelle ; elle exerce un effet normatif et politique plus diffus. Elle incite les juridictions suprêmes à intégrer pleinement le renvoi préjudiciel dans leur raisonnement, non comme une contrainte extérieure, mais comme une composante normale de leur office européen de juge de commun du droit de l’Union.
Conclusion – Le mécanisme du revoi préjudiciel comme discipline du doute et principe de la « confiance mutuelle » européenne
Au terme de ce dossier, le renvoi préjudiciel apparaît dans toute sa complexité. Il n’est ni une simple technique procédurale ni un mécanisme accessoire de coopération juridictionnelle. Il constitue le pivot de l’ordre juridique de l’Union européenne, à la croisée de l’unité normative, de l’autonomie juridictionnelle et de la responsabilité des juges nationaux. Objectivement (i), le renvoi garantit la singularité, l’unité et la cohérence du droit de l’Union dans un système profondément décentralisé. Il permet d’éviter que l’application du droit européen ne se fragmente en une pluralité de lectures nationales dissemblables. Subjectivement (ii), il transforme l’office du juge national, en faisant de lui un acteur responsable du dialogue inter-juridictionnel européen, tenu soit de saisir la Cour en cas de doute sérieux, soit d’assumer pleinement, par une motivation rigoureuse, la décision de ne pas le faire.
Le renvoi préjudiciel apparaît, au bout du compte, comme une façon de « discipliner le doute ». Il n’interdit ni les divergences interprétatives ni le pluralisme ; il interdit seulement que le doute soit résolu de manière solitaire, égotiste et silencieuse. En imposant que le doute soit exprimé, justifié ou déféré, l’article 267 TFUE inaugure une méthode de collaboration inter-juridictionnelle fondée sur la loyauté, la coopération et la responsabilité. C’est sans doute là que réside la force du mécanisme de renvoi préjudiciel. Dans un ordre juridique commun qui ne repose ni sur la centralisation ni sur la contrainte hiérarchique, l’unité ne peut être assurée que par l’adhésion à une méthode dialogique, délibérative. Le renvoi préjudiciel est le nom que porte cette méthode à la fois exigeante, indispensable et fragile.
[1] F. Martucci, Droit de l’Union européenne, Dalloz, coll. “Hypercours”, Paris, 2025, p. 702.