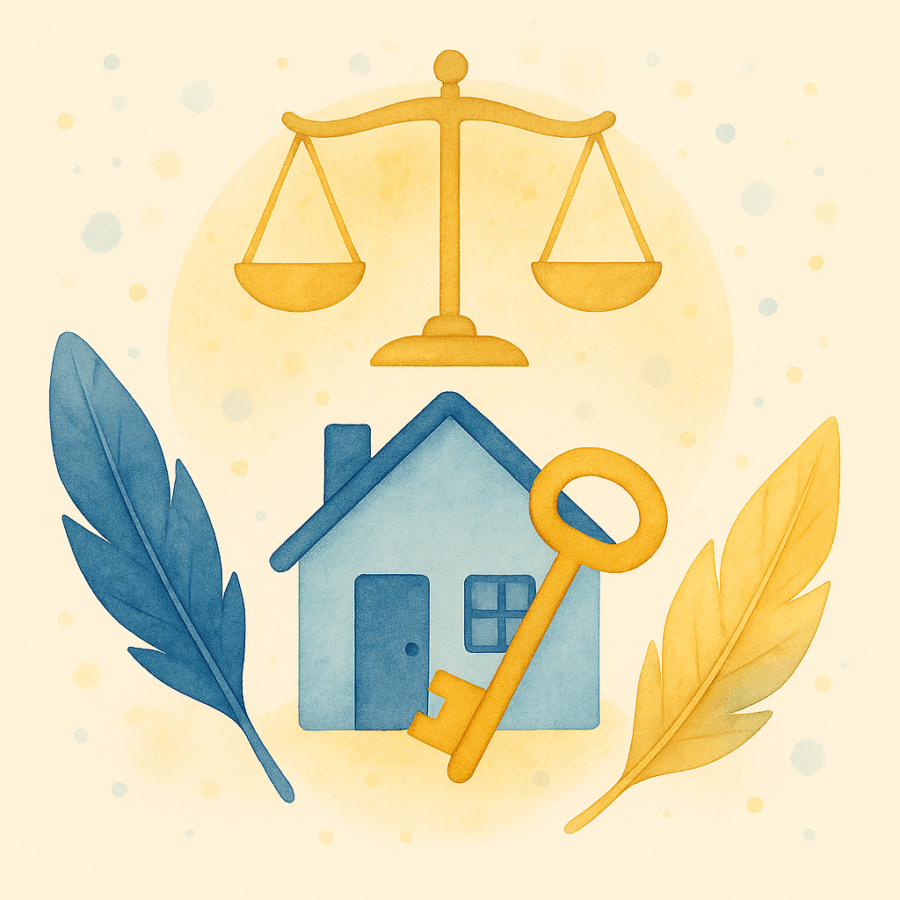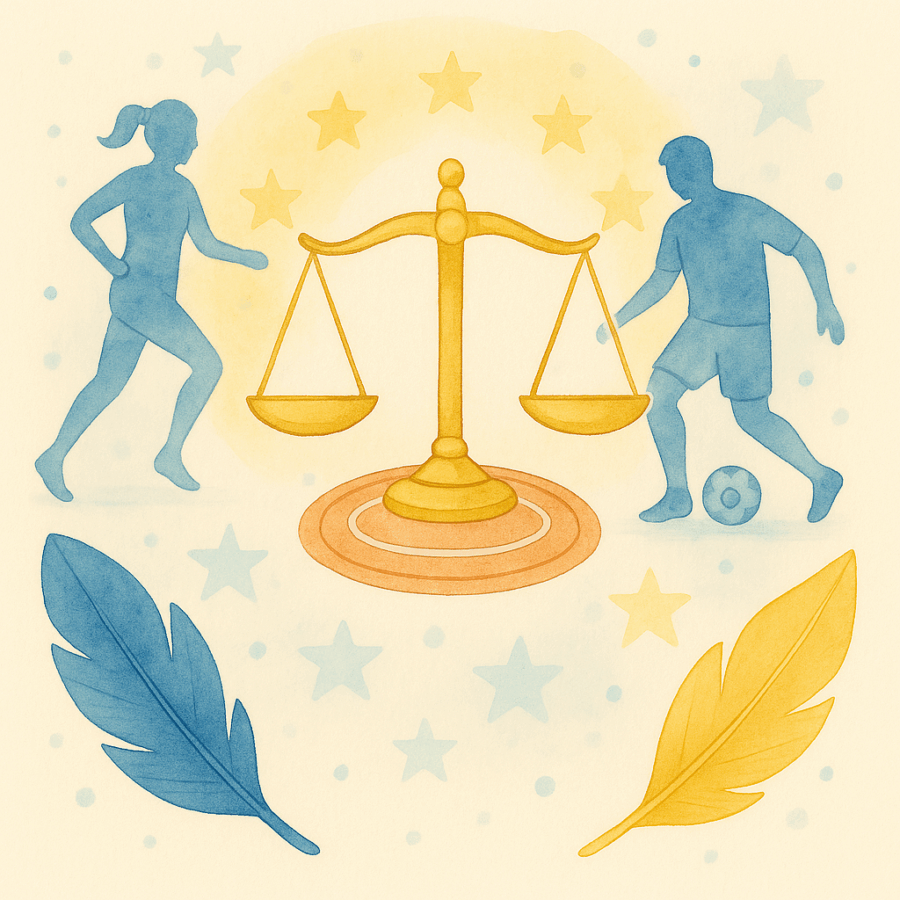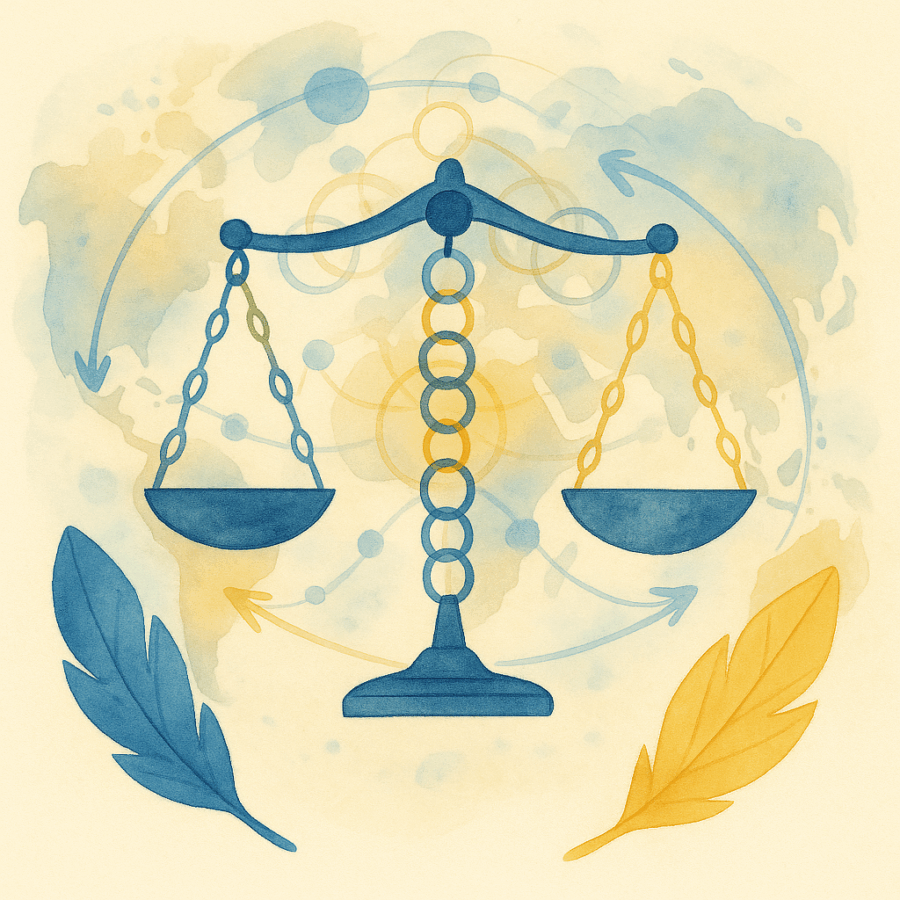Observations sous Cour constitutionnelle de Belgique, arrêt n°73/2025 du 30 avril 2025
Au fil du temps, les droits du locataire n’ont cessé d’être renforcés sous le prisme des divinités jurisprudentielles, les juges étant désormais acquis à la cause des droits de l’homme. D’un ordre juridique à un autre, la politique jurisprudentielle du juge constitutionnel, dévoile à la fois son engagement pour les droits des contractants et pour l’effectivité et la justiciabilité des droits sociaux[1]. Le droit à un logement décent, droit social par essence, qui pour certains apparait comme un simple objectif[2], trouve dans la jurisprudence constitutionnelle belge, un vecteur de son effectivité grâce au droit de préférence du locataire en cas de vente du bien par le bailleur, précisément dans la région de Bruxelles-Capitale. C’est du moins le sens de l’arrêt n°73/2025 du 30 avril 2025 de la Cour constitutionnelle. En l’espèce, pour assurer l’effectivité du droit au logement, le législateur de Bruxelles-Capitale institue en 2023 par voie d’ordonnance un droit de préférence au profit du locataire lorsque le bien objet du bail est mis en vente. La réforme à peine adoptée, l’ASBL « Federia » et plusieurs entrepreneurs et agents immobiliers introduisent un recours devant la Cour constitutionnelle en vue de son annulation, au motif que cette mesure porte atteinte à la fois au principe d’égalité et de non-discrimination et au droit de propriété consacrés par la Constitution[3]. Sous ces prétentions se glisse la contestation de la compétence du législateur de Bruxelles-Capitale en cette matière.
Ce bref aperçu des faits révèle les ramifications de cet arrêt où s’enchevêtrent des problèmes juridiques d’ordre à la fois substantiel et procédural. Du problème d’atteinte au droit de propriété se conjuguent ceux de la rupture d’égalité et de la compétence du législateur ; ce qui dévoile tout l’intérêt de l’arrêt. En plus, en l’état actuel du droit belge, seule la région bruxelloise a jusqu’ici consacré le droit de préférence. Les législations respectives des régions flamande et wallonne sont encore silencieuses sur le sujet. Certes, au moyen d’une clause contractuelle, les parties ont la liberté d’instituer un tel droit, dans les autres régions. L’institution d’un droit de préférence en région bruxelloise, même en l’absence d’une clause contractuelle expresse, révèle l’originalité de la question qui trouve du reste sa traduction dans sa confirmation par le juge constitutionnel. En l’occurrence, le juge constitutionnel liquide d’emblée la question de la compétence en reconnaissant au législateur le pouvoir d’appréciation étendu sur la politique de logement en vertu de l’article 23 de la constitution. Du point de vue substantiel, il adopte un raisonnement dialectique qui le conduit à soutenir la légitimité du droit de préférence du locataire, tant il est en adéquation avec le droit de propriété (I) et compatible au principe d’égalité et de non-discrimination (II).
I – L’adéquation du droit de préférence du locataire au droit de propriété
L’un des reproches faits à la mesure querellée est son caractère attentatoire au droit de propriété. Selon les requérants, le droit de préférence du locataire heurte les aspirations d’un ordre constitutionnel belge protégeant le droit de propriété alignées sur celles du droit européen[4]. L’interprétation du tissu normatif impliquant à la fois le droit belge et le droit européen[5] aboutit au constat d’un double malaise introduit dans l’exercice du droit de propriété par l’institution du droit de préférence. Il est constitutif d’une restriction du droit de propriété du bailleur (A) et d’une ingérence dans le droit au respect des biens de l’acquéreur (B), contrebalancés cependant par les objectifs poursuivis et la proportionnalité de la mesure à ce but.
A) Une restriction justifiée de la liberté du droit de propriété du bailleur
La restriction du droit de propriété du bailleur tient de la limitation de sa liberté dans le choix de l’acquéreur du bien objet du bail. L’obligation faite au bailleur d’informer le locataire de toute initiative de vente du bien n’est pas en soi une atteinte à cette liberté. Le malaise intervient du moment où cette obligation s’étend à celle du choix ipso facto du locataire comme acquéreur, dans l’hypothèse où son offre correspond aux modalités requises. La liberté du bailleur s’estompe ainsi face à un locataire qui n’a en principe sur le bien que le droit de jouissance. Pour autant, cette atteinte reste mesurable et conciliable avec le droit de propriété au regard de la légitimité des buts poursuivis par cette mesure. En réalité, le droit à un logement décent des locataires est affecté d’une potentielle ineffectivité qui trouve sa justification dans la précarité des biens objets du bail. L’instabilité du locataire est souvent corrélative à la vente du bien objet du bail, du fait des nouvelles modalités du bail généralement imposés par le nouvel acquéreur ; si ce n’est une simple rupture du contrat initial. Le droit de préférence vise alors à assurer une certaine stabilité du locataire nécessaire à l’effectivité du droit à un logement du décent, en plus de pouvoir favoriser l’accès à la propriété au locataire[6].
L’enjeu d’une telle mesure est alors double, garantir, mieux rendre effectif le droit à un logement décent et favoriser au locataire un accès à la propriété. Il s’agit d’un potentiel bénéfique en matière de droits de l’homme, jugé légitime qui s’ajuste fort pertinemment avec le droit de propriété. La mesure revêt une forte dimension sociale et le juge y voit d’ailleurs une limitation raisonnable du droit de propriété dans un objectif d’intérêt général. Au demeurant, l’adéquation de cette mesure à ces objectifs se dévoile dans la prudence du législateur au moment de la consécration du droit de préférence. Tel qu’aménagé, ce droit de préférence, ne prive aucunement de la propriété du bien, ni de sa jouissance ; sa portée est essentiellement proportionnée aux buts visés.
B) Une ingérence compréhensible dans le droit de propriété de l’acquéreur
Le droit de préférence du locataire trouve sa traduction essentielle dans le recours subrogatoire institué au profit du locataire. En l’occurrence, l’action en subrogation consiste pour le locataire qui n’a pas été tenu informer par le bailleur de son intention de vendre le bien, de se retourner contre l’acquéreur pour réclamer le bien à condition de rembourser le prix de la vente et de l’indemniser pour les frais d’actes engagés lors de la transaction. Cette action ne reçoit pas la bienveillance des requérants qui y voient une atteinte au droit de propriété de l’acquéreur de bonne foi. A leurs yeux, cette action n’apparaît pas uniquement comme la simple réclamation d’un droit non respecté par le bailleur, c’est une sanction de l’atteinte à un droit fondamental ; leur interprétation va au-delà même de l’esprit du législateur lorsqu’ils l’associent à une véritable privation du bien acquis par le nouveau propriétaire. En situation normale, cette prétention n’est pas réfutable, du moment où la vente opérée entraine un transfert de propriété opposable aux tiers. En l’espèce, l’opposabilité du transfert de propriété dépend du respect ou non du droit de préférence du locataire par le moyen de la notification de l’intention de vente par le bailleur. La transaction réalisée en défaut du respect du droit d’information du locataire s’assimile dans ce cas à une mauvaise vente, entrainant en conséquence, une éventuelle double responsabilité, d’un côté celle du bailleur, du notaire ou de l’agence immobilier qui ne sont pas épargnés d’un potentiel recours de l’acquéreur en cas d’action subrogatoire du locataire, et de l’autre, cette action subrogatoire susceptible de désapproprier ce nouvel acquéreur de son bien. Aussi, le juge constitutionnel soutient-il que l’action en subrogation, en l’état actuel du droit belge qui fait corps en la matière avec le droit européen sur le droit de propriété[7], constitue une ingérence dans le droit au respect du bien de l’acquéreur[8].
La portée d’une telle ingérence est toutefois amoindrie par le but poursuivi par l’action subrogatoire. Celle-ci est vectrice d’une utilité qui transcende l’ingérence constatée. Pour le juge, au vu de son importance dans la réalisation du droit à un logement décent, le droit de préférence doit être paré de garanties suffisantes pour assurer son effectivité. L’action subrogatoire en constitue le vecteur idéal, c’est le moyen adéquat. En plus d’être le tremplin indiqué pour atteindre l’objectif du renforcement de la stabilité de l’occupation du logement en favorisant l’accès du locataire à la propriété de celui-ci, elle est dimensionnée à cet objectif. C’est ce recours subrogatoire qui en assure sa justiciabilité. Le droit de préférence du locataire serait fragile si sa consécration n’était pas assortie d’une garantie d’effectivité notamment par la voie d’une potentielle action en justice. Il s’agit d’un objectif légitime qui invalide toute prétention tirée de son ingérence dans le respect du droit des biens.
Sous ce rapport, le droit de préférence du locataire reste compatible avec le droit de propriété, même si l’action en subrogation entraine une désappropriation du bien au profit du locataire et au détriment de l’acquéreur ; désappropriation assimilée par les requérants, mais invalidée par le juge, à une privation de bien, comparable à une expropriation pour cause d’utilité publique ; sauf qu’il semble exister dans ce cas une différence de traitement contraire à l’égalité et à la non-discrimination ; argument nuancé par le juge.
II – La compatibilité du droit de préférence au principe d’égalité et de non-discrimination
Le rapport du droit de préférence du locataire au principe d’égalité et de non-discrimination se situe à deux niveaux ; la reconnaissance du droit de préférence au seul locataire apparait, selon les requérants, comme discriminatoire par rapport aux potentiels acquéreurs ou initiaux, qui sont susceptibles en cas d’achat du bien, d’être privés de leur bien sans indemnisation, ce qui n’est pas le cas dans l’expropriation pour cause d’utilité publique. La différence de traitement est ainsi mise en contrariété avec le principe d’égalité et de non-discrimination susvisé. A la lumière des critères stabilisés dans sa jurisprudence[9], le juge conclut que la différence de traitement est ici contrebalancée par la légitimité des objectifs poursuivis, ce qui la rend légitime dans le rapport à la fois entre le locataire et les acquéreurs potentiels (A) et entre les acquéreurs et les expropriés pour cause d’utilité publique (B).
A) La légitimité d’une différence de traitement entre le locataire et les acquéreurs
La différence de traitement entre le locataire et acquéreurs initiaux ou potentiels tient à la reconnaissance d’un droit de préférence au premier, alors que les seconds en sont dépourvus. Sans doute, cette prétention est-elle logiquement compréhensible ; le locataire en étant informé de l’intention de vente du bien, devient en conséquence un acquéreur potentiel. Dans l’esprit du législateur, et au regard du raisonnement précédant du juge, son droit à l’information inhérent au droit de préférence, ne peut s’apprécier comme une simple commodité informative ; il s’agit bien d’une offre de vente à laquelle il peut souscrire s’il en a intérêt et en remplir les modalités. Accorder un droit de préférence à un seul d’entre les acquéreurs s’apprécie de prime abord comme une différence de traitement constitutive d’atteinte au principe d’égalité et de non-discrimination[10]. Fidèle à sa politique jurisprudentielle[11], la Cour constitutionnelle n’invalide pas une mesure, tout simplement en raison d’une différence de traitement. C’est en l’absence d’un critère de distinction objectif, d’une justification par un objectif légitime et dans l’inexistence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens mobilisés que la différence de traitement peut être censurée[12]. Ces critères sont cumulatifs et leur réalisation tempère la différence de traitement et la rend impertinente et inopérante pour la censure d’une mesure potentiellement discriminatoire.
Ces critères sont aux mains du juge constitutionnel belge de vraies ressources interprétatives qu’il exploite pour asseoir sa conviction sur la légitimité d’une différence de traitement. Le juge tire argument de son raisonnement précédant sur le droit de propriété notamment relatif à la légitimité des buts poursuivis, pour invalider la prétention des requérants. Mais au-delà, l’élément le plus déterminant qui marque la pertinence de son raisonnement, c’est le critère distinctif objectif retenu en l’espèce, à savoir, l’existence ou non d’un contrat de bail à longue durée dont est titulaire le locataire sur le bien. Ce lien contractuel est d’autant plus déterminant qu’il apparaît pertinent aux yeux du juge au regard du double objectif précédemment établi. Ainsi, il ne s’agit pas d’un avantage indu, mais d’un moyen d’accomplissement d’un droit à logement dont le préalable est déjà réalisé par le locataire grâce au contrat de bail déjà existant.
B) L’équitabilité d’un traitement différencié entre les acquéreurs et les expropriés pour cause d’utilité publique
Le prolongement de la question du droit de préférence sur l’expropriation pour cause d’utilité publique trouve son fondement dans l’action en subrogation. Accusée de favoriser une ingérence dans le droit au respect des biens de l’acquéreur, l’action en subrogation est cette fois-ci soupçonnée de favoriser une discrimination entre les acquéreurs potentiels et les personnes expropriées pour cause d’utilité publique ; en ce que, l’expropriation qui conduit à une privation du bien, ouvre droit à une indemnisation pour le propriétaire du bien, alors que l’action en subrogation qui conduit au même résultat, n’entraine pas, dans les conditions actuelles de sa consécration par l’ordonnance, une indemnisation de l’acquéreur. On aurait bien voulu opposer une non-comparabilité des deux régimes comme le gouvernement, -puisque l’expropriation est caractérisée par un régime spécial où s’expriment les prérogatives exorbitant de droit commun justifiant une extorsion d’un bien privé au nom de l’intérêt général, par une personne publique même si moyennant une indemnisation contrairement à une action en subrogation qui s’apprécie en l’espèce comme un moyen de réclamation ou de recouvrement d’un droit a priori injustement entaché-, que le juge aurait rejeté l’argument, la raison étant que la différence ne se confond pas à la non-comparabilité. Si la différence peut constituer un élément de détermination d’un traitement différencié selon le juge, elle reste cependant insuffisante pour conclure ipso facto à la non-comparabilité[13]. Un tel raisonnement désubstantialiserait le contrôle du respect du principe d’égalité et de non-discrimination. Le juge belge est coutumier de ce raisonnement en la matière, qui l’amène à constater l’existence d’une différence de traitement, laquelle est toutefois légitime au regard des buts poursuivis et repose sur un critère de distinction à la fois objectif et pertinent, lié à l’irrégularité du titre de propriété détenu par l’acquéreur. L’action en subrogation s’apparente en l’espèce à une sanction de l’atteinte à un droit, contrairement au régime de l’expropriation. Cette différence est alors parée des attributs d’équitabilité.
Grâce à un bail à longue durée sur un bien, le locataire peut en devenir le propriétaire quand il est mis en vente. Telle est le sens du droit de préférence du locataire. L’obligation d’informer son locataire de l’intention de vente du bien, imposée au bailleur entraine une extension du statut du locataire en un acquéreur préférentiel. Il s’agit d’un fil conducteur vers la réalisation effective d’un droit à logement décent, droit généralement éprouvé par des effets corrélatifs d’une vente à un autre acquéreur. Le raisonnement du juge ne s’en éloigne pas, puisse que l’exercice du droit de préférence, bien qu’encadré notamment par des exigences temporelles concernant la durée du bail, devient un instrument de facilitation d’accès à la propriété et un moyen de garantie de la stabilité des locataires. La légitimité de ce droit trouve sa traduction dans l’intérêt général qui transcende sur toute différence de traitement que ce droit est susceptible de générer et favorise son adéquation au droit de propriété et sa compatibilité au principe d’égalité et de non-discrimination. Le droit à un logement décent trouve ainsi un vecteur de sa justiciabilité avec le droit de préférence.
[1] D. Roman, « La justiciabilité des droits sociaux ou les enjeux de l’édification d’un État de droit social », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 2012
[2] B. Nicolas, « Le droit à un logement décent », in M. Verdussen et N. Bonbled (dir.), Les droits constitutionnels en Belgique. Les enseignements jurisprudentiels de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et de la Cour de cassation, Bruylant, Bruxelles, 2011, p. 1383-1413.
[3] Article 10, 11 et 16 de la Constitution belge.
[4] Cf. Premier Protocole additionnel de la CEDH (art. 1er), Charte des droits fondamentaux de l’UE (art. 17).
[5] Ibid.
[6] Cour const. Belgique, arrêt n° 73/2025 du 30 avril 2025, p. 12.
[7] Article 17 de la Charte précitée ; CJUE, Kadi et autre c/ CUE et CCE, 2008 ; CEDH, Arrêt Lindheim et autres c/ Norvège, 2012.
[8] Cour const. Belgique, arrêt n° 73/2025 du 30 avril 2025.
[9] G. Rosoux, « Raisonnement de la Cour en matière d’égalité et de non-discrimination » in Contentieux constitutionnel, 1e éd., Bruxelles, Larcier, 2021, p. 353.
[10] B. Renauld et S. Van Drooghenbroeck, « Le principe d’égalité et de non- discrimination », in Verdussen, M. et Bonbled, N. (dir.), Les droits constitutionnels en Belgique…, op.cit., p. 553.
[11] Cour const. Belgique, Arrêt du 14 septembre 2023.
[12] Cour const. Belgique, arrêt du 5 février 2015.
[13] V. Flohimont, « Comparaison et comparabilité dans la jurisprudence de la cour constitutionnelle : rigueur ou jeu du hasard ? », RBDC, n° 3, 2008, p. 220.