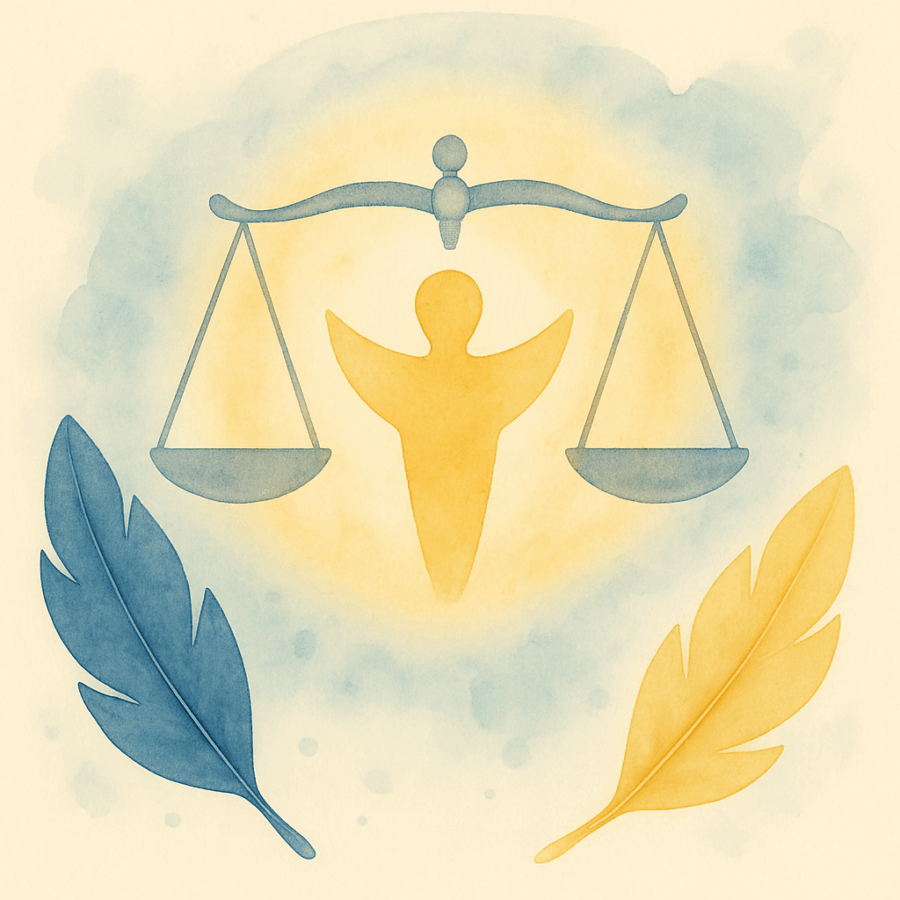Cour européenne des droits de l’homme, arrêt [GC] du 9 juillet 2025, Requêtes n°8019/16, 43800/14, 28525/20 et 11055/22, Ukraine et Pays-Bas c. Russie
Par cet arrêt Ukraine et Pays-Bas c. Russie, la Cour européenne des droits de l’homme (« Cour ») a reconnu la responsabilité de la Russie pour des violations généralisées et flagrantes des droits de l’Homme (« DH ») commises dans le cadre du conflit armé qui a débuté dans l’est de l’Ukraine en 2014 à la suite de l’arrivée de groupes armés pro-russes dans les régions de Donetsk et de Louhansk et qui s’est intensifié à partir de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie lancée le 24 février 2022. Cette affaire interétatique regroupe quatre requêtes : deux (n°8019/16 et 43800/14) introduites par l’Ukraine en 2014 alléguant de violations des DH par la Russie dans le contexte du conflit dans l’est de l’Ukraine ayant impliqué des séparatistes pro‐russes à partir du printemps 2014 ; une troisième (n°28525/20) introduite par les Pays‐Bas en 2020 concernant la destruction de l’avion assurant le vol MH17 en juillet 2014 ; une dernière (n°11055/22) introduite par l’Ukraine en 2022 alléguant de violations des DH par la Russie dans le contexte de l’invasion Russe.
Si cet arrêt est remarquable à plus d’un titre – du fait de la nature et de l’ampleur inédites des violences commises, de la condamnation unanime d’un État ayant dénoncé la Convention européenne des droits de l’homme (« Convention »), de la tierce intervention de vingt‐six États parties ou encore de la compilation historique, inestimable et complète, des éléments de preuve disponibles – c’est avant tout parce qu’il est rendu par la seule juridiction internationale des DH compétente concernant le conflit armé international (« CAI ») en Ukraine qu’il attire notre attention. Au vu de l’absence de juridiction internationale propre au droit international humanitaire (« DIH »), les victimes des conflits armés adressent aujourd’hui leurs demandes aux organes internationaux des DH[1]. Devant ces derniers, deux questions « intimement liées »[2] apparaissent : la juridiction des États parties à un instrument des DH en situation de conflit armé (condition sine qua non à l’engagement de leur responsabilité) et l’appréhension du DIH par ces organes des DH.
Alors que la tendance est à la retenue (Voir par ex. Décision Abdulaal Naser et autres c. Danemark), la Cour fait sans doute moins preuve de déférence à l’égard du contexte politique pour revenir sur la limite à la juridiction extraterritoriale des États durant la « phase active des hostilités » (Arrêt Géorgie c. Russie (II), § 51) et finalement condamner la Russie[3]. Mais ce faisant, elle se fonde uniquement sur les allégations de l’Ukraine pour ne pas avoir à aborder la question de la conformité à la Convention d’actes autorisés par le DIH, mais seulement à constater que des actes contraires au DIH sont également contraires à la Convention.
La juridiction extraterritoriale des États parties à la Convention et les conflits armés
Malgré le silence de l’article 1 de la Convention à propos du « territoire » des Etats parties, la Cour fonde leur juridiction sur sa dimension « principalement territoriale » (Décision Banković et autres c. Belgique et 16 autres États parties, § 59). L’absence de référence à la notion de territoire a permis à la Cour d’étendre les obligations des États au-delà de leurs frontières (Comm., Chypre c. Turquie, 1975, pp. 149-150) et même de celles du Conseil de l’Europe (Arrêt Al-Skeini c. Royaume-Uni, §§ 130-150). Cependant, eu égard à la « vocation essentiellement régionale du système de la Convention » (Banković, § 80), ce n’est que dans des « circonstances exceptionnelles » (Banković, § 67) qu’un État exerce sa juridiction extraterritoriale[4]. À ce titre, les conflits armés auxquels des États prennent part ont offert à la Cour de nombreuses opportunités d’identifier ces dites circonstances.
D’abord, la Cour refuse que parmi les « circonstances exceptionnelles » ne figure le cas d’un « acte extraterritorial instantané, le texte de l’article 1 ne s’accommodant pas d’une conception causale de la notion de « juridiction » » (Arrêt Medvedyev et autres c. France, § 64). Cependant, elle reconnait un modèle d’exercice spatial de la juridiction extraterritoriale intra-européenne dans le cadre duquel un État exerce un contrôle effectif sur un territoire étranger, soit du fait d’une action militaire directe comme une occupation armée (Comm., Chypre c. Turquie, 1983, § 63 ; Arrêt Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), § 62), soit en raison d’une action militaire indirecte par le biais d’une administration locale subordonnée (Arrêt Chypre c. Turquie, § 77) ou d’un mouvement séparatiste qu’il soutient (§78). L’État doit alors respecter et protéger les droits de la Convention sur le territoire soumis à son contrôle effectif. Aussi, la Cour reconnait un modèle d’exercice personnel de la juridiction extraterritoriale extra-européenne dans le cadre duquel l’État exerce son pouvoir et son autorité sur un individu étranger pouvant aller au-delà d’un contrôle physique, exercé sur un détenu (Arrêt Issa et autres c Turquie, § 71) ou sur la vie d’une personne dans une situation de ciblage direct (Arrêt Carter c. Russie, §§ 150 et 158-161), lorsqu’il s’acquitte de certaines prérogatives de puissance publique comme la responsabilité du maintien de la sécurité dans une zone située en dehors de son territoire (Al-Skeini, §§ 143-150), ou encore du fait d’actions isolées et ciblées comprenant un élément de proximité (Géorgie c. Russie (II), § 132). Ici, l’État doit uniquement garantir des droits « fractionnés et adaptés » pertinents au vu de la situation de l’individu sur lequel il exerce son autorité et son contrôle (Al-Skeini, §§ 137-138 et 142).
La Cour est donc parfaitement claire sur son intention de prévenir l’émergence de zones de non-droit, puisqu’elle précise que l’article 1 ne peut être interprété comme permettant « à un État partie de commettre sur le territoire d’un autre État des violations de la Convention qu’il ne pourrait pas commettre sur son propre territoire » (Issa et autres c Turquie, § 71). Elle étend ainsi son champ d’action dans les conflits partout dans le monde, mais également au sein d’un même conflit[5].
Pourtant, la Cour a récemment distingué, sans motivation, deux phases dans le conflit : la « phase active des hostilités » (Géorgie c. Russie (II), § 51) au cours de laquelle l’État n’exerce pas sa juridiction extraterritoriale spatiale ou personnelle du fait du « contexte de chaos » (§§ 126 et 137), suivie d’une « phase d’occupation après la cessation des hostilités » (§ 52) durant laquelle l’État l’exerce. En confirmant le rejet du modèle causal (Banković), la Cour a néanmoins introduit une nouvelle limite à l’exercice de la juridiction extraterritoriale des États qui interroge à bien des égards[6].
Finalement, la Cour invoque le caractère inédit et flagrant de l’attaque « contre les valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe ainsi que contre l’objet et le but de la Convention » (Ukraine et Pays Bas c. Russie, § 349) et la nécessité de « préservation de la paix et de la sécurité en Europe » pour « reprendre sa réflexion sur la manière dont elle exerce sa compétence »[7]. Tout en reconnaissant l’impossibilité d’établir la juridiction extraterritoriale de la Russie sur la base du modèle spatial dans le cadre de la conduite des hostilités, la Cour reconnaît la pertinence du modèle personnel au motif que les « attaques militaires de grande ampleur [et] planifiées de manière stratégique » (§ 361) menées par la Russie « dans l’intention délibérée et avec l’effet incontestable d’assumer l’autorité et le contrôle, sans pour autant parvenir à exercer un contrôle effectif, sur des zones, des infrastructures et des personnes en Ukraine est totalement incompatible avec toute idée de chaos ». Bien que la nature – internationale – du conflit et l’extraterritorialité – intra-européenne – des hostilités soient identiques, la Cour revient, à l’unanimité, sur l’exception à la juridiction de l’État durant la « phase active des hostilités » (Géorgie c. Russie (II), § 51) au regard de l’ampleur et la planification des attaques et de l’intention délibérée de l’État d’exercer son contrôle et son autorité sur des individus à défaut de parvenir à exercer un contrôle effectif sur le territoire.
Alors que la jurisprudence antérieure de la Cour pouvait se lire à la lumière de sa « réticence palpable à s’ériger en juge du [DIH] »[8] – notamment en raison des limites procédurales et institutionnelles dans lesquelles elle travaille et qui font qu’elle est particulièrement mal « équipée »[9] – et semblait ainsi « insatisfaisante aux yeux des victimes » (Géorgie c. Russie (II), § 140), la Cour prend cette-fois-ci toute la mesure de son rôle de juridiction internationale compétente pour rendre justice aux victimes des conflits armés sans même rappeler le partage de compétence qui devrait se faire au profit des organes politiques des organisations internationales (Arrêt Sargsyan c. Azerbaïdjan (satisfaction équitable), § 30).
La prise en compte du DIH par la Cour européenne des droits de l’homme
En dépit de l’absence de juridiction internationale propre au DIH, la juridiction extraterritoriale des États parties a permis à la Cour de développer une jurisprudence abondante en matière de conflits armés et d’ainsi appréhender – ou non – le DIH[10].
En pratique, l’utilisation du DIH par les organes de DH s’analyse autour de trois principes communs à l’ensemble des organes[11].
La compétence matérielle des organes pour contrôler le respect par l’État de ses obligations de DIH que la Cour – comme la plupart des organes des DH – décline en refusant connaître directement d’une violation des règles de DIH.
L’herméneutique appliquée par les organes des DH qui s’appuie notamment sur la combinaison normative. En ce sens, la Cour utilise les règles pertinentes du DIH pour analyser les dispositions de la Convention, souvent trop générales pour pouvoir correctement s’appliquer à la situation factuelle examinée.
Enfin, l’intégration à des fins systémiques du DIH dans le système de protection des DH. Conformément à l’article 31 § 3 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, à la nature particulière de la Convention – instrument de l’ordre public européen – et à sa mission[12], il incombe à la Cour d’interpréter, autant que possible, la Convention de manière à ce qu’elle se concilie avec les autres règles du droit international – y compris du DIH –, dont elle fait partie intégrante (Arrêt Varnava et autres c. Turquie, § 185) et, si cela est nécessaire, de vérifier le respect des dispositions du DIH (Arrêt Hassan c. Royaume-Uni, §§ 109-110). Contrairement à la CIJ, la Cour n’a pas décrit la relation entre la Convention et le DIH comme une relation entre lex generalis et lex specialis (Avis consultatif Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, p. 240, § 25 et p. 257, § 79 ; Avis consultatif Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, pp. 177-179, §§ 102, 106-108 ; Arrêt (fond) Activités armées sur le territoire du Congo (République Démocratique du Congo c. Ouganda), p. 231, § 178 et pp. 242-244, §§ 216-217). Dans les situations de conflit armé, les règles spécifiques du DIH n’écartent pas les garanties de la Convention mais servent plutôt d’outil d’interprétation permettant de déterminer, en pareille situation, l’étendue de celles-ci (Ukraine et Pays Bas c. Russie, §§ 428-429). Ainsi, le DIH va adapter et compléter le système normatif de la Convention, sans jamais exclure totalement les garanties qui en découlent, afin de l’appliquer à des situations exceptionnelles. Souvent, ce renvoi au DIH est pro victima puisqu’il permet d’affirmer la pleine application des DH nourrie de règles de DIH plus précises (Varnava et autres c. Turquie, §§ 185-186, à propos des obligations procédurales découlant de l’art 2 de la Convention). Bien qu’en l’absence de conflit normatif avec le droit de la Convention, la Cour semble aujourd’hui vouloir se passer du DIH (Arrêt Hanan c. Allemagne, § 199). Cependant, le DIH a déjà été utilisé par la Cour pour limiter le champ d’application de la Convention, voire contra victima lorsque l’État défendeur a été reconnu agir en conformité avec ses obligations découlant du DIH dans une situation où une interprétation harmonieuse permettant de concilier les dispositions de la Convention avec les règles du DIH n’était pas possible en l’absence d’une dérogation au titre de l’article 15 de la Convention, parce qu’il existait un conflit normatif (Hassan c. Royaume-Uni, §§ 96-107). À ce titre, dans sa décision Ukraine et Pays-Bas c. Russie (§ 720), la Cour relève l’existence d’un potentiel conflit au sujet de l’article 2 de la Convention avant de renvoyer l’examen de la question au fond. Toutefois, dans son arrêt Ukraine et Pays-Bas c. Russie, la Cour conclut qu’« un tel conflit ne peut exister entre les dispositions de l’article 2 et le [DIH] [car] les allégations formulées en l’espèce port[ent] sur des attaques militaires dont [l’Ukraine] soutient qu’elles étaient contraires au DIH. Elle limit[e] par conséquent son examen aux attaques militaires alléguées qui sont contraires au [DIH] : ainsi ne se pose donc pas la question de savoir comment, en l’absence d’une dérogation au titre de l’article 15, il convient d’aborder sous l’angle de l’article 2 de la Convention les homicides compatibles avec le [DIH] » (§ 747). De la même façon, les privations de liberté opérées n’étant pas légales au regard du DIH, la Cour ne se penche pas sur le conflit apparent entre l’autorisation d’interner des civils en DIH[13] et les types de détentions permises par l’article 5 § 1 de la Convention (§ 1122). En se basant sur les allégations de l’Ukraine, la Cour n’a pas à aborder la question de savoir si des actes conformes au DIH seraient contraires à la Convention mais seulement à constater que des actes contraires au DIH sont également contraires à la Convention.
Par ailleurs, lorsque la Cour se réfère au DIH, deux tendances se dessinent dans l’intensité du renvoi opéré[14]. D’abord, alors que la Cour se limite à des références implicites aux DIH lorsque les situations dont elle a à juger se qualifient de CANI, elle y fait explicitement référence en matière de CAI. Ensuite, la Cour opère une seconde distinction en faveur des règles du DIH relatives à la protection des personnes qu’elle mobilise explicitement, contrairement à celles relevant de la conduite des hostilités qu’elle ignore, de manière délibérée ou non.
Cependant, la Cour semblait avoir récemment complexifié sa position au regard du DIH en tenant compte des phases du conflit (Géorgie c. Russie (II), § 144) avant de revenir dessus dans son arrêt Ukraine et Pays-Bas c. Russie (§§ 428 et 747).
[1] H. TIGROUDJA, « Conflits armés et droit international des droits de l’homme », Recueil des cours de l’Académie de La Haye, Volume 444, 2023, p. 36, § 13, p. 215, §§ 179-180 et pp. 234-235, § 202. Le contentieux de violation des DH en conflit armé augmente devant la Cour en matière de requêtes individuelles et interétatiques.
[2] J. GRIGNON et T. ROOS, « La juridiction extraterritoriale des États parties à la Convention européenne des droits de l’Homme en contexte de conflit armé », RQDI, n° 33, 2020, p. 2.
[3] S.S. ALCEGA, « The Invasion of Ukraine from the Point of View of the European Court of Human Rights », RQDI, 35, 2023, pp. 297-302.
[4] V. F. SUDRE, J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, G. GONZALEZ, A. GOUTTENOIRE, F. MARCHADIER, L. MILANO, A. SCHAHMANECHE, D. SZYMCZAK, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, 11e éd., PUF, 2025, n°69, Ilascu et al. c/ Moldavie et Russie, n°48787/99, 8 juillet 2004, p. 881.
[5] GRIGNON et ROOS, 2020, note 2, p. 9.
[6] Supra l’intention de la Cour de « prévenir l’émergence de quelconques zones de non-droit » ; Cf. : H. DUFFY, « Georgia v. Russia: Jurisdiction, Chaos and Conflict at the European Court of Human Rights », Just Security, 2 février 2021 ; J. GRIGNON et T. ROOS, « L’affaire Géorgie c. Russie II : six ans après l’affaire Hassan, la clarification tant attendue sur l’appréhension des conflits armés par la Cour européenne des droits de l’homme? » Quid Justiciae, 10 mars 2021 ; M. MILANOVIC, « Georgia v. Russia No. 2: The European Court’s Resurrection of Bankovic in the Contexts of Chaos », EJIL:Talk!, 25 janvier 2021 ; aussi CEDH, Géorgie c. Russie (II), précité, Opinion en partie dissidente du juge Lemmens, pp. 176-177, Opinion en partie dissidente du juge Grozev, Opinion en partie dissidente commune aux juges Yudkivska, Wojtyczek et Chanturia, Opinion en partie dissidente du juge Pinto de Albuquerque, Opinion en partie dissidente du juge Chanturia, §§ 4-5.
[7] Malgré le grand nombre de victimes alléguées, d’incidents contestés et le volume des éléments de preuve produits, la Cour revient sur Cour EDH, Géorgie c. Russie (II), note 17, § 141 pour cette fois-ci « développer sa jurisprudence au-delà de la conception de la notion de « juridiction » telle qu’elle y a été établie jusqu’à présent ».
[8] GRIGNON et ROOS, 2020, note 2, p. 17.
[9] A. NUßBERGER, « The Way Forward: A Pragmatic Approach in Addressing Current Challenges of Inter-State Cases », Völkerrechtsblog, 26 avril 2021 cité par H. TIGROUDJA, 2023, note 1, p. 226, § 195 : Les limites étant notamment l’établissement des faits et la récole des preuves, l’identification des victimes et le traitement des requêtes.
[10] GRIGNON et ROOS, 2020, note 2, p. 2.
[11] H. TIGROUDJA, « Conflits armés… », 2023, note 1, pp. 222-224, §§ 188-192.
[12] Article 19, CEDH.
[13] Articles 42 et 78, Convention de Genève IV.
[14] J. GRIGNON et T. ROOS, « La Cour européenne des droits de l’homme et le droit international humanitaire », RQDI, 1, 2020, pp. 677 à 679.