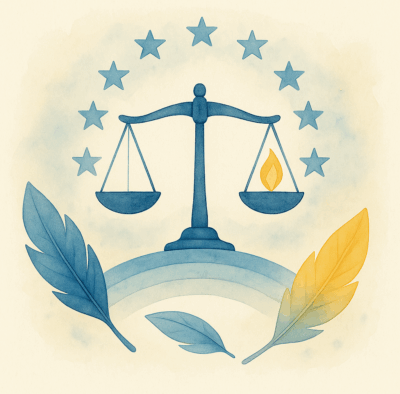La sécurité nationale
§I – Textes normatifs de référence
- Article 4 § 2 du Traité sur l’Union européenne
- Déclaration relative à la primauté
- Article 15 de la CESDH
§II – Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne
Principe de primauté & articulation des ordres juridiques
- CJCE, 15 juillet 1964, Costa c. E.N.E.L., aff. 6/64.
- CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, aff. 11/70
- CJCE, 9 mars 1978, Administration des finances de l’État contre Société anonyme Simmenthal, aff. 106/77.
Protection du droit au repos & temps de travail
- CJUE, 3 octobre 2000, SIMAP, aff. C-303/98.
- CJUE [GC], 14 mai 2019, CCOO, aff. C-55/18.
- CJUE [GC], 15 juillet 2021, K. c. Republika Slovenija, aff. C-742/19.
- CJUE [GC], 20 septembre 2022, SpaceNet et Telekom Deutschland, aff. C‑793/19 et C‑794/19.
§III – Jurisprudences nationales
Méthode d’articulation Constitution / Droit de l’Union
- CE [Ass.], Arcelor, 8 février 2007, n° 287110.
- CE [Ass.], 21 avril 2021, French Data Network, n° 393099.
Application à la sécurité nationale et disponibilité militaire
- CE [Ass.], 17 décembre 2021, Gendarmerie départementale, n° 437125.
Pour approfondir :
- Sur les relations entre les ordres juridiques de protection nationaux et l’ordre de l’Union européenne : M. Safjan, D. Düsterhaus et A. Guerin, « La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les ordres juridiques nationaux, de la mise en œuvre à la mise en balance », RTDE, 2016, p. 219 ; H. Gaudin, « L’affaire OMT devant son (ses ?) juge(s), AJDA, 2016, p. 1050 ; J. Andriantsimbazovina, « Les droits fondamentaux, frein ou moteur de l’intégration européenne ? », Revue de l’Union européenne, 2019, p. 220.
- Sur l’affaire du temps de travail des militaires: S. Robin-Olibier, « Le temps de travail des militaires en temps de paix », JCP G, n° 37, 2021, p. 926 ; M.-C. de Montecler, « Les militaires aux 35 heures ? – Cour de justice de l’Union européenne 15 juillet 2021 », AJDA 2021, p. 1535 ; D. Ritleng, « Chronique Jurisprudence administrative française intéressant le droit de l’UE – L’organisation de la gendarmerie étant conforme au droit européen, pas de mise en œuvre de la nouvelle réserve de constitutionnalité tenant à la nécessaire libre disposition de la force armée », RTD Eur. 2022, p. 266 ; S. Robin-Olivier, « Désamorcer le conflit entre droit de l’UE et droit constitutionnel en renforçant le pouvoir des juges nationaux : À propos de la décision du conseil d’État du 17 décembre 2021 sur le temps de travail dans la gendarmerie », JCP G, nº 2, 2022, pp. 90-93 ; J.-C. Videlin, « Le temps de travail des militaires : Suite française… mais pas fin », JCP A, n° 7, 2022, pp. 42‑46 ; D. Charles-Le Bihan, « Les statuts des militaires dans l’Union européenne : convergences, divergences, adaptations ? », AJFP 2025, p. 547.
- Sur la sécurité nationale: H. Gaudin, « La clause de sécurité nationale de l’article 4 § 2 TUE, ultime contre-limite ? », in Le Droit européen, source de droits, source du droit : Mélanges en l’honneur de Vassilios Skouris, Mare & Martin, Paris, 2022, pp. 177-198 ; B. Warusfel, « Article 4, § 2, TUE – Le respect par l’Union européenne de l’identité et de la sécurité nationales », in E. Bernard et al. (dir.), L’Union européenne de la défense, Bruylant, Bruxelles, 2024, pp. 65-77.
Il n’est pas de communauté politique qui ne se soit pensée, d’abord, depuis l’exigence de « sécurité » – surtout si l’on est convaincu par cette idée : Homo homini lupus est. Qu’elle prenne la forme du bouclier, du mur ou du pacte civil, la « sécurité » est l’horizon à partir duquel l’État moderne s’est construit. Assurer la survie de la communauté, préserver l’intégrité du territoire, garantir la continuité des institutions, voilà sa mission première, sa fonction élémentaire, dont il demeure, à toute époque, le garant. L’Union européenne, pour sa part, n’a jamais contesté cette mission et ne s’est jamais substituée à cette fonction. Au contraire, elle s’est édifiée dans un geste plus singulier, plus complexe : celui d’un partage de souveraineté permettant non de dissoudre la puissance étatique [auctoritas et potestas], mais d’en transposer l’exercice dans un espace de droit commun. Le principe de primauté en est l’expression la plus significative. Mais la primauté n’est pas un absolu. Elle rencontre des contre-limites, lieux où l’État rappelle qu’il n’est pas seulement un acteur du droit européen, mais aussi un sujet souverain. L’identité constitutionnelle fut la première de ces contre-limites, rappelant que l’intégration peut buter contre la résistance et la tentation conservatrice des États membres. L’ultra vires, ensuite, a montré qu’aucun transfert de compétence ne s’opère sans surveillance : que l’État conserve le pouvoir de dire où s’arrêtent les compétences qu’il a consenties à l’Union. La sécurité nationale, enfin, semble s’inscrire dans cette série de dossiers sur les « contre-limites », non comme un signe de rupture, mais comme une ligne de crête où se joue la possibilité même de l’appartenance européenne.
L’article 4 § 2 TUE, en disposant que « la sécurité nationale reste de la seule responsabilité des États membres », ne fonde pas, doit-on s’en convaincre, un droit de retrait ni une enclave souveraine protégée. Il instaure ce que la doctrine, sous la plume en particulier d’H. Gaudin[1], a qualifié de « clause dérogatoire exceptionnelle » : une faculté d’accommodement, réservée aux situations où la défense de la communauté politique serait en cause, mais toujours encadrée, proportionnée et justiciable. Loin de fragiliser l’ordre juridique de l’Union, cette clause en assure la durée, la permanence, en préservant quelques espaces où les États membres apparaissent demeurer irremplaçables.
Que cette question se soit cristallisée dans une affaire anecdotique – le décompte des heures de garde d’un sous-officier slovène – n’est pas le fruit du hasard. C’est dans l’ordinaire de la vie militaire que se joue la manière dont le droit de l’UE pénètre les domaines où se fabrique, jour après jour, la sécurité nationale. Et lorsque le Conseil d’État se prononce à son tour quelques semaines plus tard, il ne s’érige pas contre la CJUE : il interprète, module, et laisse ouverte une possibilité d’ultime protection – une « soupape », qui n’est ni automatique ni gratuite, mais qui témoigne de la vigilance conjointe des ordres juridiques. Partant, l’objet de ce dossier n’est pas d’opposer l’Union et l’État membre ni de raviver l’imaginaire d’une souveraineté jalouse d’elle-même. Il est de montrer que la sécurité nationale n’est pas une clause de retrait, mais un point d’articulation entre les systèmes juridiques qui ne s’excluent pas, se « co-appartiennent ». Elle est bien une contre-limite, mais une contre-limite qui ne rompt pas, une contre-limite qui, peut-être, relie.
1°) La « sécurité nationale » dans l’ordre de l’Union : de la fonction essentielle à la clause dérogatoire exceptionnelle
La « sécurité nationale » n’a été intégrée dans les traités qu’avec le Traité de Lisbonne, au sein de l’article 4 § 2 du TUE. La formule est double : elle qualifie la sécurité nationale comme fonction essentielle de l’État, et affirme, en sus, qu’elle « reste de la seule responsabilité » des États membres. L’expression semble simple, mais elle ne l’est pas. D’abord, ainsi que l’a démontré B. Warusfel[2], la sécurité nationale est devenue en droit de l’Union un « concept structuré » : elle désigne, à regarder de près, la préservation des structures constitutionnelles fondamentales, la continuité des institutions, l’intégrité du territoire et la cohésion de la société. C’est le cœur du pouvoir étatique, non sa périphérie. La Cour, dans son arrêt de Grande Chambre du 6 octobre 2020 (La Quadrature du Net, Privacy International), a proposé une définition positive de cette notion : relèvent de la sécurité nationale, tout bien considéré, les mesures destinées à « protéger les fonctions essentielles de l’État et les intérêts fondamentaux de la société », incluant la prévention des menaces susceptibles de « déstabiliser gravement les structures constitutionnelles, politiques, économiques ou sociales » (pts. 135-136).
Une telle définition place la sécurité nationale non au niveau du maintien de l’ordre, mais à celui de ce qui rend possible l’existence même de l’ordre. Quoi qu’il en retourne, la sécurité nationale n’exclut pas l’application du droit de l’Union. Comme l’a observé H. Gaudin, l’article 4 § 2 du TUE ne doit pas être vue comme une clause de non-application, mais une « clause dérogatoire exceptionnelle » :
- elle ne soustrait pas un domaine au droit de l’Union ;
- elle permet une suspension ponctuelle, justifiée, proportionnée ;
- elle est toujours contrôlée par le juge.
Du moins, c’est ce qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l’Union.
2°) L’épreuve slovène : lorsque l’ordinaire militaire révèle la portée de la clause
Il est remarquable que l’un des moments les plus éclairants de la relation entre droit de l’Union et prérogatives régaliennes de l’État soit né d’une affaire d’apparence dérisoire. Rien ne semblait, à toute première vue, destiner le litige qui opposa un sous-officier slovène à son administration à devenir un révélateur. Il ne s’agissait que d’une demande visant à faire entrer les heures de garde dans le calcul du temps de travail effectif. Pas de zone de conflit, pas d’état d’exception, pas même un péril imminent : seulement la vie ordinaire d’une caserne. Pourtant, c’est exactement parce que cette affaire portait sur la quotidienneté, sur la matière humble et répétitive de l’exercice de la fonction militaire, qu’elle a mise au jour une tension décisive : celle qui naît lorsque le droit de l’Union rencontre ce qui, dans l’État, relève non du spectaculaire, mais du vital et de sa raison d’être : la façon dont la sécurité nationale se vit et se fabrique au jour le jour.
La réaction publique française à l’arrêt du 15 juillet 2021 fut révélatrice. On invoqua la souveraineté, l’atteinte à l’essence du pouvoir de l’État, l’inconcevable intrusion de la Cour du Luxembourg dans la conduite de l’armée. É. Philippe, à titre d’exemple, dénonça une décision touchant « au cœur de la souveraineté et de la sécurité de la France » ; un collectif de personnalités reconnaissait qu’« un soldat ne peut dire avant l’assaut : c’est la pause ». Ces formules frappaient, mais elles trahissaient une conception de l’armée comme lieu constant de l’exception, comme si le militaire se tenait toujours déjà dans l’instant du combat. Toutefois, il y a dans la vie des armées une longue étendue de jours ordinaires, des semaines de surveillance, de logistique, de santé, d’entretien, d’administration, de gestion humaine – et c’est dans ces espaces-là que le droit doit travailler.
La Cour de justice de l’Union, loin d’ignorer la spécificité militaire, a commencé par reconnaître que le militaire est un travailleur au sens du droit de l’Union, et que, comme tel, il bénéficie du droit au repos garanti par l’article 31 § 2 de la Charte[3]. Ensuite, elle introduit une distinction fondamentale, dont dépend toute l’économie de sa conclusion : l’armée n’est pas constamment mobilisée dans l’exception, et la sécurité nationale n’est pas toujours en jeu. Le militaire participe, en effet, à des fonctions administratives, logistiques, sanitaires, de police, d’entretien, de gestion : autant d’activités qui, loin d’être éludées par le droit, constituent le tissu ordinaire de l’institution militaire. En somme, c’est en fonction des situations que la directive 2003/88 s’applique ou se retire. La CJUE établit, à ce titre, une espèce de typologie : pour les opérations militaires proprement dites, les situations d’urgence, les tâches dont la « nature » empêche toute rotation ou tout repos, la directive 2003/88 ne s’applique pas. La Cour précise néanmoins que l’État conserve, in fine, une liberté concrète, une pleine responsabilité, car il lui appartient seul de déterminer la nature, l’intensité et la durée de ses engagements militaires. Elle observait ceci : « il relève de la seule responsabilité de chacun des États membres, compte tenu, notamment, des menaces auxquelles il est confronté, des responsabilités internationales qui lui sont propres ou du contexte géopolitique spécifique dans lequel il évolue, de procéder aux opérations militaires qu’il juge appropriées et de déterminer l’intensité de la formation initiale et des entraînements opérationnels qu’il estime utiles au bon accomplissement desdites opérations, sans qu’un contrôle de la Cour à cet égard soit envisageable, de telles questions devant être considérées comme échappant au champ d’application du droit de l’Union » (pt. 84). En revanche, là où l’armée agit comme organisation, en dehors d’évènements exceptionnels, le droit de l’Union continue de s’appliquer.
Cette distinction est conceptuellement décisive. Elle signifie, assurément, que la sécurité nationale ne suspend pas le droit européen, mais qu’elle en commande l’interprétation, voire l’accommodement. Il faut entendre qu’elle n’est pas une exception généralisée, mais, pour ainsi dire, une exception située, activable uniquement lorsque l’effectivité et l’efficacité même de la défense seraient mises en péril. C’est ce que laisse poindre la Cour par cette assertion : « le seul fait qu’une mesure nationale a été prise aux fins de la protection de la sécurité nationale ne saurait entraîner l’inapplicabilité du droit de l’Union et dispenser les États membres du respect nécessaire de ce droit » (pt. 40). Autrement dit, l’invocation de la « sécurité nationale » ne peut donc être ni automatique ni autodéclarée. En définitive, la sécurité nationale ne permet pas de limiter la portée du champ d’application du droit de l’UE, mais permet d’entrouvrir un espace de compétence aux États membres au sein même de celui-ci.
C’est cette même logique qui traverse, parallèlement, l’arrêt rendu le 20 septembre 2022 dans les affaires SpaceNet et Telekom Deutschland, où la question n’était plus le temps de travail, mais la conservation des données de connexion. Là encore, la CJUE refuse la solution binaire, manichéenne, qui opposerait, frontalement, primauté du droit de l’Union et urgence sécuritaire. Elle admet que la conservation généralisée et indifférenciée des données, pourtant prohibée en principe, peut être imposée aux opérateurs dès lors qu’un État est confronté à une menace grave pour la sécurité nationale, à condition que celle-ci soit réelle, actuelle ou prévisible, contrôlée par une autorité indépendante et limitée dans le temps. Mais lorsque l’objectif est la lutte contre la criminalité grave, la juridiction luxembourgeoise refuse la conservation généralisée et ne permet que des mesures ciblées, définies selon des critères objectifs. Ainsi, la sécurité nationale apparaît ici non comme un mot d’ordre permettant de se retirer du droit de l’Union, mais comme un « instrument d’adaptation » de son application, à partir duquel la règle se reconfigure sans se dissoudre.
Tout bien considéré, la « sécurité nationale » n’est pas une enclave souveraine où le droit de l’Union se trouverait suspendu. Elle n’est pas une espèce de clause d’opting-out, ni une brèche ouverte contre la primauté. Elle relève davantage de la logique d’une « clause passerelle » dans laquelle s’organise un partage délicat de compétences entre les différents ordres juridiques. Elle est l’occasion, pour le dire autrement, d’offrir quelques latitudes, non pour soustraire l’État au droit, mais pour permettre au droit de s’ajuster à la gravité des circonstances, pour permettre la prise en compte des contraintes et responsabilités propres à chaque État en vue de préserver son intégrité territoriale ou de sauvegarder sa sécurité nationale. Elle est, au bout du compte, une manière de trouver un équilibre. Et, paradoxe assez saisissant, plus l’État invoque la sécurité nationale, plus le CJUE manifeste son souci d’intervenir, non pas pour décider à sa place, mais plutôt pour vérifier que la sécurité nationale ne devienne pas alibi commode, que l’exception ne devienne pas la règle – bref, que la souveraineté ne se retourne pas contre ceux qu’elle prétend protéger.
Si la jurisprudence européenne dévoile quelque chose, c’est finalement ceci : la sécurité nationale ne justifie pas un « hors-droit » de l’Union. Elle en est, à rebours, l’une des épreuves les plus fines, l’un des lieux où la souveraineté, loin d’être réduite, tend à se requalifier. Elle passe du geste de l’immunité à celui de la responsabilité de l’État. Elle cesse d’être l’ombre portée de la puissance souveraine pour devenir la condition d’une « solidarité » – celle par laquelle l’Europe protège ceux qui la défendent, sans jamais hypothéquer ce qui fait que les États demeurent des États.
3°) La position française : la « sécurité nationale » comme soupape de souveraineté
Lorsque la question parvient au Conseil d’État le 17 décembre 2021, la haute juridiction administrative se situe ni tout à fait dans la résistance ni tout à fait dans l’alignement. En vérité, elle adopte une posture d’articulation. Elle se place sur le terrain ouvert par la logique de l’arrêt Arcelor, puis approfondi dans French Data Network : celui d’une espèce de médiation constitutionnelle entre droit de l’Union et exigences fondamentales de l’État. Le Conseil d’État commence par reconnaître l’autorité normative de l’interprétation donnée par la CJUE : le militaire peut, en principe, bénéficier des garanties européennes relatives au temps de travail. Mais, aussitôt, il en interroge l’opportunité et le bien-fondé : l’organisation de la gendarmerie, telle qu’elle existe, maintient-elle la disponibilité opérationnelle nécessaire à la protection de la Nation ? Le Conseil d’État conduit alors une analyse concrète, assez contextualisée : rythmes de service, périodes d’astreinte, compensation des repos, équilibre global des sujétions et des permissions. Et il finit par reconnaître que, pour la gendarmerie départementale, l’application de la directive 2003/88 n’affaiblit pas la mission. Elle peut donc s’appliquer sans réserve.
Mais ce qui importe n’est pas vraiment la conclusion ; c’est ce que la décision laisse en suspens. Puisque le juge administratif précise que, si l’application du droit de l’Union venait à compromettre la capacité des forces armées à assurer la sécurité nationale, alors la Constitution reprendrait la main. La contre-limite existe. Elle n’est pas utilisée, mais elle est disponible à l’usage selon les circonstances et besoins. En termes clairs, la souveraineté n’est pas affirmée, elle est (re)gardée, au double sens possible du terme. Elle ne se délègue pas, mais elle ne se replie pas non plus. Elle est tapie dans l’ombre en attente d’être convoquée, à condition que la situation l’exige. Tout se passe donc comme si la sécurité nationale apparaissait, à la fois comme une « soupape » pour l’État et un « vecteur de confiance ». Confiance dans l’État, qui ne doit pas invoquer son nom abusivement. Confiance dans l’UE, qui doit reconnaître là où elle doit être capable de se taire. Confiance dans les juridictions, qui doivent être en mesure de « dialoguer » sérieusement.
4°) Bilan – La « sécurité nationale » : une contre-limite comme les autres ?
La sécurité nationale apparaît actuellement comme la troisième grande contre-limite au principe de primauté, aux côtés de l’identité constitutionnelle/identité nationale et du contrôle ultra vires. Mais, à la différence de celles-ci, elle ne fonctionne pas du tout comme une barrière substantielle ni comme une limite fonctionnelle à la compétence de l’Union. Elle relève d’une logique différente, plus opérationnelle : elle ne protège point ce que l’État est, mais ce sans quoi l’État ne pourrait plus être, c’est-à-dire la continuité même de sa communauté politique et de son « autorité » [imperium].
C’est en ce sens que, comme l’affirme H. Gaudin, l’article 4 § 2 TUE n’institue pas un domaine soustrait à l’Union, mais une « clause dérogatoire exceptionnelle », activable dans des circonstances strictement encadrées et toujours soumises à un contrôle de proportionnalité. La sécurité nationale ne suspend donc pas la primauté : à l’inverse, elle en organise les conditions, en ménageant une marge de manœuvre des États – marge réelle et bienvenue, mais contrôlée, jamais laissée à la seule auto-souveraineté déclarative. Son intérêt tient précisément à ceci : la sécurité nationale ne rompt pas du tout le lien entre l’État et l’Union. Elle n’ouvre pas une sorte d’échappée souverainiste. Non, elle crée un espace de conciliation, une zone passerelle, permettant l’ajustement réciproque des droits fondamentaux européens et des exigences constitutionnelles de la défense. À cet égard, la sécurité nationale se rapproche davantage de l’identité nationale de l’article 4 § 2 que de l’ultra vires : elle participe à la construction d’un pluralisme ordonné – d’un ordre juridique « rhizomatique » –, non à une confrontation. Bref, elle est peut-être l’occasion d’une (ré)conciliation. Du moins, il faut l’espérer…
Par ailleurs, grâce à la sécurité nationale, consacrée par l’article 4 § 2 TUE, la Cour du Luxembourg finit par réaliser un contrôle dans un domaine où elle n’était pas censée intervenir. Témoin de la spécificité de l’Union et de son droit, ce paradoxe révèle, en parallèle, que l’UE ne saurait exister et subsister qu’avec des États aptes à assurer la continuité de leur ordre politique. Finalement, contrôler l’invocation de la sécurité nationale, cela ne revient pas à affaiblir l’État ; c’est, en un certain sens, un moyen de préserver cette confiance mutuelle qui est au fondement l’Union européenne en tant qu’Union de droit. C’est pourquoi la sécurité nationale n’apparaît nullement comme une contre-limite contre l’Europe, mais comme la condition politique de sa possibilité. Elle est le lieu d’un équilibre difficile où l’État continue d’assurer la défense de la communauté, tandis que l’UE garantit que cette défense ne se fasse jamais au prix des valeurs communes qui la sous-tendent : l’État de droit, les droits fondamentaux, pour ne mentionner qu’elles. Au total, la sécurité nationale ne doit pas être saisie comme un « dehors » ; elle est, au contraire, un « passage ». Celui par lequel l’Union et l’État ne s’opposent pas, mais peuvent se rencontrer.
[1] H. Gaudin, « La clause de sécurité nationale de l’article 4 § 2 TUE, ultime contre-limite ? », in Le Droit européen, source de droits, source du droit : Mélanges en l’honneur de Vassilios Skouris, Mare & Martin, Paris, 2022, pp. 177-198.
[2] B. Warusfel, « Article 4, § 2, TUE – Le respect par l’Union européenne de l’identité et de la sécurité nationales », in E. Bernard et al. (dir.), L’Union européenne de la défense, Bruylant, Bruxelles, 2024, pp. 65-77.
[3] La CJUE s’inscrit ici, finalement, dans une ligne jurisprudence constante : depuis l’arrêt SIMAP (2000) jusqu’à CCOO (2019), elle affirme que le droit au repos est un droit fondamental garanti par l’article 31 § 2 de la Charte.