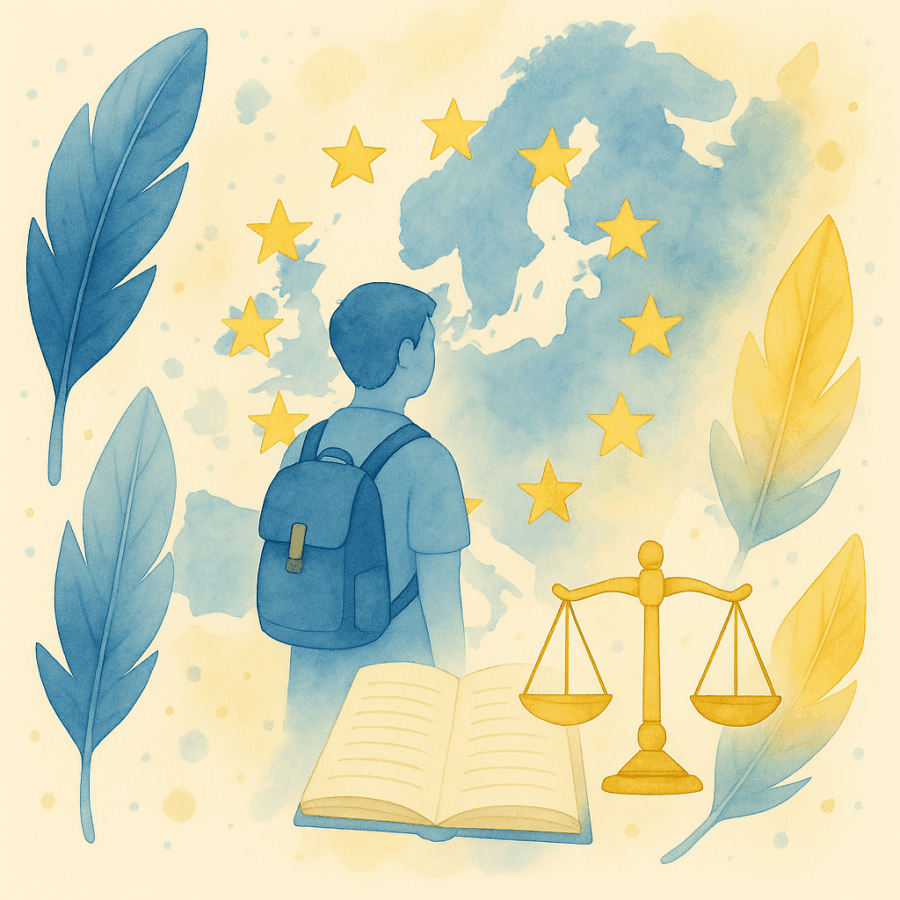Le lancement de la citoyenneté de l’Union
« Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas » – Articles 9 TUE et 20§1er TFUE.
Il y a un avant et un après Rudy Grzelczyk.
Avant, bien sûr, à l’occasion du traité de Maastricht (1992), il y a l’introduction de la citoyenneté européenne dans le traité1https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:11992E/TXT, sans elle, rien n’aurait été possible. Néanmoins, la révolution de la citoyenneté européenne restait inachevée, faute d’avoir reçu une concrétisation juridique. En attestent les débats doctrinaux et, malgré l’audace, dès 1992, de l’arrêt Micheletti2https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:61990CJ0369, les hésitations de la Cour de justice3Par ex., les arrêts du 12 mai 1998, Martínez Sala, C-85/96 et du 24 novembre 1998, Bickel et Franz, C-274/96 qui culminent sans doute dans l’arrêt Wijsenbeek du 21 septembre 19994https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:61997CJ0378 rendu sur conclusions contraires de l’avocat général Cosmas.
On hésite parfois à reprendre des affirmations célèbres de la Cour de justice de peur d’être accusé de dogmatisme. Il est pourtant difficile de ne pas le faire dans le cas l’arrêt Grzelczyk. On s’y prêtera donc en rappelant que, en combinaison avec le principe de non-discrimination, « le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres permettant à ceux parmi ces derniers qui se trouvent dans la même situation d’obtenir, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique »5Grzelczyk, pt 31.
La force et la solennité de l’énoncé procède au lancement juridique de la citoyenneté européenne, de la notion, du statut et des droits qui lui sont attachés, bien loin de ce qui était le ressortissant des États membres voire, par la suite, le ressortissant communautaire6Voir par ex. CJCE, 14 juillet 1977, Sagulo, 8/77.
Et après ? Il est difficile de faire le décompte de la filiation Grzelczyk ! Complétée et confortée en 2002 par l’arrêt Baumbast7https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:61999CJ0413 relatif à la plénitude des droits de circulation et de séjour des citoyens européens, la jurisprudence se déploie dans de nombreuses directions allant jusqu’à égratigner des législations nationales – état civil, mariage, adoption, nationalité, … – que l’on pensait hors de portée du droit de l’Union. Elle est accompagnée de contestations grandissantes sur la compétence de contrôle de la Cour, à l’image de celles, récentes, soulevées par l’affaire maltaise dite des Golden Passeports8https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62023CJ0181. Il n’en reste pas moins que la citoyenneté de l’Union relève des dispositions fondamentales des traités, qu’elle concrétie le principe de solidarité , et participe du processus d’intégration9Commission c/Malte, pt 93.
Une autre manière de penser l’Union et son droit, c’est aussi à cela que nous invite l’arrêt Grzelczyk, à l’instar, sans contestation, des arrêts Van Gend en Loos, Costa c/ENEL, Internationale Handelsgesellschaft, Les Verts, de l’avis 2/13, ou bien encore des affaires Association syndicale des juges portugais, Wightman, ou des arrêts sur la conditionnalité10https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0156; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0157 ; liste indicative !
La jurisprudence Grzelczyk, c’est donc, en premier lieu, le lancement d’un statut et des droits qui lui sont rattachés.
Instituée par l’Union comme le précise l’art. 20§1er TFUE, la citoyenneté de l’Union est un statut européen dont la logique prolonge celle du ressortissant communautaire. Elle est, comme lui, intrinsèquement liée à la non-discrimination en raison de la nationalité. Mais elle dépasse le lien historique en estompant les questions de nationalité. C’est le cas de l’affaire Grzelczyk, mais aussi, par exemple, précocement Martínez Sala, ou Bickel et Franz, ou bien encore des affaires Bidar, de 2005, Huber, de 2008, et dans le cas d’une demande d’extradition vers un pays tiers, Raugevicius en 2018. En tant que statut européen, elle autorise un contrôle de la Cour sur le retrait/perte et attribution de la nationalité. Si l’affirmation paraît simple, elle cache pourtant la sensibilité et la complexité d’un tel contrôle car pesant sur les législations des États membres afférentes11Micheletti, préc.. C’est l’arrêt Rottmann de 2010 qui est venu fixer les modalités de ce contrôle notamment quant au retrait ou à la perte de nationalité, entraînant la perte de la citoyenneté européenne12jurisprudence constante : Tjebbes en 2019, ou encore JY en 2022. Peut-être plus complexe est le contrôle sur l’attribution de la nationalité. Evoqué dans l’affaire Zhu et Chen en 2004, il est aligné sur le contrôle du retrait dans l’affaire des Golden Passports. Quelle que soit l’hypothèse (retrait/attribution), le contrôle de la Cour est d’une part limité dans son intensité et, d’autre part, renvoyé concrètement aux juridictions nationales.
La qualification de statut fondamental attribuée par la Cour à la citoyenneté européenne est solennelle. Sa signification mérite d’être éclairée. Fondamental, c’est-à-dire protégé au plus haut niveau des traités. Fondamental, c’est-à-dire lié à la Charte des droits fondamentaux de l’Union dont le préambule énonce que l’Union place la personne au cœur de son action (notamment) en instituant la citoyenneté de l’Union13https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016P000 et le titre V est consacré à la citoyenneté. Dans ce cadre, les droits et libertés du citoyen de l’Union se répartissent principalement entre ceux, liés à l’Espace de liberté, sécurité et justice, de circulation et séjour14Par ex. Garcia Avello, 2003 ; Coman, 2018 ; Pancharevo, 2021 et ceux liés à la vie démocratique de l’Union (par ex. Espagne c/Royaume-Uni en 2006 ; Commission c/République tchèque et Commission c/Pologne ; Commission c/Malte préc.). Un rééquilibrage bienvenu entre les deux branches a été opéré par l’arrêt des passeports maltais de 2025 et rapproche la citoyenneté européenne de ce modèle qui est celui de la dual citizenship.
Fondamental, son expression la plus évidente se trouve dans l’arrêt Ruiz-Zambrano de 2011 : « l’article 20 TFUE s’oppose à des mesures nationales ayant pour effet de priver les citoyens de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union »15https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62009CJ0034, pt 42 ; voir aussi l’arrêt Rendón Marín de 2016/mfn] et dans un sens similaire les conclusions de Tamara Ćapeta sur Safi. L’ensemble de ces droits est, conformément à l’article 52§2 de la Charte, prioritairement adossé aux traités. La jurisprudence Grzelczyk, c’est ensuite un débat ouvert sur la question du champ d’application du droit de l’Union. Si l’article 20 TFUE énumère les droits du citoyen de l’Union (droit de circuler et séjourner librement, droit de vote et d’éligibilité au Parlement européen ainsi qu’aux élections municipales dans l’État membre dans lequel il réside, droit à la protection diplomatique et consulaire, droit d’adresser des pétitions au Parlement européen, droit de recourir au médiateur européen, droit de s’adresser aux institutions de l’Union dans sa langue…. l’ensemble de ces droits étant repris aux articles 39 à 45 de la Charte), l’article 20, dans son dernier alinéa précise que « ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». Cette précision est d’importance au point qu’on la trouve reprise, à l’identique à l’article 21§1er TFUE, et de manière équivalente à l’article 52§1er de la Charte. Une telle formulation se rattache à la question du champ d’application. Posée pour la citoyenneté de l’Union, elle rejoint celle de longue date liée aux droits fondamentaux (ERT 1991), réglée à l’article 51 de la Charte, et confirmée par la Cour (Akerberg Fransson, 2013). On la retrouve également concernant le principe de non-discrimination, et plus récemment le droit à la protection juridictionnelle effective de l’article 19 TUE, voire, globalement, les valeurs de l’article 2 TUE (dont la résolution pourrait être apportée par l’arrêt à venir Commission c/Hongrie, C-769/22). Elle est le symbole que l’Union n’a que des compétences d’attribution et non une compétence générale. Le déclenchement de la protection liée à la citoyenneté européenne est subordonné à l’existence d’ un lien de rattachement avec une situation placée sous l’emprise du droit de l’Union (Carpenter, 2002), sans que la qualité de ce lien ne soit vraiment défini (Lounes, 2017). Additionner citoyenneté européenne, non-discrimination et liberté de circulation/séjour amène la Cour à étendre sa compétence de contrôle sur des domaines non régis par le droit de l’Union – y compris conçus de manière large – dans une logique de non-affectation des droits du citoyen européen. Enfin, une de ses principales spécificités réside dans la constitution autour du statut de citoyen européen d’un champ d’application personnel, bien éloigné des conceptions matérielles traditionnelles en droit de l’Union (voir pourtant Mesbah, 1999). Dans certains cas, la possession du statut déclenche seule la protection du droit européen, que l’on ait circulé ou non (Mc Carthy, 2014 et bien sûr Ruiz-Zambrano, préc.). La jurisprudence Grzelczyk, c’est enfin l’interrogation qu’elle déclenche sur les rapports entre le citoyen européen et l’Union. C’est de longue date, et à propos d’abord des emplois dans l’administration publique, que la Cour de justice s’est interrogé sur le caractère particulier du lien de nationalité entre un État et ses ressortissants [CJCE, 17 décembre 1980, Commission c/Belgique, C-149/79]. La définition actuelle de ce lien de nationalité est fixé par l’affaire Rottmann de 2010 [pt 51] : il est fondé sur un « rapport particulier de solidarité et de loyauté entre l’État et ses ressortissants ainsi que (sur) la réciprocité de droits et de devoirs » – définition reprise dans l’affaire maltaise [point 96] – qu’il est « légitime pour un État de vouloir protéger ». La Cour de justice s’est également penchée sur la nature du lien qui peut exister entre un citoyen de l’Union et l’État dans lequel il réside, sans en posséder la nationalité, et qui est guidée par l’idée d’intégration 15Par ex., CJCE, 7 septembre 2004, Michel Trojani, C-456/02 ou encore CJUE, 18 décembre 2019, U.B., C-447/18, pt 47. L’attribution d’un droit de vote aux élections locales va en ce sens.
Dans une perspective prospective, ce qu’il est intéressant d’envisager, est le lien qui court de l’arrêt Grzelczyk à l’arrêt Commission c/Malte sur les relations entre le citoyen européen et l’Union. La Cour les fonde en 2025 sur l’article 20§2 1ère phrase TFUE dont il ressort que « les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Conformément au §1 de cet article 20, le rapport particulier de solidarité et de loyauté existant entre chaque État membre et ses ressortissants constitue également le fondement des droits et obligations que les traités réservent aux citoyens de l’Union »16Malte, pt 97. Il existerait donc une duplication au niveau de l’Union de ce lien spécial que la Cour s’était plu à définir, concernant les États membres, dès 1980.
Concrètement, trois domaines le manifestent ; apparus progressivement dans la jurisprudence, ils concernent l’extradition, la vie démocratique de l’Union et enfin la protection diplomatique et consulaire.
La question de l’extradition d’un citoyen européen ayant fait usage de sa liberté de circulation dans un autre État membres a conduit la Cour à s’interroger sur la protection que celui-ci pouvait attendre de la part du droit de l’Union. Dans une jurisprudence constante et riche17CJUE, GC, 6 décembre 2016, Petruhhin, C-182/15, pt 60 ; GC, 13 novembre 2018, Raugevicius, C-247/17, pt 49 ; GC, 22 décembre 2022, SM, C-237/21, elle a étendu la protection européenne à celui-ci au nom du principe de non-discrimination, des libertés de circulation, des droits de la Charte, le tout sous l’égide de la coopération nécessaire entre l’État membre de résidence et celui d’origine du citoyen européen. Notamment, un État saisi d’une demande d’extradition d’un citoyen européen, doit impérativement vérifier que « l’extradition ne portera pas atteinte aux droits visés à l’article 19 de la Charte »18Petruhhin, pt 60, Raugevicius, pt 49.
Par évidence terminologique, citoyenneté européenne et vie démocratique de l’Union entretiennent des liens consubstantiels : la citoyenneté appelant la participation à la vie de la cité, serait-elle européenne. Si cette facette démocratique ne s’est pas principalement développée dans un premier temps, c’est chose faite maintenant et avec la solennité des affirmations de l’arrêt Commission c/Malte : « en exerçant les droits politiques que leur confèrent les articles 10 et 11 TUE, les citoyens de l’Union participent directement à la vie démocratique de l’Union. En effet, son fonctionnement est fondé sur la démocratie représentative, laquelle concrétise la valeur de démocratie qui constitue, en vertu de l’article 2 TUE, l’une des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée [voir, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2019, Puppinck e.a./Commission, C‑418/18 P, EU:C:2019:1113, pt 65 ; du 19 novembre 2024, Commission/République tchèque (Éligibilité et qualité de membre d’un parti politique), C‑808/21, EU:C:2024:962, pts 114 et 115, ainsi que du 19 novembre 2024, Commission/Pologne (Éligibilité et qualité de membre d’un parti politique), C‑814/21, EU:C:2024:963, pts 112 et 113] »19Commission c/Malte, pt 89.
Enfin, la protection diplomatique et consulaire, mise en place aux articles 20§2 et 23 TFUE, avait pu laisser dubitatif tant quant à sa nature et ses modalités. Ici encore l’arrêt Commission c/Malte vient relancer, de manière prospective, ces droits qui vont dans le sens d’un lien de rattachement et d’un lien de protection entre le citoyen européen et l’Union20Ibid. pt 90.