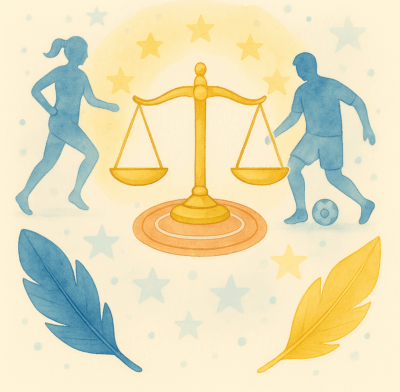Commentaire comparé des arrêts CrEDH, 10 juillet 2025, Semenya c. Suisse, req. n°10934/21 (GC) et CJUE, 1er août 2025, Royal Football Club Seraing, affaire C-600/23 (GC).
Par deux arrêts[1], l’un du 10 juillet 2025 de la Cour européenne des droits de l’Homme – la CEDH –, Semenya c. Suisse, et l’autre du 1er août 2025 de la Cour de Justice de l’Union européenne – ci-après la CJUE –, Royal Football Club Seraing, les deux Cours se sont prononcées sur la portée et l’efficacité des sanctions du Tribunal arbitral du Sport – TAS – et le contrôle juridictionnel effectif de ces sanctions.
L’affaire Semenya concernait la violation du droit à un procès équitable de l’article 6§1 de la Convention après le rejet du recours en contestation d’une sentence arbitrale du Tribunal Arbitral du Sport – ci-après TAS – par le Tribunal fédéral suisse. La CEDH a indiqué que le Tribunal fédéral n’a pas fait preuve d’un examen circonstancié et rigoureux de la situation pour fonder sa décision, ce qui contrevient à l’article 6§1 de la Convention.
Dans l’affaire RFC Seraing, qui concernait la contestation de sanctions de la FIFA suite à la conclusion d’accords de financement entre le RFC Seraing avec la société maltaise Doyens Sports, qui contreviendraient au règlement de la FIFA. Ces sanctions ont été confirmées par le TAS puis par le Tribunal fédéral. Par renvoi de la Cour de cassation belge de deux questions préjudicielles à la CJUE, celle-ci a considéré qu’il ne peut être donné autorité de chose jugée à une décision arbitrale qui ne respecte pas l’« ordre public de l’Union européenne ».
Ces deux affaires traitent de la teneur du contrôle juridictionnel des sentences arbitrales prononcées par le TAS, avec, d’une part le droit de la Convention européenne des droits de l’Homme – ci-après la Convention –, et d’autre part, avec le droit de l’Union européenne. La CEDH et la CJUE ont deux approches différentes du contrôle juridictionnel, mais elles convergent toutes deux vers le principe d’un contrôle effectif des sentences arbitrales sportives forcées pour le respect des droits fondamentaux et du droit européen.
L’approche substantielle du contrôle des sanctions par la CEDH dans l’affaire Semenya :
Dans l’affaire Semenya c. Suisse, une athlète internationale de nationalité sud-africaine spécialisée dans les courses de fond et sacrée plusieurs fois mondialement, devait se soumettre à des traitements hormonaux pour participer aux compétitions féminines, car d’après le règlement régissant la qualification des femmes présentant une hyperandrogénie de l’Association internationale des fédérations d’athlétisme – ci-après IAAF –, pour que les athlètes intersexes puissent participer aux compétitions féminines, leur taux de testostérone dans le sang devait être inférieur à 5 nmol/L. La requérante a, par la suite saisi le TAS[2] en contestation de ce règlement. Le 30 avril 2019, les conclusions de la requérante ont été rejetées par celui-ci. Le 28 mai 2019, la requérante saisit le Tribunal fédéral suisse[3] d’un recours visant l’annulation de la sentence du TAS. Le 25 août 2020, le Tribunal rejeta le recours en concluant que la sentence n’était pas incompatible avec l’ordre public matériel suisse au sens de l’article 190 al. 2 e) de la loi fédérale sur le droit international privé. Par la suite, la décision de la troisième section de la CEDH a fait l’objet d’un renvoi devant la Grande Chambre, sur demande du Gouvernement suisse en vertu de l’article 43 de la Convention le 9 novembre 2023 (§6). Remettant en cause l’arrêt de la Chambre, la Grande chambre a déclaré irrecevables les griefs relatifs aux articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif devant une instance nationale) et 14 (interdiction de la non-discrimination). Elle a répondu à la question de savoir si la requérante avait eu accès, par le biais du TAS à un tribunal établi par la loi au sens de l’article 6§1 de la Convention sur le droit à un procès équitable.
Tout d’abord, la Cour rappelle que l’arbitrage et l’existence de tribunaux arbitraux n’est pas contraire aux dispositions de la Convention et notamment à l’article 6 et que dans le cadre de la pratique professionnelle des sports, les différends soient tranchés par un tribunal arbitral international unique selon une procédure uniformisée, rapide et économique avec une possibilité de recours devant une juridiction étatique en première ou deuxième instance (§195).
Elle n’exclut pas que l’arbitrage puisse ainsi être imposé par la loi, mais que cette procédure doit fournir des garanties d’indépendance et d’impartialité suffisantes, comparables à un tribunal ordinaire, car, d’une part, les instances sportives sont des entités de droit privées, certes, mais leurs compétences s’apparentent au pouvoir règlementaire, si bien qu’elles agissent comme des organismes de droit public (§§201,202) ; et, d’autre part, du fait de la structuration même de l’arbitrage sportif, avec une prédominance des organes de gouvernance du sport, ceux-ci sont dans une position dominante, leur permettant, en tant qu’entité privée d’édicter leurs règlementations, en imposant notamment la compétence du TAS et créant nécessairement un déséquilibre structurel dans les relations entre les sportives et les sportifs et les organes de gouvernance (§§200, 203, 204). De ce fait, il est indispensable, que les garanties procédurales respectent l’article 6 de la Convention, comme le rappelle la Cour, son respect revêtant « une importance particulière lorsque le ou les droits « de caractère civil » sur lesquels portent la contestation correspondent en droit interne à des droits fondamentaux » (§206).
Dans ce cadre, le rôle du Tribunal fédéral en cas de saisine en contestation d’une sentence arbitrale doit être rigoureux dans son appréciation des sentences arbitrales sportives, au regard du respect de l’article 6 de la Convention et plus largement du respect des droits de la Convention.
Selon la Cour, le Tribunal fédéral n’a pas réalisé un examen rigoureux et proportionné de la sentence du TAS et de ses conséquences vis-à-vis de la requérante, au regard de l’article 6 puisqu’il s’agissait d’un arbitrage imposé « qui concernait un litige relatif à des droits « de caractère civil », au sens de l’article 6 § 1, correspondant en droit interne à des droits fondamentaux » (§216), et, qu’en l’espèce, la règlementation de l’IAAF permettait une ingérence dans l’intimité et la dignité de celle-ci en la soumettant à des traitements chimiques et examens médicaux contraignants[4]. Elle rappelle, à ce titre, la responsabilité de l’État dans le cadre du contrôle de proportionnalité des sentences arbitrales, telle qu’établie dans l’arrêt Mutu et Pechstein[5] de 2007.
La Cour considère que le Tribunal fédéral a bien relevé que le règlement était discriminatoire (§223) mais n’a pas suffisamment analysé si le règlement DDS avait un caractère raisonnable et proportionné, ce qui était le cœur de la contestation de la requérante, bien qu’il exprime, comme le relève la Cour, un doute quant à la proportionnalité du règlement (ibid).
Pareillement, elle relève que l’examen de la sentence avec l’ordre public matériel n’est pas suffisamment approfondi. Le Tribunal fédéral s’est borné à une appréciation classique de la sentence arbitrale, similaire aux sentences commerciales sans tenir compte de la particularité des sentences arbitrales sportives et de la rigueur que doivent apporter les instances nationales en cas de contestation.
La Cour instaure un « pare-feu », lequel doit permettre un contrôle renforcé des procédures d’arbitrage sportif, eu égard leur particularité : le risque de sentences arbitraires que cette mesure aspire à limiter autant que possible.
L’arrêt FC Seraing et l’approche formelle du contrôle juridictionnel des sentences arbitrales sportives à l’aune du droit de l’Union européenne :
Dans cette affaire, le club de football RFC Seraing a conclu deux contrats avec la société maltaise Doyens Sports Investment Ltd deux contrats financiers, le premier ayant pour objet l’encadrement des conventions de financement des joueurs, et, le second, cédant des parts économiques sur un joueur à la société Doyen Sports. A la suite de la conclusion de ces contrats et d’une enquête, la FIFA a ouvert le 2 juillet 2015 une procédure disciplinaire à l’encontre du club ayant abouti à une sanction de celui-ci, le règlement de la FIFA interdisant la pratique des « third party ownership ». Ayant interjeté appel de la sanction, la commission de sanction de la FIFA a rejeté le 7 janvier 2016 l’appel du club. Le 9 mars 2016, le RFC Seraing a introduit un recours en annulation contre la décision de la commission de recours de la FIFA devant le TAS, tout en demandant à ce qu’un effet suspensif soit donné à l’appel. Se prononçant le 9 mars 2017 par une sentence arbitrale, le TAS a rejeté les conclusions du club, en ce que la décision de la commission de recours était fondée sur des dispositions illégales et a également indiqué qu’il n’y avait pas de violation de la liberté de circulation des travailleurs, de la liberté de prestation de services et de la liberté des mouvements de capitaux respectivement garanties par les articles 45, 56 et 63 TFUE ainsi que des règles de concurrence énoncées aux articles 101 et 102 TFUE.
Le RFC Seraing a alors saisi le Tribunal fédéral en annulation de cette sentence, tout en donnant un caractère suspensif au recours, le 15 mai 2017. Celui-ci a rejeté le recours.
Parallèlement, le club avait interjeté appel de la sentence de la commission de recours de la FIFA devant la Cour d’appel de Bruxelles, qui a rejeté l’ensemble des demandes du club le 12 décembre 2019. Après pourvoi du club auprès de la Cour de cassation, celle-ci sursoit à statuer pour poser deux questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union européenne, à savoir si « l’article 19, paragraphe 1, TUE, lu en combinaison avec l’article 267 TFUE et l’article 47 de la Charte, fait obstacle à l’application de dispositions de droit national telles que les articles 24 et 171[3], § 9, du [code judiciaire], tendant à sanctionner le principe de l’autorité de la chose jugée, à une sentence arbitrale dont le contrôle de conformité au droit de l’Union […] a été effectué par une juridiction d’un État non membre de l’Union, non admise à saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle » et si « l’article 19, paragraphe 1, TUE, lu en combinaison avec l’article 267 [TFUE] et l’article 47 de la Charte […], fait obstacle à l’application d’une règle de droit national accordant à l’égard des tiers une force probante, sous réserve de la preuve contraire qu’il leur incombe de rapporter, à une sentence arbitrale dont le contrôle de conformité au droit de l’Union a été effectué par une juridiction d’un État non membre de l’Union, non admise à saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ».
La CJUE rappelle que le droit de l’Union européenne ne s’oppose à l’arbitrage (§78) mais que celle-ci doit respecter l’ordre public de l’Union européenne, ce qui doit être effectué par les juridictions nationales. S’agissant des sentences arbitrales sportives, qui concernent des activités économiques se déroulant sur le territoire de l’Union européenne, elle indique que le contrôle est nécessaire (§91), car elles ne pas doivent aboutir à une limitation de la liberté de circulation des travailleurs, de la liberté de prestation de services et de la liberté des mouvements de capitaux ainsi que l’exercice du droit de la concurrence, qui sont garanties par le droit de l’Union européenne[6]. De ce fait, elle précise que l’existence d’une voie de recours juridictionnel à l’égard des sentences arbitrales sportives est obligatoire ; en rappelant les obligations découlant de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux et de l’article 19 al. 1er TUE (§83). Elle conclut dans l’affaire, par son approche formelle, que la sentence arbitrale du TAS doit pouvoir effectivement faire l’objet d’un recours en annulation devant une juridiction nationale, mais que la possibilité juridictionnelle de la sentence du TAS face au droit de l’Union européenne n’existe pas, puisqu’il s’agit d’un recours en annulation devant les juridictions suisses, qui est un État tiers à l’Union européenne. Donc, il peut lui être octroyé l’autorité de chose jugée.
La portée du contrôle juridictionnel des sentences arbitrales dans le sport au regard des deux arrêts :
Ces deux arrêts, de manière contrastée, ont rappelé que le recours à l’arbitrage, imposé par la loi ou non, est un usage largement accepté, dont les sentences, plus encore en matière sportive, doivent nécessairement faire l’objet d’un contrôle avec les droits de la Convention d’une part, et le droit de l’Union européenne et des Traités d’autre part.
La CEDH, par son approche substantielle, indique que peu importe la nature de la sentence et des faits, il faut que la sentence prenne toute la mesure et la teneur des droits et libertés fondamentaux garantis par la Convention, sans cela, la sentence constitue une décision contraire aux droits garantis par celle-ci.
Il peut être interrogé sur la possibilité d’élargir cette prise en considération stricte du respect des droits fondamentaux aux autres domaines pouvant faire l’objet de sentences arbitrales, et ne pas limiter ce contrôle juridictionnel effectif uniquement au domaine sportif[7].
Par son approche plus formelle, la CJUE, indique que les sentences arbitrales sportives doivent faire l’objet d’un contrôle, mais de manière plus limitée, si elles concernent le droit de l’Union européenne, si la pratique sportive constitue une activité économique et si elle met en jeu l’ordre public de l’Union européenne.
Dans les deux arrêts, le contrôle juridictionnel effectif des sentences arbitrales sportives apparaît essentiel pour la garantie du principe de sécurité juridique. Pour Johan CALLEWERT[8], l’approche de la CJUE est plus limitée mais permet une meilleure garantie de la sécurité juridique. Devant la CEDH, le contrôle juridictionnel dépend, certes, de la casuistique mais il n’est pas limité puisqu’il concerne tous les droits de la Convention et s’applique à tous les États membres de la Convention.
Il reste, cependant, que les deux approches se complètent, et permettent, lorsque qu’une sentence arbitrale est prononcée, un contrôle rigoureux de leur portée, mais ces deux approches distinctes peuvent également mener à des conflits d’application de la sentence, si elle apparaît conforme aux droits de la Convention mais contraire au droit de l’Union européenne[9]. Si cette constellation se présentait, pour préserver l’autonomie du droit de l’Union européenne, la sentence serait soumise au droit de l’Union européenne, en dépit de la CEDH mais ceci interroge sur l’articulation entre les deux Cours dans le contrôle des sentences arbitrales sportives et plus largement des sentences arbitrales.
[1] V. également « Obligation du Tribunal fédéral suisse d’exercer un contrôle rigoureux de la sentence du Tribunal arbitral du sport à l’aune de l’article 6 de la Convention », in : GPL 21 oct. 2025, n° GPL482x7, note J. Andriantsimbazovina.
[2] Le TAS est une juridiction arbitrale vouée à la résolution des litiges dans le cadre de l’exercice professionnel d’activités sportives.
[3] Le TAS étant établi à Lausanne, en Suisse, toute contestation d’une sentence arbitrale a lieu devant le Tribunal Fédéral suisse.
[4] Dans l’arrêt de troisième section du 11 juillet 2023, la CEDH n’a pas suivi un raisonnement tourné vers le respect des droits substantiels, notamment des articles 8 et 14 de la Convention, mais sur la présence de garanties institutionnelles et procédurales suffisantes (§§ 170, 205).
[5] Cf. CEDH, du 4 février 2019, Mutu et Pechstein c. Suisse, req. n°40575/10 et 67474/10.
[6] Cf. Olivier Vibert, “ Le contrôle juridictionnel effectif des sentences du TAS est requise par le droit européen » [En ligne].
[7] Cf. Gordon Nardell, Fiona Petersen (Twenty Essex Chambers) “Arbitration and Human Rights Following Semenya v Switzerland: The Commercial “Firewall” and EU law” [En ligne].
[8] Johan CALLEWERT, « Different but compatible approaches to international sports arbitration: comparing Semenya (ECtHR) with Royal Football Club Seraing (CJEU)” [En ligne], 2025.
[9] Bien que, comme le rappelle l’article 53 ChUE, il n’est pas exclu que le niveau de protection des droits fondamentaux par le droit de l’Union européenne soit plus élevé que celui de la CEDH.
Par Maéva EDDOUH
Doctorante à l’Université Toulouse-1 Capitole