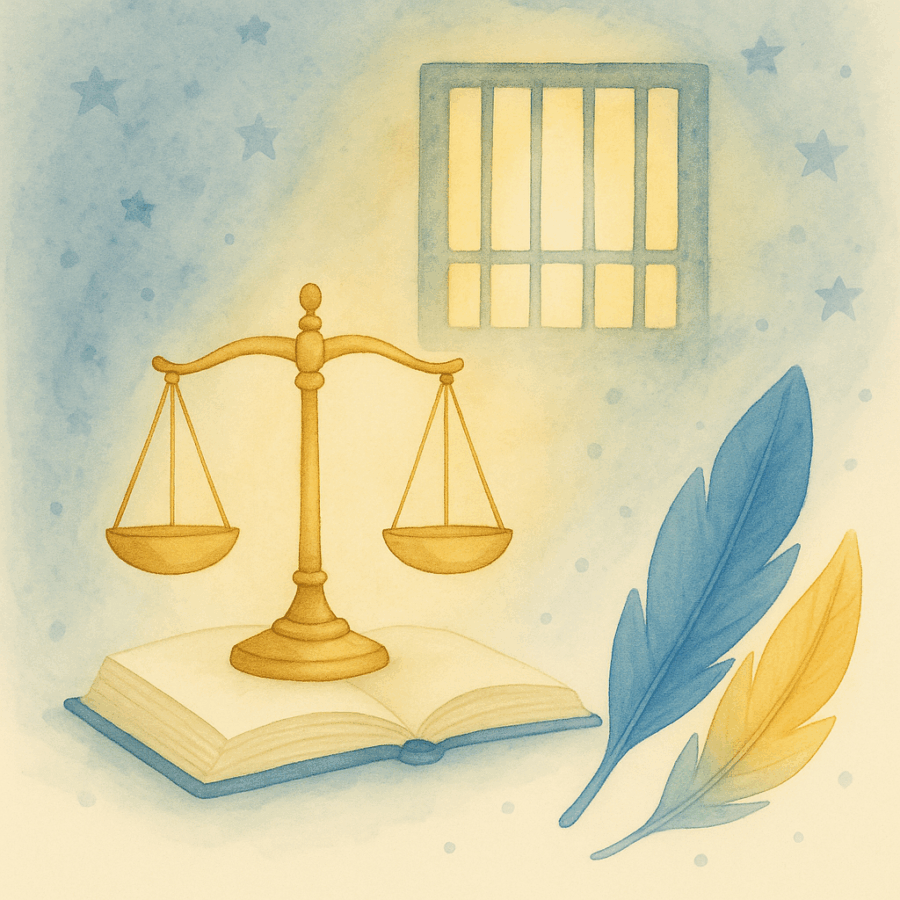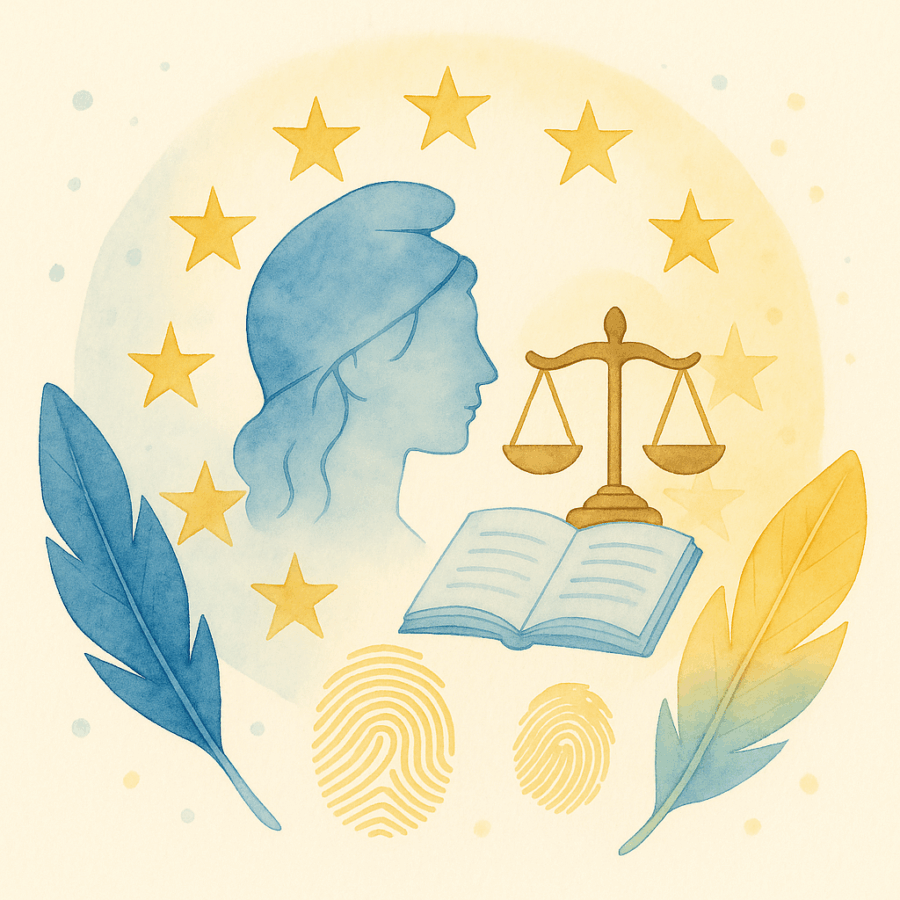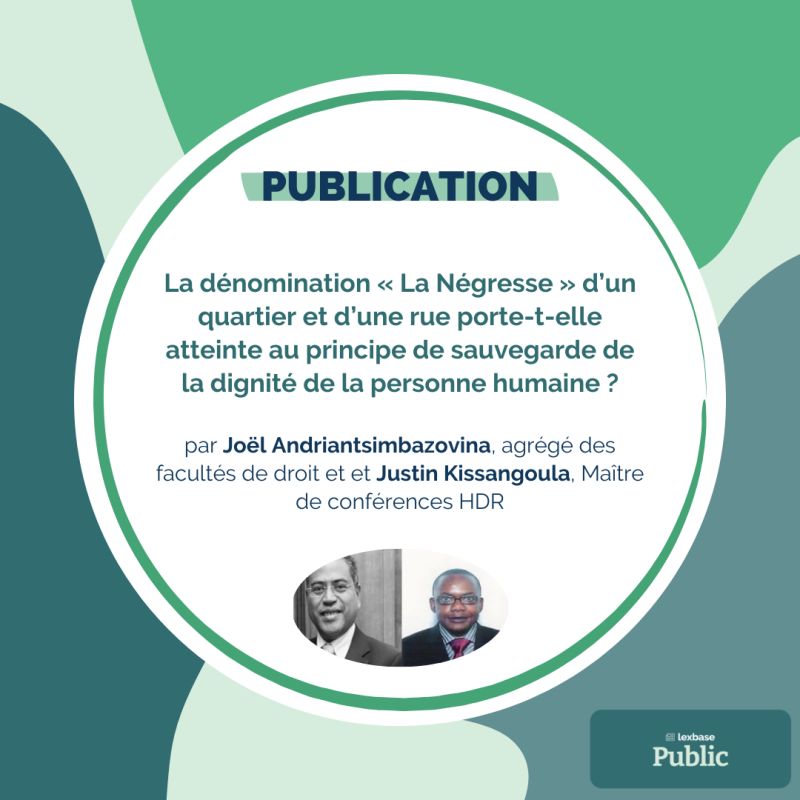CEDH, Gde ch., 26 octobre 2000, n°30210/96
L’effectivité du droit au recours et la dignité des conditions de détention
À l’heure des tentations de remise en cause du recours au juge et de l’appel au durcissement des conditions de détention des prisonniers, le rappel des grands principes énoncés par la Cour européenne des droits de l’homme (la CEDH), en grande chambre, dans l’arrêt Kudla, 25 ans après, est une nécessité.
Rendu sous la présidence de Luzius Wildhaber, avec une implication décisive de Jean-Paul Costa[1], l’arrêt Kudla est à l’origine de deux évolutions majeures concernant le droit à un recours effectif d’une part et les conditions de détention de l’autre[2].
L’affranchissement et le déploiement du droit à un recours à un effectif
Considérée comme « obscure »[3], la disposition de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la Convention)[4], qui proclame le droit à un recours effectif, resta dans la brume jusqu’à l’arrêt Kudla[5].
Hormis le fait que tout requérant qui allègue un grief « défendable » au regard de la Convention peut se prévaloir du droit à un recours effectif (CEDH, Plén., Boyle et Rice c/ Royaume-Uni, 27 avr. 1988, n° 9658/82, § 52), ce dernier était dissimulé derrière le droit d’introduire un recours devant un tribunal garanti par l’article 5 § 4 et le droit à un tribunal indépendant et impartial proclamé par l’article 6§1. Il était considéré soit comme accessoire du premier droit (CEDH, Plén., Young, James et Webster c/ Royaume-Uni, 13 août 1981, n° 7806/77, § 67) soit comme incorporé dans le second (CEDH, Airey c/ Irlande, 9 oct. 1979, n° 6289/73, § 35). De plus, au vu de la rédaction de l’article 13, le droit à un recours effectif dépend des autres droits garantis par la rédaction. En dépit de la relativisation de cette dépendance par la CEDH à travers la reconnaissance d’une autonomie du grief tiré du droit à un recours effectif (CEDH, Plén., Klass c/ Allemagne, 6 septembre 1978, n° 5029/71, § 64 ; CEDH, Silver et autres c/ Royaume-Uni, 25 mai 1983, n° 7136/75, § 113), l’article 13 était cantonné dans un rôle de figurant.
Tout cela constituait une anomalie au regard de l’origine de ce droit tel qu’il est énoncé à l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, source d’inspiration de l’article 13 de la Convention : offrir à toute personne le « droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi ». Cette situation était incohérente à l’aune de la structuration du système de protection institué par la Convention : caractère prioritaire de la protection offerte au niveau national, subsidiarité de la protection assurée par la CEDH.
Consciente de ces imperfections, la Grande chambre de la CEDH y mit fin dans l’arrêt Kudla.
Après avoir constaté qu’elle avait tendance à minimiser l’article 13 par rapport à l’article 6§1 de la Convention, la CEDH reconnaît que « le temps est venu de revoir sa jurisprudence eu égard à l’introduction devant elle d’un nombre toujours plus important de requêtes dans lesquelles se trouve exclusivement ou principalement allégué un manquement à l’obligation d’entendre les causes dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 §1 » (§ 148). Elle « perçoit à présent la nécessité d’examiner le grief fondé par le requérant sur l’article 13 considéré isolément, nonobstant le fait qu’elle a déjà conclu à la violation de l’article 6, §1 pour manquement à l’obligation d’assurer à l’intéressé un procès dans un délai raisonnable (…) » (§ 149).
Grâce à l’arrêt Kudla, les systèmes juridiques nationaux ont l’obligation de prévoir un recours destiné à redresser les violations de la Convention de même que le droit à un recours effectif offre une nouvelle dimension au principe de subsidiarité[6].
En effet, le droit à un recours effectif est devenu un levier du développement des recours préventifs contre le délai excessif de jugement et des recours en réparation du préjudice causé par le délai déraisonnable de jugement dans les systèmes juridiques nationaux (par ex : CEDH, gde ch., Sürmeli c/ Allemagne, 8 juin 2006, n° 75529/01 ; CEDH, gde ch., Apicella et autres c/ Italie, 29 mars 2006, n° 64890/01). Plus largement, l’arrêt Kudla a contribué à déverrouiller des portes jusque-là inaccessibles aux recours de certains justiciables comme certains types de mesures d’ordre intérieur visant des détenus (C.E., 30 juill. 2003, Garde des Sceaux, ministre de la Justice c. Remli, n° 252712).
Allant encore plus loin, l’arrêt Kudla étend l’esprit d’effectivité des recours et de la protection des droits garantis par la Convention à certaines catégories de personnes qui risquent de subir des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention : les étrangers frappés de mesures d’éloignement et les détenus. Concernant les étrangers, l’article 13 pallie l’inapplicabilité de l’article 6§1 aux mesures d’éloignement (CEDH, gde ch., Hirsi Jamaa et autres c. Italie, 23 févr. 2012, n° 27765/09 ; CEDH, gde ch., De Souza Ribeiro c/ France, 13 déc. 2012, n° 22689/07) ; il implique un contrôle rigoureux, une célérité particulière et un redressement approprié de la part de l’instance nationale compétente pour examiner les griefs (CEDH, gde ch., M.S.S c/ Belgique et Grèce, 21 févr. 2011, n° 30696/09).
À propos des détenus, l’arrêt Kudla est le point de départ d’une jurisprudence tournée vers une attention aiguë aux conditions de détention.
L’exigence de conditions de détention compatibles avec le respect de la dignité humaine
En raison de l’absence dans la Convention de dispositions spécifiques relatives aux conditions de détention, le système européen de protection s’est saisi de cette question de façon indirecte notamment à travers l’article 3 de la Convention. Jusqu’à l’arrêt Kudla, le raisonnement reposait sur le fait que les détenus n’étaient pas privés des droits proclamés par la Convention, par exemple l’interdiction des peines ou traitements inhumains et dégradants (Commission EDH, déc., 9 mai 1977, X c/ Suisse, n° 7994/77).
Sans avoir abandonné une telle logique (CEDH, gde ch., Hirst c/ Royaume-Uni n°2, 6 oct. 2005, n° 74025/01, § 69), l’arrêt Kudla change la donne en considérant que : « l’article 3 de la Convention impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis » (§ 94).
En clair, à l’obligation négative de ne pas exposer les personnes privées de liberté à des traitements prohibés par l’article 3 s’ajoute l’obligation positive de leur fournir des conditions de détention en phase avec la dignité humaine.
Cette évolution civilisationnelle prévient les effets pervers d’une époque dominée par une conception vengeresse de la justice à l’égard des détenus ; une époque où l’attention légitime à l’égard des victimes est transformée en une volonté de déshumanisation de la détention. L’arrêt Kudla énonce quelques principes d’humanité qui irriguent la jurisprudence de la CEDH et qui s’imposent aux autorités nationales.
Ainsi, la CEDH met le respect de la dignité humaine au cœur du droit de la détention des personnes privées de liberté. Humilier, avilir, faire peur, rabaisser afin de briser la résistance morale et physique d’un détenu peuvent être constitutifs de traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la Convention (CEDH, gde ch., Idalov c/ Russie, 22 mai 2012, n° 5826/03, § 93). Même en l’absence de telles intentions, l’accumulation d’éléments pouvant conduire à créer chez la personne privée de liberté des souffrances psychologiques ou/et physiques dépassant le niveau acceptable en détention est constitutive de traitement inhumain et dégradant. Cela implique une obligation de l’Etat adhérent « d’organiser son système pénitentiaire de manière à assurer le respect de la dignité des détenus, indépendamment des difficultés financières ou logistiques » (CEDH, gde ch., Mursic c/ Croatie, 20 oct. 2016, n° 7334/13, § 100).
Parmi les phénomènes pouvant conduire à des situations d’inhumanité de la détention, la surpopulation carcérale est l’un des fléaux qui déshonorent certains Etats adhérents à la Convention. La France figure parmi ces Etats membres du Conseil de l’Europe affectés par « un phénomène structurel » de surpopulation carcérale (CEDH, J.M.B et autres c/ France, 30 janv. 2020, n° 9671/15 et autres, § 315). La jurisprudence de la Cour a provoqué des changements de législation (loi n°2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en prison) et de jurisprudence[7]. À noter notamment Cons. const., n° 2009-593 DC, 19 nov. 2009 qui dégage un principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne ; Cons. const., 2 oct. 2020, décision n° 2020-858/859 QPC qui exige du législateur de « garantir aux personnes placées en détention provisoire la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, afin qu’il y soit mis fin » ; Cons. const., 16 avril 2021, n°2021-898 QPC qui exige que la détention soit « en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne humaine ». De même, le juge administratif des référés a tiré les conséquences de la jurisprudence de la CEDH initiée par l’arrêt Kudla en dénonçant l’état de certaines prisons par le biais du référé-liberté (CE., ord. 22 déc. 2012, Section française de l’Observatoire international des prisons, n° 364584 : prison des Baumettes à Marseille ; CE, ord. 30 juill. 2015, Section française de l’observatoire des prisons et ordre des avocats au barreau de Nîmes, n° 392043 : prison de Nîmes), en évaluant le préjudice causé par des conditions de détention contraires à la dignité humaine par l’utilisation du référé-provision (CE, Sec., 6 déc. 2013, Thévenot, n° 363290).
Les actions conjuguées de la cour éminente européenne et des juridictions nationales se heurtent actuellement à une défaillance structurelle de la politique pénale et de la politique carcérale françaises. Ainsi, l’office du juge du référé-liberté ne lui permet pas de prescrire « des mesures d’ordre structurel reposant sur des choix de politiques publiques » (CE, 28 juill. 2017, Section française de l’observatoire international des prisons, n° 410677) et « insusceptibles d’être mises en œuvre à très bref délai » (CE, 19 oct. 2020, Garde des Sceaux, ministre de la Justice c. Section française de l’observatoire international des prisons, n° 439372).
Au 1er juin 2025, le taux de surpopulation carcérale en France atteignait le chiffre vertigineux de 135% (84.447 détenus pour 62.566 places). À rebours des faits, le discours d’une partie de la classe politique est toujours de prôner plus d’incarcération et plus de sévérité en considérant par exemple que les activités éducatives, culturelles et sportives en prison seraient inappropriées.
Dans ce contexte, la jurisprudence Kudla constitue une sorte de phare pour rappeler la société européenne à la raison. A minima, les Etats adhérents doivent prévoir des recours préventifs et compensatoires (Volodya Avetisyan c/ Arménie, 3 mai 2022, n° 39087/15, § 29).
Dans l’esprit de l’arrêt Kudla et dans son rôle de conscience de l’Europe, la CEDH ne cesse de prôner une position raisonnable. Oui, la sanction est l’un des buts de l’emprisonnement ; oui, la peine de prison a pour fonction de protéger la société notamment en empêchant la récidive (CEDH, gde ch., Mastromatteo c/ Italie, 2002, n° 37703/97, § 72). Toutefois, dans une société démocratique, les politiques pénales ont aussi pour objectif la réinsertion des personnes détenues et condamnées à l’issue de leur peine (CEDH, gde ch., Murray c/ Pays-Bas, 26 avr. 2016, n° 10511/10, § 101).
Quelle que soit la gravité des crimes commis par les personnes détenues, le maintien de conditions de détentions respectueuses du principe de dignité humaine est le gage d’une société animée par une justice humaniste et non par la vengeance.
[1] Voir l’intervention de Jean-Marie Delarue au colloque hommage à Jean-Paul Costa, « Les leçons d’un parcours singulier : Jean-Paul Costa », organisé par le Comité d’histoire du Conseil d’Etat et de la juridiction administrative, le 24 octobre 2025: https://www.youtube.com/watch?v=QBywzVyGvgQ
[2] L’arrêt Kudla fait l’objet de deux commentaires sous ces deux aspects dans Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, F. Sudre, J. Andriantsimbazovina, G. Gonzalez, A. Gouttenoire, F. Marchadier, L. Milano, A ; Schahmaneche, D. Szymczak, 11e éd., Presses universitaires de France, n°14, p. 177 ; n°38, p. 497.
[3] A. Drzemczewski et C. Giakoumopoulos, « Article 13 », in L.E. Petitti, E. Decaux, P.H. Imbert, La Convention européenne des droits de l’homme. Commentaire article par article, 2e éd., Paris, Economica, 1999, p. 455, spéc. 456.
[4] « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
[5] J.F. Flauss, « Le droit à un recours effectif. L’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme », in Le juge administratif français et la CEDH, colloque de Montpellier des 14-15 décembre 1990, Revue universelle des droits de l’homme, 1991, Vol.3, n°7-9, p. 324.
[6] G. Rusu, Le droit à un recours effectif au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, Thèse, Université de Montpellier I, 2014.
[7] F. Sudre et autres, Droit européen et international des droits de l’homme, 17e éd., Paris, Presses universitaires de France, 2025.