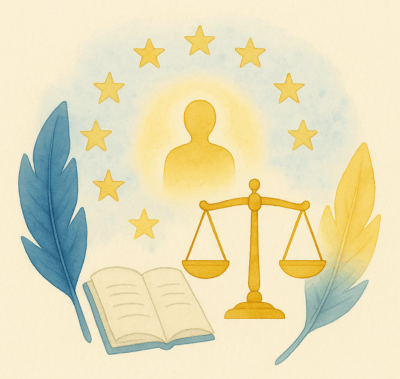I. Textes juridiques européens
- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 7 décembre 2000.
- Articles 2 et 3 TUE.
- Article 6 TUE.
- Article 7 TUE.
- Articles 49 et 50 TUE.
II. Principales jurisprudences
- CJUE, GC, 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, aff. C-64/16.
- CJUE, GC, 5 novembre 2019, Commission européenne c. Pologne, aff. C-192/18.
- CJUE, GC, 19 novembre 2019, A. K. c/ Krajowa Rada Sądownictwa et CP, DO c/ Sąd Najwyższy, aff. jtes C-585/18, C-624/18 et C-625/18.
- Ordonnance du 8 avril 2020
- CJUE, GC, 26 mars 2020, Miasto Łowicz, aff. C-558/18 et C-563/18
- CJUE, 27 octobre 2021, Commission c/ Pologne, aff. C-204/21.
- CJUE, 16 février 2022, Hongrie et Pologne c/ Parlement et Conseil, C-156/21 et C-157/21.
III. Jurisprudence nationale
- Tribunal constitutionnel polonais, 7 octobre 2021, n° K 3/21.
IV. Conclusions d’avocats généraux
- Conclusions de M. Dean Spielmann, 11 mars 2025, Commission européenne c. République de Pologne, aff. C-448/23.
- Conclusions de Mme Tamara Ćapeta, 5 juin 2025, Commission européenne c. Hongrie, aff. C-769/22.
Pour approfondir :
- Sur l’État de droit : C. Vial, « Un paradoxe cohérent et surmontable : Le difficile respect de l’État de droit dans l’Union (des États) de droit », in Mélanges Sudre, LexisNexis, Paris, 2018, pp. 823-831 ; L. Blatière, « La protection évolutive de l’État de droit par la Cour de Justice de l’Union européenne », RDLF 2019 chron. n°31 ; S. Platon, « Le respect de l’État de droit dans l’Union européenne : la Cour de justice à la rescousse ? », RDLF 2019 chron. n°36 ; R. Tinière, « État de droit et valeurs de l’Union européenne », RDLF 2019 chron. n°57 ; A. Perego, « La jurisprudence de la Cour de justice sur l’indépendance judiciaire », Revue du droit de l’Union européenne, n° 4, 2019, pp. 129-142 ; Résolution du PE en date du 8 juillet 2021 sur l’élaboration de lignes directrices relatives à l’application du régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (2021/2071(INI)) ; H. Gaudin, « Ce que l’Union européenne signifie : l’identité de l’Union européenne et de ses Etats membres – A propos des arrêts de la CJUE, rendus en Ass. Pl., du 16 février 2022, Hongrie c/Parlement européen et Conseil, C-156/21 et Pologne c/Parlement européen et Conseil, C-157/21. », RTDH, n° 133, 2023, pp. 17-34.
- Sur la Pologne et la Hongrie : Commentaires de M. Frans Timmermans concernant l’action de la Commission européenne visant à sauvegarder l’état de droit en Pologne ; L. Pech, S. Platon, « Menace systémique envers l’État de droit en Pologne : Entre action et procrastination », Question d’Europe [En ligne], n°451 ; F. Martucci, « La Pologne et le respect de l’État de droit. Réflexions suscitées par la décision K 3/21 du Tribunal constitutionnel polonais », JCP G, n° 45, 8 Novembre 2021, p. 1181 ; H. Gaudin, « État de droit : nouvelle procédure en manquement contre la Pologne – vers une procédure pilote ? », Dalloz actualité, 19 janvier 2022 .
- Pour aller plus loin sur la Pologne : L. Laithier, « L’Union européenne, une Union de droit ? Analyse de la portée du modèle de l’État de droit lors du récent épisode des réformes judiciaires polonaises » ; J.-P. Stroobants, « La commission européenne frappe Varsovie», Le Monde en ligne, 20 déc. 2017 ; A. Salles, « Le recours à l’article 7 du traité européen, Varsovie dénonce “une décision purement politique” », Le Monde en ligne, 21 déc. 2017 ; D. Berlin, « Union européenne, Pologne, le bras de fer continue », JCP G, n° 47, 2019, p. 2087 ; W. Zagorski, « Quand la Cour constitutionnelle polonaise réfute la jurisprudence la CJUE. Observations sous l’arrêt du 7 octobre 2021 », JP Blog [En ligne] ; https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200047fr.pdf ; https://www.eu-logos.org/2020/04/15/les-atteintes-a-letat-de-droit-en-pologne/
- Pour aller plus loin sur la Hongrie : https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200109IPR69907/etat-de-droit-en-hongrie-et-pologne-la-situation-s-est-deterioree ; https://www.lesoir.be/297742/article/2020-04-29/etat-de-droit-nouveau-recours-de-la-commission-contre-les-reformes-de-la-justice ; A. Boisgontier, « Inscription du “sexe à la naissance” à l’état civil en Hongrie : Un recul significatif pour les droits des personnes trans et intersexes », La Revue des droits de l’homme [En ligne].
- Sur le régime général de conditionnalité : Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.
1°) L’émergence et la consécration des valeurs
L’affirmation des valeurs de l’Union européenne s’inscrit manifestement dans un vaste processus de constitutionnalisation de l’intégration européenne, véritable fil directeur de son évolution depuis les premières Communautés européennes. La consécration des fondements de l’Union, désormais inscrite dans le TUE depuis Amsterdam, a été précédée d’une maturation progressive, nourrie à la fois par les textes politiques et par la jurisprudence. Une première vague de références explicites apparaît dès les années 1970, témoignant de la volonté de doter la Communauté d’un socle normatif commun :
- Déclaration de la conférence au sommet de Paris du 21 octobre 1972 ;
- Déclaration de la conférence au sommet de Copenhague du 14 décembre 1973 ;
- Rapport de la Commission du 25 juin 1975 sur l’Union européenne ;
- Résolution du Parlement du 10 juillet 1975 sur l’Union européenne.
Elle fuit suivie d’une deuxième vague particulièrement importante :
- Déclaration solennelle sur l’Union européenne des chefs d’État et de gouvernement de Stuttgart du 19 juin 1983 ;
- Résolution du Parlement du 14 septembre 1983 relative au projet de traité sur l’Union européenne ;
- Projet de traité du Parlement du 14 février 1984, dit projet Spinelli.
Toutefois, ces textes, pour importants qu’ils soient, ne se sont pas immédiatement traduits par des dispositions de droit positif. Leur portée est restée essentiellement programmatique, même si certaines clauses des traités, ainsi que plusieurs positions jurisprudentielles, en annonçaient déjà les contours. On peut ainsi voir, dans le préambule du traité CEE du 25 mars 1957 ou dans celui de l’Acte unique européen du 28 février 1986, des références explicites à ces principes, attestant de leur présence latente bien avant leur consécration formelle.
Il a fallu attendre l’adoption du TUE en 1992 pour que ces fondements soient expressément inscrits dans les traités constitutifs. Le préambule du traité proclamait l’« attachement » des États membres aux principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de l’État de droit. L’article 6 § 1 faisait référence aux systèmes de gouvernement des États membres, tous fondés sur les principes démocratiques, tandis que le § 2 rappelait la protection des droits de l’homme. Le véritable tournant survient, à bien regarder, avec le Traité d’Amsterdam en 1997, qui érige ces principes en « principes fondateurs » de l’Union à valeur contraignante. Désormais inscrits à l’article 6 § 1, ils s’imposent tant aux institutions qu’aux États membres, sous peine de sanctions politiques pouvant aller jusqu’à la suspension de certains droits en cas de violation grave. L’article 6 proclame en toutes lettres : « L’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres ». Or, cette exigence n’est pas seulement interne : elle s’étend aux États candidats à l’adhésion, tenus de se conformer à ces principes (article 49 TUE), mais aussi aux États tiers, soumis à des clauses de conditionnalité politique dans les accords conclus avec l’Union ou dans les actes unilatéraux leur accordant des avantages.
Il convient également de souligner l’importance de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée en décembre 2000 lors du Conseil européen de Nice. Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, elle a acquis la même valeur juridique que les traités (article 6, paragraphe 1, TUE). La Charte ne se limite pas à réaffirmer les droits existants : elle en précise le contenu et les articule explicitement autour d’un ensemble de valeurs. Son préambule proclame : « Les peuples de l’Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité ; elle repose sur le principe de la démocratie et de l’État de droit […]. L’Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes […] ». Cette référence explicite à la dignité, à la liberté et à l’égalité témoigne d’une volonté – clairement exprimée dans le praesidium de la Convention – de lier l’intégration européenne à un projet éthique et politique, au-delà du seul marché intérieur.
De même, le Traité établissant une Constitution pour l’Europe a constitué un moment fondamental dans la consécration des valeurs de l’Union. Son article I-2 en proposait une formulation solennelle : « L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes ». D’ailleurs, le traité s’y référait à la fois dans son préambule et en faisait le fil conducteur de l’ensemble de ses dispositions. Il intégrait la Charte des droits fondamentaux comme sa deuxième partie, offrant dès lors une cohérence nouvelle entre les principes fondateurs de l’Union et la protection des droits et libertés fondamentaux.
La consécration des valeurs atteint son aboutissement avec le Traité de Lisbonne. Celui-ci reprend, à l’article 2 du TUE, la formulation du TECE en érigeant les valeurs en véritable socle constitutionnel de l’Union : « L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes ». Cette réécriture marque un vrai tournant : les anciens « principes » deviennent dorénavant des « valeurs », notion plus englobante et dotée d’une portée constitutionnelle accrue. L’énumération initiale (liberté, démocratie, État de droit, respect des droits de l’homme) est augmentée de la dignité et de l’égalité, ainsi que d’une mention explicite des droits des personnes appartenant à des groupes minoritaires – ajout qui visait notamment à rassurer certains États, dont la Hongrie, sur la reconnaissance de leur diversité interne.
Toujours est-il que ces valeurs ne sont pas des pétitions de principe : elles sont assorties de mécanismes de sauvegarde. En ce sens, l’article 7 du TUE organise un contrôle politique permettant de prévenir et de sanctionner toute violation grave et persistante de ces valeurs par un État membre. Cette procédure – parfois qualifiée d’« arme nucléaire » – peut aller jusqu’à la suspension de certains droits, particulièrement du droit de vote de l’État concerné au sein du Conseil. L’exigence de respect des valeurs dépasse aussi le cercle des États membres comme on l’observait préalablement. Elle s’impose à tous les États candidats, qui doivent démontrer leur adhésion effective à ce socle normatif pour pouvoir rejoindre l’Union, ainsi qu’aux États tiers. Ainsi, les valeurs de l’article 2 TUE ne se limitent pas à un rôle déclaratif : elles deviennent un instrument de régulation, de convergence et de protection de l’identité – du « génome » – de l’Union.
Pour être tout à fait exact, il convient de distinguer les « valeurs », qui constituent le socle normatif de l’Union (art. 2 TUE), des « objectifs » qui définissent les finalités concrètes de son action (art. 3 TUE). Si les objectifs sont largement hérités du projet de Constitution européenne, ils prolongent et mettent en œuvre les valeurs en leur donnant une orientation téléologique. C’est pourquoi l’article 3 du TUE dispose la chose suivante : « L’Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples […]. Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant […]. Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l’élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l’homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu’au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la Charte des Nations Unies ». Cette articulation montre que les « valeurs » fournissent un cadre axiologique, tandis que les « objectifs » traduisent ces valeurs en lignes d’action et politiques concrètes. Leur mise en œuvre bénéficie d’un haut degré de juridictionnalisation, puisque la compétence de la CJUE s’étend à l’ensemble du droit primaire – TUE et TFUE, hors PESC –, assurant ainsi un contrôle juridictionnel sur le respect de ces objectifs.
En somme, l’article 2 du TUE n’est pas isolé, puisque l’on retrouve les valeurs dans tout un tas d’articles – les 6, 7, 19, 49 du TUE – attestant que les valeurs se situent au soubassement de la construction de l’UE. Et les « objectifs » mentionnés à l’article 3, lorsque les distingue – sans les opposer – des « valeurs », traduisent bien cela.
2°) L’État de droit : pierre angulaire des valeurs et du projet européen
La mention de l’État de droit se veut une référence à un principe propre aux régimes démocratiques, que reconnaissent tant les constitutions nationales, de manière plus ou moins explicite, que les instruments internationaux de protection des droits de l’Homme.
- La « communauté de droit». – Dès 1959, Walter Hallstein, alors président de la Commission de la CEE, forgeait l’expression de « Communauté de droit » pour tenter d’empoigner la nature particulière de l’intégration européenne. L’idée était limpide : la Communauté devait constituer une transposition, au niveau supranational, des principes de l’État de droit. Cette conception a trouvé une première consécration textuelle dans le préambule du TUE de 1992. Certes, une telle « communauté de droit » était à l’époque encore balbutiante et marquée par de nombreuses lacunes. Mais, au fil des révisions successives des traités et grâce à l’œuvre jurisprudentielle de la Cour de justice, elle s’est progressivement rapprochée du modèle de l’État de droit qui prévaut dans les ordres constitutionnels des États membres, jusqu’à incarner aujourd’hui une véritable Union de droit.
Assurément, c’est la Cour de justice qui a donné toute sa réalité et profondeur à l’idée de « Communauté de droit » dans son célèbre arrêt Les Verts c. Parlement européen du 23 avril 1986, dans lequel elle reconnaissait que : « la Communauté est une Communauté de droit en ce que ni ses États membres ni ses institutions n’échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de base qu’est le traité ». Cette formule a depuis été régulièrement mobilisée, notamment pour justifier l’ouverture de voies de recours et pour consacrer le principe de coopération loyale inscrit à l’article 10 (ex-article 5) du traité CE. Si la CJ emploie quelquefois la notion plus large d’« État de droit » pour évoquer les principes fondamentaux qui structurent l’ordre juridique de l’Union, cette terminologie n’implique pas une véritable différence de nature avec l’idée de « Communauté de droit ». D’ailleurs, son premier avis sur l’Espace économique européen (CJCE, avis C-1/91, 14 décembre 1991), elle est même allée jusqu’à qualifier le traité de « charte constitutionnelle d’une Communauté de droit » [§21], consacrant, par là même, l’ambition constitutionnelle du projet européen. Cette conception, intimement liée au principe démocratique et la protection des droits fondamentaux, a accompagné tout l’approfondissement du droit de l’Union. Elle s’est consolidée et approfondie au fil des révisions des traités, de l’adoption de nouveaux textes de droit dérivé et d’une jurisprudence toujours plus exigeante, jusqu’à devenir l’un des « traits » de l’Union elle-même.
- Vers l’« Union de droit » – La création de l’Union européenne par le Traité de Maastricht a prolongé, voire approfondi, l’idée de « Communauté de droit ». En regroupant les Communautés européennes et de nouvelles formes de coopération intergouvernementale, l’Union européenne ne pouvait se concevoir autrement que comme une construction juridique aspirant à devenir une véritable Union de droit, fondée sur le principe de l’État de droit et soumise au respect des traités comme charte constitutionnelle commune. D’ailleurs, cette ambition a été consolidée par le Traité d’Amsterdam, qui a érigé l’État de droit en principe fondateur de l’Union. Elle se heurtait toutefois à une difficulté majeure : l’extension de ce principe aux domaines relevant des deuxième et troisième piliers (PESC et coopération policière et judiciaire en matière pénale). En effet, la prévalence de la méthode intergouvernementale dans ces domaines limitait alors l’épanouissement des mécanismes caractéristiques de l’État de droit, beaucoup plus présents dans la méthode communautaire, notamment à travers la juridictionnalisation et le contrôle juridictionnel. Plusieurs États membres se sont opposés à toute évolution susceptible de renforcer la supranationalité de l’Union dans ces secteurs sensibles. Ce n’est qu’avec le Traité de Lisbonne que ces résistances ont été partiellement surmontées : l’ex-troisième pilier a été pleinement intégré dans l’ordre juridique de l’Union et soumis au contrôle de la CJUE. C’est dans ce contexte que cette dernière a employé pour la première fois, dans un arrêt du 29 juin 2010 (procédure pénale c. E. et F., C-550/09), l’expression « Union de droit », appelée à remplacer celle-là de « Communauté de droit » dans une perspective élargie : « L’Union est une Union de droit dans laquelle ses institutions sont soumises au contrôle de la conformité de leurs actes, notamment, avec le traité FUE et les principes généraux du droit. Ledit traité a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à confier à la Cour le contrôle de la légalité des actes des institutions de l’Union…». Par cette affirmation, la CJUE a consacré l’idée que l’Union, dans toutes ses composantes, est soumise à un contrôle juridictionnel effectif, marquant l’aboutissement du processus de juridictionnalisation engagé depuis les premières années de la construction communautaire.
- Avancées vers l’Union de droit – Tirer toutes les conséquences de la valeur qu’est l’État de droit est un processus dynamique, marqué à la fois par des acquis et par des zones de conquête encore ouvertes. Si certains traits de l’Union de droit apparaissent aujourd’hui solidement établis, d’autres continuent de susciter controverses et résistances. Le Traité établissant une Constitution pour l’Europe a représenté une étape déterminante sur ce chemin, sans pour autant constituer un aboutissement. En classant l’État de droit parmi les valeurs fondatrices de l’Union, il confirmait les apports du Traité d’Amsterdam, tout en introduisant une variation terminologique notable, préférant le terme de valeurs à celui de principes. La Charte des droits fondamentaux, intégrée comme deuxième partie du TECE, renforçait cette logique en articulant explicitement les droits et libertés autour de ce socle axiologique. Le TECE proposait, par ailleurs, une série de réformes destinées à affermir l’« Union de droit, » qu’il s’agisse de la clarification des sources normatives ou bien du perfectionnement du système de recours, deux piliers essentiels de l’État de droit dans un ordre juridique supranational. Le Traité de Lisbonne, reprenant l’essentiel des apports du TECE, a intégré ces avancées dans le TUE et le TFUE, enrichissant le système complexe des sources de droit de l’Union et renforçant encore la juridictionnalisation de l’ordre juridique européen.
Néanmoins, les crises hongroise et polonaise, marquées par l’adoption de réformes jugées incompatibles avec les standards européens en matière d’indépendance de la justice et de respect des droits fondamentaux, ont replacé cette valeur au centre du débat européen. Elles lui ont également conféré un contenu renouvelé et plus substantiel, en transformant cette notion en véritable critère d’évaluation du respect des engagements des États membres et en catalyseur d’une nouvelle dynamique jurisprudentielle et politique au sein de l’Union.
3°) Les crises hongroise et polonaise : l’épreuve de vérité
L’arrêt du 27 février 2018, Association syndicale des juges portugais, marque, en ce sens, un tournant décisif dans la construction jurisprudentielle de l’État de droit au sein de l’UE. Par cet arrêt fondateur, la CJUE a posé les bases de quelque chose de fort et d’inédit : la question de l’indépendance des juges nationaux est désormais abordée comme un élément constitutif de la valeur de l’État de droit, ce qui redéfinit en profondeur les relations entre l’Union et les systèmes judiciaires des États membres. Effectivement, la CJUE y interprète l’article 19 § 1 second alinéa TUE, en ce sens qu’il « concrétise la valeur de l’État de droit » mentionnée à l’article 2 TUE. Par conséquent, elle en déduit qu’il appartient à tous les États membres, en vertu du principe de coopération loyale énoncé à l’article 4 § 3 TUE, d’assurer aux justiciables un droit effectif à une protection juridictionnelle dans tous les domaines couverts par le droit de l’Union. Cela implique la mise en place d’un système de voies de recours et de procédures garantissant un contrôle juridictionnel effectif.
Par cette décision, somme toute, la Cour a ouvert la voie à un contrôle renforcé de l’indépendance des juridictions nationales et, plus largement encore, à une juridictionnalisation accrue des valeurs de l’Union, faisant de l’État de droit un standard opératoire et non plus seulement une référence symbolique. Cet arrêt de 2018, on l’observe mieux, est véritablement séminal : en liant pour la première fois l’article 2 TUE (valeurs de l’Union) et l’article 19 TUE (protection juridictionnelle), la Cour a ouvert la voie à une série de décisions majeures. Celles-ci portent, d’une part, sur l’indépendance des juges nationaux, dorénavant considérée comme un élément constitutif de l’État de droit et donc un critère de contrôle du respect des engagements des États membres envers l’Union. D’autre part, elles établissent un lien direct entre le respect des valeurs de l’article 2 TUE et la confiance mutuelle qui fonde l’espace de liberté, de sécurité et de justice – notamment le mécanisme du mandat d’arrêt européen. Si le premier aspect concerne principalement les rapports entre l’Union et les États membres (contrôle de leurs systèmes judiciaires), le second dimensionne la problématique au niveau horizontal, en affectant les relations entre États membres et en conditionnant la « reconnaissance mutuelle » de leurs décisions judiciaires. Bref, l’effet combiné des articles 2 et 19 TUE confère une dimension nouvelle à l’exigence d’indépendance et d’impartialité des juges nationaux, qui vient s’ajouter à celle déjà requise par l’article 267 du TFUE et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux. Comme l’avait rappelé la Cour dans l’arrêt Simmenthal en date du 9 mars 1978, les juges nationaux sont également juges de l’ordre juridique de l’Union et, à ce titre, garants de son effectivité. Leur indépendance devient dès lors une condition structurelle du fonctionnement de l’Union et se décline sous trois angles complémentaires, pouvant s’appliquer séparément ou se cumuler, avec des conséquences d’intensité variable.
a) L’indépendance au regard de l’article 267 TFUE
L’article 267 TFUE confère aux juridictions nationales le pouvoir – et quelquefois même le devoir – de poser des questions préjudicielles à la CJUE. Cependant, pour être qualifié de « juridiction » au sens de cet article, l’organe de renvoi doit présenter un certain nombre de caractéristiques, parmi lesquelles figure, entre autres, l’indépendance. Si la CJUE conclut qu’un organe ne remplit pas ces critères, elle se borne à rejeter la question préjudicielle, sans obliger l’État membre à modifier le statut de l’organe concerné. Or, la qualification de « juridiction » repose sur une série d’éléments cumulatifs : l’origine légale de l’organe, son caractère permanent, le caractère obligatoire de sa compétence, la nature contradictoire de la procédure, l’application de règles de droit, ainsi que l’indépendance.
b) L’indépendance au titre de l’article 47 de la Charte
L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux garantit à tout justiciable le « droit à un tribunal indépendant et impartial, » ce qui constitue un élément essentiel du droit à un procès équitable. Dans son arrêt LM du 25 juillet 2018, la CJUE a rappelé que ce droit subjectif doit être effectivement assuré par les États membres chaque fois qu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’interprétation de l’article 47 s’aligne sur celle de l’article 6 CEDH, conformément à l’article 52 § 3 de la Charte, pour assurer un niveau de protection équivalent. Lorsque la CJUE constate une violation de ce droit dans une procédure nationale, l’État est alors tenu d’adopter toutes les mesures nécessaires pour préserver la primauté et l’effectivité du droit de l’Union. Toutefois, l’invocation de l’article 47 est limitée au champ d’application du droit de l’Union, défini à l’article 51 de la Charte.
Fort de toutes ces précisions, l’arrêt Association des juges portugais montre que l’article 19 § 1 TUE, lu en combinaison avec l’article 2 TUE, offre un instrument permettant de contester des atteintes générales ou systémiques à l’indépendance et l’impartialité des juges dans les États membres, susceptibles de compromettre le respect de l’État de droit. Ce lien avec les principes suprêmes de l’article 2 du TUE permet de dépasser le principe de l’autonomie procédurale des États et, par-dessus tout, de fonder une intervention de l’Union même lorsque les réformes litigieuses ne concernent pas strictement la « mise en œuvre » d’un acte de droit de l’Union. Autrement dit, cette approche permet de dépasser le champ d’application plus restreint de l’article 47 de la Charte, limité par son article 51. La CJUE a d’ailleurs précisé que l’article 19 du TUE « vise les domaines couverts par le droit de l’Union, indépendamment de la situation dans laquelle les États membres mettent en œuvre ce droit, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte » (arrêt LM). Cette interprétation élargie consacre l’article 19 du TUE comme une véritable clause de sauvegarde de l’État de droit dans l’Union.
S’appuyant sur l’arrêt fondateur du 27 février 2018, la CJUE a progressivement affiné ses critères d’analyse de l’indépendance des magistrats dans le cadre des « affaires polonaises », en particulier face à des situations révélant un risque de défaut systémique de l’État de droit. Ainsi, dans son ordonnance du 15 novembre 2018, le président de la Cour a rappelé que « l’exigence d’indépendance des juges relève du contenu essentiel du droit fondamental à un procès équitable, lequel revêt une importance cardinale en tant que garant de la protection de l’ensemble des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union et de la préservation des valeurs communes aux États membres énoncées à l’article 2 TUE, notamment, de la valeur de l’État de droit ». Parfois cependant, certaines décisions – à l’exemple de l’arrêt Miasto Łowicz – examinent la question de l’indépendance seulement sous l’angle de l’article 19 du TUE, sans mobiliser directement l’article 2 du TUE. Le plus souvent, force est de remarquer que la CJUE combine ces deux dispositions du TUE pour articuler la protection de l’indépendance judiciaire avec la sauvegarde des valeurs de l’Union. À titre d’exemple, dans l’arrêt Commission c. Pologne du 24 juin 2019, elle a avoué que « L’article 19 TUE, qui concrétise la valeur de l’État de droit affirmée à l’article 2 TUE, confie aux juridictions nationales et à la Cour la charge de garantir la pleine application du droit de l’Union dans l’ensemble des États membres, ainsi que la protection juridictionnelle que les justiciables tirent de ce droit. L’indépendance des juridictions, qui est inhérente à la mission de juger, relève du contenu essentiel du droit à une protection juridictionnelle effective et du droit fondamental à un procès équitable, lequel revêt une importance cardinale en tant que garant de la protection de l’ensemble des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union et de la préservation des valeurs communes aux États membres énoncées à l’article 2 TUE, notamment la valeur de l’État de droit ». Cette formule a ensuite été reprise dans les arrêts Commission c. Pologne (5 novembre 2019) et A.K. (19 novembre 2019). Dans ce dernier, la CJ a synthétisé les différents aspects de l’indépendance des juges à la lumière des articles 2 et 19 du TUE, en distinguant notamment les dimensions dites interne (garanties contre les pressions hiérarchiques) et externe (protection contre les ingérences des autres pouvoirs), déjà esquissées dans Association des juges portugais et LM.
Du reste, ce lien entre l’indépendance des juges et la valeur de l’État de droit a été réaffirmé avec force dans l’ordonnance en date du 8 avril 2020 rendue dans l’affaire Commission c. Pologne, concernant les mesures provisoires ordonnées à propos de la législation polonaise sur la Chambre disciplinaire de la Cour suprême. La Cour y rappelle que : « Conformément au principe de séparation des pouvoirs qui caractérise le fonctionnement d’un État de droit, l’indépendance des juridictions doit être garantie à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif. À cet égard, il importe que les juges se trouvent à l’abri d’interventions ou de pressions extérieures susceptibles de mettre en péril leur indépendance ». Finalement, cette jurisprudence illustre que, si l’article 19 § 1 TUE « concrétise » la valeur de l’État de droit énoncée à l’article 2 TUE, le lien est, en réalité, réciproque : c’est bien l’ancrage dans l’article 2 et dans ses valeurs suprêmes qui confère à l’article 19 TUE sa pleine épaisseur normative, ainsi que son caractère opératoire. Cette combinaison a donné à la CJUE les moyens d’affirmer un contrôle renforcé sur le respect de l’État de droit, marquant un approfondissement sans précédent du rôle de la Cour comme gardienne de l’ordre constitutionnel de l’Union.
4°) Vers une juridictionnalisation accrue des valeurs
Au terme de l’analyse, c’est à présent vérité bien assurée : l’article 2 TUE n’est plus un simple catalogue de principes politiques – il est désormais un véritable standard de contrôle juridictionnel, directement mobilisable devant la CJUE et producteur d’effets concrets. Combiné aux articles 3 (objectifs) et 6 (Charte des droits fondamentaux) TUE, il consacre la dimension résolument « constitutionnelle » de l’Union. Mais le combat est loin d’être achevé : la CJUE est appelée à faire acte de résistance, notamment à la suite de la décision du Tribunal constitutionnel polonais du 7 octobre 2021 contestant la primauté du droit de l’Union au titre de l’« identité constitutionnelle ». L’arrêt attendu dans l’affaire Commission c. Pologne s’annonce comme un jalon majeur de la jurisprudence européenne, susceptible de spécifier les limites de la souveraineté constitutionnelle des États membres face aux exigences de l’Union. Les conclusions de l’avocat général D. Spielmann, récemment publiées, rappellent à cet égard qu’il existe quelques « lignes rouges » qui ne sauraient être franchies sans mettre en péril la cohésion de l’Union, mais aussi l’intégrité de son ordre juridique. En conclusion, la consécration et la juridictionnalisation des valeurs de l’UE témoignent d’une transformation profonde de l’intégration européenne, mais surtout elles soulèvent la question de la capacité de l’Union à maintenir le bon équilibre entre l’exigence de respect de ses fondements et la diversité constitutionnelle des États membres. L’avenir dira si cette dynamique parvient à résister aux tensions, à renforcer la solidarité et la confiance mutuelle entre États, ainsi qu’à garantir une « cohésion durable » autour d’un projet commun fondé sur la démocratie, l’État de droit et les droits fondamentaux. Une chose est néanmoins certaine : la bataille pour préserver la valeur de l’État de droit est devenue le nouveau cœur battant de l’intégration européenne.